God Save Queen – en écho à Bohemian Rhapsody
L’histoire du rock bégaie, comme toutes les histoires. Les critiques cinglantes et sans appel du film Bohemian Rhapsody se justifient surtout par ce qu’il n’est pas et aurait pu être : un opéra rock déglingue, une ode à l’hédonisme crépusculaire de Queen. En revanche, elles sont en phase parfaite avec la verve fielleuse des rock critics à la grande époque du groupe.
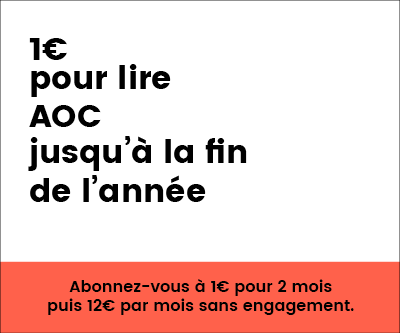
Ne pas aimer Queen aujourd’hui ? Un péché contre l’histoire du rock. Aimer Queen à la charnière des années 70 et 80 ? Une trahison du rock. Mais pour qui se prenaient-ils, ces quatre fils relativement aisés et bien éduqués d’une Angleterre en crise [1], avec leur mélange assez inextricable de glam rock, hard bourrin, et pop sophistiquée ? Ce chanteur arrogant, outrageusement androgyne en collants bariolés, trucs en fourrure, œil de biche et déhanchement lascif ? Le journaliste Dave Marsch, dans Rolling Stone, n’y allait pas avec le dos du stylo : « Le premier groupe rock fasciste », commentait-il à propos de We will rock you, ulcéré par ce rock des stades manipulant le public avec l’aisance d’un gourou… ou d’un dictateur.
Face à la réalité des fascismes européens qui montent, cela prête un peu à sourire aujourd’hui : elles nous semblent bien idylliques, ces années 70 et 80 où l’on croyait encore aux jours meilleurs et où la provoc à coups d’insignes fachos tombait dans les scores dérisoires de leurs représentants aux élections. (On aurait dû se méfier, notamment en regardant les stades de l’Amérique latine à l’époque.) Mais, sérieux, fascistes, Queen et leur manipulation du public au petit doigt ?
Si on pose l’hypothèse que le fascisme est indissociable de la haine et de la désignation d’un bouc émissaire, quelqu’il soit, ça tient difficilement. On serait bien en peine de trouver une seule ligne de haine, dans une seule chanson de Queen.
Queen pourrait passer aujourd’hui pour l’avant-garde du macronisme : la start-up Queen avait décidé dès le début qu’elle deviendrait multinationale, ses musiciens rich and famous, et ça a marché.
Ni, d’ailleurs, une seule ligne de rage, ce qui est nettement plus problématique pour le rock’n roll. Les punks ne s’y trompaient pas, qui avaient bien identifié ce rock glamour, mélodique, en paillettes comme l’ennemi. « Tu veux amener le ballet au peuple ? » aurait balancé Sid Vicious à Freddie Mercury, dans le couloir des studios d’enregistrement Wessex, où les Sex Pistols enregistraient Never Mind the Bollocks et Queen son sixième album. « On fait de notre mieux, Mr. Ferocious », répliquait le dandy Mercury. La guéguerre des icônes peut faire rire, avec le recul des années : après tout, les Sex Pistols n’étaient-ils pas aussi des créatures et créations lancées par Malcolm McLaren, ce fin renard de la hype, et Vivienne Westwood ? Un cri nihiliste destiné à finir en carte postale pour l’office du tourisme londonien, La Grande escroquerie du rock’n roll, comme le dit le film éponyme.
N’empêche : à l’époque, on prenait le rock au sérieux, et à ce tournant du début des années 80, on choisissait son camp. Les uns chantaient No Future, les autres exaltaient l’hédonisme. Ravagée par la crise économique, l’Angleterre allait dérouler le tapis rouge à Thatcher et inaugurer l’ère du néolibéralisme triomphant, avec son alter ego d’outre Atlantique Ronald Reagan. Ce virage ou naufrage est subtilement raconté dans un roman récent, L’hiver du mécontentement. Un roman sur fond de punks et de losers, justement, où l’ascension au pouvoir de la Dame de fer est raconté avec le fatalisme implacable d’une tragédie de Shakespeare (en l’occurrence Richard III, pièce que la jeune héroïne répète et qui rythme le livre). Chaque chapitre cite une chanson, mais si les punks y sont omniprésents, Queen n’y est pas cité… sinon de manière subliminale, avec le titre « The Show must go on » attribué à Pink Floyd qui l’a repris.
Il y a une logique à cela. On hurlait No Future mais ce serait surtout les punks qui sombreraient tragiquement. Au moment où les Sex Pistols chantaient Anarchy in the UK sur fond de déglingue économique, Queen triomphait en tournée avec ses « chansons d’amour commerciales » [2]. Le groupe dansait sur le Titanic et pourrait passer aujourd’hui pour l’avant-garde de la contre révolution néolibérale. Voire pour une avant-garde du macronisme : la start-up Queen avait décidé dès le début qu’elle deviendrait multinationale, ses musiciens rich and famous, et ça a marché. Ils ont tout compris aux contrats, à la production, à la com’ : ce qu’il faut de culot, ce qu’il faut de boulot. Des pros qui ne laissaient rien au hasard et perçaient en quatre ans à peine. No time for losers.
« Je suis une pute de la musique » : Freddie Mercury était cash et aimait le cash. L’esthétique pauvre et déglingue, le bricolage do it yourself, ce n’était pas pour ces perfectionnistes, à la fois premiers de cordée éternels décalés.
Le groupe est « trop », c’est sa marque de fabrique : trop glam, trop spectaculaire pour les puristes, trop kitsch, trop hard pour les esthètes, et bien trop consensuel pour les rebelles.
Un peu en retard et trop bourrins pour le glam rock de Bowie, un peu en avance et trop bourrins aussi pour les Nouveaux romantiques incarnés par Culture Club et Adam and The Ants. Trop mainstream pour être adoubés par la critique rock. Trop consensuels pour être des phares de la culture gay dans leur grandes années – le coming out de Mercury ne viendrait que discrètement et tardivement, forcé par les tabloïds, et son absence notoire dans le combat contre le SIDA jusqu’à la veille de sa mort fait partie des griefs nourri contre le groupe. L’androgyne à eyeliner et ballerines a fini par endosser le look plus classique du gay musclé à moustache au tournant des années 80 – perdant au passage son ambiguïté troublante.
Insolents, provocs, mais surtout, surtout pas politique, my dear. Voire carrément cyniques quand ils vont tourner en Afrique du Sud en plein régime d’apartheid : une tache indélébile sur leur CV que le film occulte soigneusement et qu’ils n’ont reniée que du bout des lèvres.
La rage est mon énergie : c’est comme ça que Johnny Rotten/John Lydon a titré son autobiographie. Eux, leur énergie, c’était le fun et l’ambition démesurée, dès le début, d’être les premiers. Ils se marrent quand ils imposent un invraisemblable patchwork de ballade, d’opéra, de guitar hero avec « Bohemian Rhapsody », un format impossible qui les propulse immédiatement en haut des charts (même si, là aussi, les critiques tordent le nez). Ils calculent et sont efficaces. Le triomphe de l’entrepreneuriat, ce storytelling du gosse parsi de Zanzibar devenu superstar et icône gay. Le talent de la com’, aussi. Queen, c’était une marque lancée à coups de logos, de clips, de presse people – dingue de ses chats, Mercury a quasiment préfiguré le lolcat ! – dont la caractéristique est le « too much ». Le groupe est « trop », c’est sa marque de fabrique : trop glam, trop spectaculaire pour les puristes, trop kitsch, trop hard pour les esthètes, et bien trop consensuel pour les rebelles.
Pourquoi s’en seraient-ils privés, puisque ça marchait ? Le public se fichait éperdument de leur totale dépolitisation. On ne mesure peut être pas tout à fait, dans la France de 2018, à quel point Queen était et reste populaire dans les îles britanniques. La success story totale perdure aujourd’hui, aussi pathétique que l’on puisse juger les différentes recompositions du groupe. On peut y lire l’emblème du triomphe du show business sur tout caractère rebelle du rock, anticipant ce que seraient les futures stars, de Michaël Jackson (qu’admirait Mercury) à Madonna. Malgré Clash, malgré les Smiths, malgré « Rock against Thatcher », le cynisme gagnerait et l’humanitaire dégoulinant de Band Aid prendrait le pas sur les cris de colère. Raison de plus pour cultiver la nostalgie des punks et tordre le nez sur leurs ennemis jurés.
Gay et Queer, Freddie Mercury l’était dans toute la polysémie des mots. Joyeux au moins sur scène, bizarre, inclassable.
Ou non. Parce que les années fric, la fichue décennie de l’égoïsme triomphant, Queen s’y est engouffré, mais en affichant outrageusement le principe de plaisir contre le principe de réalité, en restant sex, drugs and rock’n roll contre les « valeurs victoriennes » défendues par la Dame de Fer. Gay et Queer, Freddie Mercury l’était dans toute la polysémie des mots. Joyeux au moins sur scène, bizarre, inclassable. Avec le recul du temps, on oublie sa première pusillanimité à revendiquer son homosexualité (tant dès ses premiers pas sur scène elle semble s’affirmer avec morgue et panache). On retient le culot, l’anticonformisme vestimentaire et musical qui décale le groupe de toutes les modes éphémères, l’excès, l’hédonisme contre toutes les régressions puritaines – et rappelons aux jeunes lecteurs que le SIDA comme châtiment d’une vie dissolue était un discours récurrent des réacs des années 80 préfigurant le virage dance et electro.
On regrette d’autant plus que le biopic tombe dans une bonne vieille morale familialiste : les vieux amis et l’amour (hétéro) de jeunesse contre la vie orgiaque et la dissolution dans la fête…
Queen, c’est le son du début de la fin et le son de la résilience. Le chant du cygne avant le rappel à l’ordre. L’insolence d’une culture LGBT émergente qui devrait vite affronter ses deuils et se reconstruire tel le phénix à travers les décennies. Le son partagé par ceux qui ont vécu les années 70 et ceux qui regrettent de ne pas les avoir vécues : celle d’une époque où on pouvait déclarer le plaisir subversif et du pays qui incarnait cette liberté. De ce Londres où l’on pouvait squatter impunément, où les marchés de Notting Hill ou Camden n’étaient pas devenus des arnaques à touristes hors de prix, où des kids en rupture pouvaient encore croire à la grande aventure du rock. De cette Grande-Bretagne qui, prolo ou aristo, communiait dans le rock, de Brighton à Glasgow. D’un pays qui préfigurait le brassage des genres et des origines, et dont l’extravagance insulaire semblait aussi inusable que les chapeaux de la Queen… et les chansons de Queen. D’un pays dont on ne sait aujourd’hui s’il n’existe que dans nos rêves ou notre nostalgie.
Fuck the Brexit.
