La guerre n’est pas finie – sur La Moustache du soldat inconnu de Jérôme Prieur
Il y a juste quarante ans, Jérôme Prieur, tout jeune encore, publiait dans La Nouvelle Revue française (le n°305 de juin 1978) un compte rendu du film de François Truffaut qui venait alors de sortir, La Chambre verte. Intitulé « Un visage dans la nuit » et repris en 1980 dans le recueil Nuits blanches (le plus beau livre écrit sur le cinéma des années soixante-dix et ses généalogies : à quand sa réédition ?), ce texte offre, à sa façon, une clé pour comprendre, a posteriori, toute l’œuvre de Prieur – essais et films, nombreux, qui composent un ensemble cohérent jusqu’à la publication aujourd’hui de La Moustache du soldat inconnu. On y devine en tout cas quelque chose comme l’aveu d’un secret, et l’indice d’une fascination qui ne quittera jamais l’auteur de la série Corpus christi ou du merveilleux Proust fantôme, qui fut aussi un drôle de Monsieur Verdurin dans Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz et le scénariste, entre autres, du Pont du Nord de Jacques Rivette…
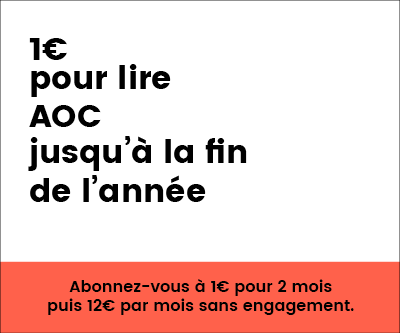
« La Chambre verte, écrivait-il, est un film imprudent. Imprudent parce qu’il est d’une autre époque, moins par son sujet et les dates données au récit (l’entre-deux-guerres) que par ses personnages et la façon dont l’histoire est racontée, parce qu’il ose ne pas être moderne ni vraisemblable (par ses passions, ses lieux, ses objets). » Les « passions » de ce film ainsi analysé par Prieur ne sont-elles pas justement les siennes propres, lui en apparence si peu moderne, tel du moins qu’il se présente dans La Moustache du soldat inconnu (dont la première partie s’intitule « Ma vieille guerre »)? La Chambre verte, écrivait-il encore, c’est « l’histoire d’un homme voué au culte des morts, les maintenant en vie, plus que par le souvenir, par une vigilance de chaque instant. De toute sa volonté refusant l’oubli qui serait pour eux une trahison, une seconde mort. En arrière-plan, il y a l’hécatombe monstrueuse de la Grande Guerre, terre et cadavres mêlés sur les séquences lavande du début du film, et ceux qui n’en sont jamais revenus, ceux qui en sont revenus mais blessés ou estropiés et ceux qui ne s’en remettent pas d’en êtres sortis sains et saufs, coupables d’avoir eu cette chance, tel Julien Davenne (le personnage principal du film, interprété par Truffaut lui-même) ».
Julien Davenne, c’est donc aussi Jérôme Prieur : fasciné depuis l’enfance et sans raison biographique particulière par la guerre de 14, il en a fait, d’une certaine manière, la toile de fond et de feu de ses diverses interrogations sur ce que peut être l’art des images, et donc une possible magie – noire, blanche, technicolor même – de l’incarnation, voire de la transsubstantiation au cinéma, selon des modalités fictionnelles ou problématiquement historiques, dans une certaine tension de la vérité et du rêve, à un point où se croisent Proust et Murnau, Eustache et Artaud… Une affaire de fantômes, en tout cas, sans cesse reprise, ou plus exactement de fidélité aux « revenants » – titre, précisément, de la dernière partie de La Moustache du soldat inconnu.
Dans la masse des livres parus à l’occasion du centenaire de la Première guerre mondiale, cet essai est assurément celui qui dit le mieux la possibilité d’un rapport à la fois intime et distancié à ce conflit fondateur, si l’on peut ainsi le qualifier, du XXe siècle : c’est un grand livre d’histoire singulier, important parce que personnel, qui interroge ce que fait l’histoire dans nos vies, et comment la science historique elle-même – avec ce qu’elle suppose de sérieux dans l’examen des sources, l’analyse des archives, etc. – informe notre imaginaire. Intime, le livre de Jérôme Prieur l’est par bien des aspects, racontant sans effusion ni coquetterie familiale une manière de vocation très ancienne : dans les années soixante, à la fin de l’école primaire, Prieur s’est voulu écrivain pour faire le récit de cette guerre qui le fascinait : « Je devais avoir dix ou onze ans au début. Je me souviens que mon souci le plus vif n’était pas de l’écrire (ce livre sur la guerre de 14) ni de le faire paraître car je n’en doutais pas (…), je ne doutais de rien – ce qui n’était pourtant pas mon genre autant qu’il m’en souvienne. Ce qui me tracassait c’était la perspective d’arriver plus tard à dissimuler que l’auteur, moi, était si jeune, avec le souci d’empêcher que soient ipso facto discrédités la validité historique et le sérieux de l’entreprise – quitte à tirer parti a posteriori, après publication, de cet étrange engouement personnel, de cette obsession d’enfant, méticuleuse, presque maniaque, pour un passé qui n’était pas le sien. »
Enfant, comme le serait le Truffaut adulte de La Chambre verte, Prieur osa d’une certaine manière l’imprudence de ne pas être moderne : s’intéresser dans ses jeudis d’écolier à des archives, s’attarder pendant des heures dans des bibliothèques, admettre enfin son goût bizarre pour les morts – puisque c’est aussi de cela qu’il s’agit. Et c’est dans l’espèce d’autorisation donnée aujourd’hui par le centenaire, maintenant que tous les poilus sont morts et que l’auteur n’est plus depuis longtemps un enfant, que le livre est rendu possible au présent, dans l’émotion contenue d’une intimité enfin dicible. « Voici la lumière d’une planète morte, constate-t-il, qui nous atteint. Pourquoi ce regain d’intensité alors que les derniers acteurs ont tous fini par disparaître, alors même que leurs héritiers ne forment aucune communauté ? Peut-être parce que la disparition des derniers poilus nous a libérés collectivement… Elle nous a mis en première ligne, elle a fait de nous des témoins, elle nous a rendu une part de notre histoire intime : nos familles, nos silences et nos secrets de famille. » Intimité de la mort, donc : la voix de Prieur n’est pas simplement lyrique, elle est nourrie d’années de lectures, ne cherchant pas à révéler des informations nouvelles, mais rendant compte comme de l’intérieur (en particulier dans la première partie) de ce que put être l’expérience extrême de millions de soldats, la réalité du front, la saleté, le froid, la matière des corps, et des mots pour en dire les souffrances : « Que de mots entassés par-dessus les tranchées, abandonnés, oubliés. Je suis fourbu d’avoir marché dans les pages des lettres et des carnets. Je suis abruti, saoulé, assommé. Les phrases sont des boyaux que l’on traverse en courant de crainte de s’enliser. »
Ce qui est frappant, c’est bien l’appropriation des documents, des sources, des lettres, par un homme qui cherche – presque simplement – la vérité de ce fait inouï et interminable, une guerre dont il n’est pas revenu, sans l’avoir pourtant connue. Or, cette incorporation passe également par une sorte de cérémonial de distanciation. Ici intervient le rapport à l’image, qui fait aussi de La Moustache du soldat inconnu une sorte d’essai à suspens, comme un lointain remake historique du Blow up d’Antonioni, l’enquête d’un contemporain sur ses propres fantômes, au miroir d’abord d’une photographie (un choc), puis de ce qu’il appelle un « film fossile ».
La photographie, c’est celle parue dans un vieux numéro commémoratif de Paris Match de soldats composant au front une étrange cène : douze hommes casse-croûtant sur la table improvisée de cercueils… Qui a pris ce cliché ? En quelle année, en quel lieu exact ? Peut-on retrouver l’identité de chacun de ces hommes ? Quelle piste peut mener à l’histoire de leur vie, de leur mort aussi ? Prieur raconte comment il fut sidéré par cette image, puis obsédé par la possible résolution de son énigme, fatalement sans fin, sans fond, même si le hasard l’aidera à retrouver des noms, une cote d’archive, un peu de la réalité donc de la guerre qui passe là, dans la métamorphose de sa mise en scène.
Son empreinte en tout cas parcourt tout le livre, comme celle encore d’un petit film amateur qui fascine de même l’auteur, et dont il s’emploie longuement à retrouver celui qui, en 1915, à Bois-le-Prêtre, en Lorraine, prit l’initiative de le réaliser… Encore une affaire de fantômes, de vivante représentation de la mort, dans le mouvement saisi par la caméra de la guerre au quotidien : il ne faut pas en dire trop, pour ne pas éventer l’épaisseur de mystère et d’émotion de l’enquête, mais insister sur la puissance d’évocation que réussit à communiquer Prieur, dans la position qu’il nous fait partager de lecteur, spectateur, sémiologue d’une cérémonie funèbre livrée par rushes – et qui nous révèle, aussi, ce que nous sommes, comme en miroir. « Comment suivre à la trace ces soldats oubliés que nous n’arrivons pas à faire revivre ? Tous du moins regardent la caméra. Ce n’est pas tant qu’ils veulent entrer dans l’éternité- pauvre éternité qui ne se souviendra pas même de leur nom, ni de leur prénom -, ils veulent faire partie de l’image, ils veulent s’introduire dans l’image. Ce serait trop compliqué de penser à être maintenus en vie par des images, mais ils veulent y être gardés. Ils veulent que les images les gardent. »
Prieur a ainsi des formules magnifiques pour dire ce qui constitue, à travers l’étude et l’écriture, un voyage non pas seulement dans le passé figé des manuels d’histoire, si justes soient-ils, mais dans la vérité plus intime de ce qui subsiste presque organiquement en nous des morts. Tel le Julien Davenne de La Chambre verte, il en devient presque une nouvelle vigie virgilienne, et c’est sa voix qu’il faut écouter, encore un peu, pour faire entendre, bien mieux que par la solennité trop convenue des oraisons officielles, le souffle maintenu de ceux dont simplement nous descendons, qui sont lointains et là, dans un espace de mémoire révélée par les images : « Je passe des heures, des jours, des nuits, à descendre dans le royaume des morts. Tout est calme. Il n’y a que des grands volumes reliés, des registres, des livres de comptes. Il faut souvent se crever les yeux à lire, sous l’arabesque flamboyante des noms propres, des récits trop brefs, des romans avortés. J’arrache des pages, des bouts de phrases, je me sens intoxiqué par les émanations d’êtres humains, ahuri par le vertige des coïncidences, ramenant des noms de lieux, des indices dérisoires qui pour moi contiennent soudain une contrée fabuleuse, des monuments abandonnés, les herbes folles du passé. Je reviens en arrière, je progresse en zigzaguant, je trébuche, je tâtonne dans le passé. Je ne peux pas les abandonner, sinon ils se perdraient un peu plus, alors je continue à traquer les pistes. Je dois continuer, je ne peux pas les lâcher, sinon ils vont disparaître à nouveau, rompant le lien de plus en plus ténu entre les vivants d’aujourd’hui et tous ces morts dont personne ne veut comme s’ils n’avaient jamais eu de vie. » Un livre pour l’accueil des morts, et qui soit aussi, un peu, le livre de sa vie : l’air de rien, Prieur a réussi par là un très beau livre d’histoire, à la première personne.
Jérôme Prieur, La Moustache du soldat inconnu, Le Seuil (Librairie du XXIe siècle), 272 pages
