La Californie à l’âge de l’anthropocène
Elles respirent encore. Paupières closes, bouche ouverte, leurs petits corps d’enfant têtes bêches dans le grand lit, immobiles. Il faut se pencher tout contre leurs lèvres pour sentir leur souffle. Et se rassurer. Il est deux heures du matin, ce 8 août 2018, dans le village de NorthStar, près de Truckee, au nord de la Californie. Le Mendocino Fire, qui est en train d’engloutir près de 121 000 hectares (la taille de la ville de Los Angeles, douze fois celle de Paris), est à 335 km à l’ouest : loin, très loin pensions-nous. C’est, après tout, la distance entre Paris et Nantes. Et pourtant nous sommes envahis de fumées toxiques.
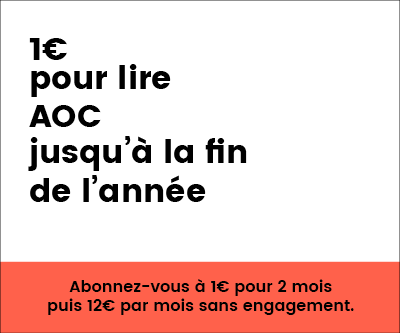
Ce devait être une semaine de villégiature estivale dans l’air pur des montagnes du Lake Tahoe, un lac dont l’eau cristalline reflète d’habitude les crêtes rocheuses de la Sierra Nevada, quatre heures au nord de San Francisco. Mais nous sommes cloîtrés depuis trois jours, les yeux rivés sur l’appli de airnow.gov qui actualise l’index de qualité de l’air (AQI) toutes les heures. Sur la carte qui donne en temps réel l’avancée des nuages délétères, Truckee est dans l’orange (indice de 100 à 150) et menace de virer au rouge : le taux de présence de particules fines et de monoxyde de carbone oscille dans la zone « unhealthy for sensitive groups », dangereux pour les enfants, les séniors et les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires. L’air est sec, râpeux. Je ne dors pas : après cinq ans de sécheresse, nous sommes au cœur d’une immense forêt de pins secs comme des allumettes. Et si un feu se déclarait ici ? Et si l’air devenait tout à fait irrespirable ?
Anxiété exagérée ? Je l’ai cru, dès que les vents deux jours plus tard ont tourné et dissipé plus loin, ailleurs, les effluves oranger qui piquaient la gorge. Pendant deux mois je tousse. On diagnostique une maladie respiratoire chronique. Et puis j’oublie.
Trois mois plus tard, un autre « méga-feu » s’est déclenché à moins de trois heures de route de San Francisco. Le 9 novembre, le « Camp Fire » avale les hectares au rythme d’un terrain de football par seconde. En moins de trois jours il est devenu le feu le plus destructeur et le plus meurtrier de l’histoire entière de la Californie. La mal nommée ville de Paradise, 27 000 habitants, a été entièrement rayée de la carte. Imaginons Montbéliard, Hénin-Beaumont ou Carpentras biffées d’un trait de feu du jour au lendemain. Lorsque la pluie viendra enfin aider les pompiers dans leurs efforts titanesques, deux semaines plus tard, l’incendie aura dévasté plus de 62 000 hectares (six fois la taille de Paris), réduit en poussières plus de 19 030 bâtiments, et tué 85 personnes, un chiffre appelé à grimper à mesure que les recherches se poursuivent dans les décombres. 52 000 personnes on été évacuées, ou plutôt ont fui tant bien que mal dans un chaos apocalyptique au milieu de couloirs de feu, parfois à pied.
La fracture environnementale épouse la fracture sociale.
Les torrents de fumée dégagés par les flammes se déversent immédiatement dans un couloir naturel qui relie Sacramento à la Baie de San Francisco, où ils stagnent et s’épaississent dans la cuvette de la baie, scotchés au plus près du sol par un anticyclone hors de saison.
L’odeur revient. L’odeur sèche, épaisse, asphyxiante, du bois brûlé, des pneus calcinés, des corps carbonisés. On ne peut s’empêcher d’y penser : ce qu’on respire, c’est aussi… eux.
On se calfeutre, fenêtres et portes closes, un jour, deux jours, dix jours. Le rituel recommence : vérifier la carte d’index de qualité de l’air, toutes les heures, même la nuit. Très vite, les masques N95 (censés filtrer jusqu’à 95 % des particules de moins de 0,3 microns) sont en rupture de stock. À mesure que s’accumule le smog, les purificateurs d’air intérieur s’arrachent. À $200 le modèle, seules les familles aisées ou les entreprises peuvent absorber la facture. Les masques taille enfants sont à $30. La fracture environnementale épouse la fracture sociale. Exode des plus fortunés vers des lieux où le premier luxe est de pouvoir respirer ; inégalités médicales criantes entre sans-abris (plus de 7500 à San Francisco), travailleurs manuels, et ceux qui ont un toit, un bureau climatisé, ou même juste une voiture pour s’isoler du marasme.
Pendant quelques jours, on habite le futur au quotidien. Nouvelles recommandations avant de partir pour l’école : se brosser les dents, mettre de la crème solaire, enfiler son manteau, son cartable… et son masque « Pro N99 issu de la technologie militaire » (fuchsia pour la cadette, à carreaux bleus pour l’aînée). De tout petits minois dont on ne voit plus que les yeux se rangent deux par deux devant l’école maternelle.
À Potrero Hill, l’une des sept collines de San Francisco, on peut admirer d’ordinaire Twin Peaks qui domine la ville 5 km à l’ouest, et même le Golden Gate plus au nord. En quelques jours ces symboles de la ville disparaissent, happés par la fumée dense.
L’air est à couper au couteau. Le vendredi 16 novembre, alors que les indicateurs de qualité de l’air crèvent les seuils et font de San Francisco la deuxième ville la plus polluée du monde après New Dehli, on ne voit pas à deux rues. On n’est plus dans le rouge, mais dans l’ultra violet (index 200 à 300) : « very unhealthy », très nocif, risque sanitaire pour la population générale, toute activité extérieure à proscrire. Nez qui coule, qui saigne, gorge rocailleuse, bronches qui sifflent, yeux éclatés de rouge au réveil, maux de tête, nausées, petits vertiges : les effets sont rapides, concrets. Dans la bouche, un gout de cendre.
Pour la première fois nous sommes « réfugiés climatiques ».
La carte des environs de San Francisco a viré au cramoisi sur des kilomètres à la ronde. Il faudrait conduire plus de quatre heures pour respirer un air tout simplement correct. Les écoles sont fermées, les rendez-vous sportifs annulés. Les musées à circuit d’air filtré ouvrent gratuitement pour accueillir les populations à risque. Il n’a jamais été aussi facile de se garer : en plein midi, même le quartier d’affaires downtown a des airs de ville fantôme. Les rares quidams en costume trois pièces portent de vrais masques à gaz. Plus de cris ni de rires dans les jardins d’enfants. Les balançoires pendent, vides, maculées de crasse toxique. On ne sort plus les chiens.
L’air est devenu tellement toxique qu’on décide de mettre les enfants à l’abri. On s’exile au sud, près de la mer, dans l’espoir que les embruns repoussent les fumées. Selon airnow.gov, l’air n’y est « que » « unhealthy », nocif pour les populations à risque, mais pas dangereux pour les autres. L’autoroute 101, qui déverse d’habitude les flots de « commuters » de la mégalopole, est étrangement fluide, nappée d’un brouillard orange qui donne au paysage des airs de planète Mars.
Pour la première fois nous sommes « réfugiés climatiques ». Réfugiés d’un jour, dans un hôtel aux chambres moquettées où l’on peut faire des roulades, sauter sur les lits Queen Size et regarder 135 chaînes, pas loin d’une plage et de manèges : du point de vue des enfants, cela ressemble surtout à des vacances improvisées, certes avec masques vissés au visage. Exil dérisoire et confortable au regard des dizaines de milliers de familles évacuées, déboussolées, qui ont tout perdu.
On attend la pluie. Au cœur de cette Silicon Valley qui ne jure que par la toute puissance de la tech, on prie comme le paysan du coin, comme nos aïeux immémoriaux, pour la clémence des cieux. La pluie pour laver le ciel de la suie, balayer les nuages de fumées faits par l’homme, diluer notre culpabilité, notre angoisse, dans un faux retour à la normale. 223 jours qu’il n’est pas tombé une seule goutte. Depuis 2012, une sécheresse presque continue a décimé 129 millions d’arbres : au cœur des forêts, un bûcher de bois morts de plus de 30 mètres de haut est déjà dressé. Le taux d’humidité des fourrés, des branchages, des plantes, des sols est au plus bas. Les arbres qui ne sont pas encore morts sont tellement desséchés qu’ils s’embraseront eux aussi à la première étincelle.
Les Californiens ont noté avec amertume la faible couverture médiatique de leur cauchemar. Le Camp Fire a fait plus de victimes que le tremblement de terre de San Francisco de 1989, qui avait mobilisé des équipes journalistiques et des donations du monde entier pendant des semaines. L’incendie, lui, n’a guère fait la une des journaux au-delà de la Californie. La temporalité et la forme du désastre ne coïncident pas avec celle des médias. Les méga-feux, masses informes et aléatoires, s’étirent sur plusieurs semaines et ne révèlent l’ampleur des destructions que lorsqu’ils s’achèvent : lorsqu’il n’y a, justement, plus rien à voir.
L’histoire qui importe (the real story) est à une autre échelle : c’est le choc entre Histoire humaine et Histoire géologique.
Les médias, eux, se nourrissent d’événements choc, instantanés, circoncis, qui offrent prise au récit et à l’image (attentat, tremblement de terre, hurricane, accidents de train). Mais ici, excepté le macabre décompte des morts, il n’y a plus, très vite, rien de nouveau à dire ni à montrer que l’avancée inéluctable des flammes, le répétitif constat des destructions. Ça tourne en boucle un feu. Vu de San Francisco, le trauma vient justement de cette lenteur de l’événement qui ne passe pas mais s’étend inéluctablement, dans l’espace et le temps, et nous fait croupir sous les cendres, à guetter une fin que tous savent à présent purement provisoire.
Rapidement les journaux se concentrent sur les témoignages de survivants, à la recherche de l’exceptionnel, de l’histoire incroyable (ce cheval qui a survécu en se réfugiant dans une piscine). Des micro-histoires qui laissent de côté la masse de conséquences sanitaires, environnementales, économiques, humaines, la nature structurelle, inéluctable de ces feux, les millions de personnes affectées. Et surtout le changement d’ère qu’ils incarnent. L’histoire qui importe (the real story) est à une autre échelle : c’est le choc entre Histoire humaine et Histoire géologique.
Ce feu s’éteindra. Mais les conditions qui l’ont rendu possible, prévisible, presque inévitable, restent intactes. Depuis 1980, la température moyenne en Californie a augmenté de 3 degrés Fahrenheit. Entre 1980 et 1990, la saison des feux cramait entre 120 000 et 160 000 hectares de forêts par an. En 2017, ce fut 566 000 hectares. Nouveau record en 2018 avec 730 000 à ce jour.
Le réchauffement climatique tue. Nous nous sommes habitués à fermer les yeux tant que c’était loin, tant qu’il affectait ceux qui n’avaient pas eu la chance de naître au bon endroit. En Afrique, en Asie, dans ces pays si différents, pensions-nous.
Suffoquer, survivre, fuir : c’est le lot, ici aussi, aujourd’hui, de Californiens, de voisins, de connaissances. De familles qui ont cru comme nous que respirer était une évidence, a given : quelque chose qui nous est donné, sans condition, comme le temps et l’espace où nos vies se tissent. Suffoquer, survivre, fuir : c’est le lot de réfugiés climatiques partout dans le monde, que nous n’avons jamais vraiment écoutés, regardés, interrogés.
Suffoquer, survivre, fuir : c’est ce que nous avons fait sur un mode mineur, et sans dommage, pendant dix jours.
La pluie est venue. On respire.
Mais nous sommes entrés pour toujours dans le futur.
