Springsteen on Broadway : l’autobiographie incarnée
Une courte distance géographique et un gouffre social séparent Mainstreet (Freehold, New Jersey) de Broadway (Manhattan, New York). De même que certaines populations enclavées dans les communes du fin fond du 9-3 ou du 9-4 ne mettent jamais un pied boulevard Saint-Germain, certaines familles ouvrières de Freehold n’allaient jamais à New York. C’était le cas des Springsteen. Le petit Bruce a grandi au milieu d’une vaste tribu d’ascendance italienne du côté de la mère et hollando-irlandaise du côté du père. Dans des maisons brinquebalantes et mal chauffées, ils étaient parfois dix ou quinze à vivoter, toutes générations confondues, parents, soeurs, oncles, tantes et grands-parents soudés sous la contrainte de la précarité. Papa Springsteen était ouvrier, chauffeur ou chômeur, selon les saisons et les courbes de l’emploi. Il était aussi alcoolique, dépressif, psycho-rigide, pur produit du patriarcat old school et d’un virilisme exacerbé. Il ne s’aimait pas, portait en lui la honte et l’amertume des vies grises et ratées, ruminait l’échec d’un père qui ne parvient pas à bien nourrir sa famille, ne comprenait rien aux désirs de son fils.
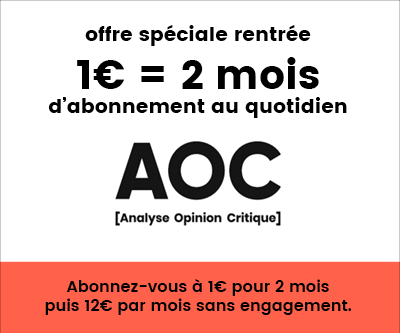
De son côté, la mère était secrétaire dans un cabinet juridique, et au contraire du père, elle était enjouée, gaie, fière et heureuse d’aller bosser tous les jours. Surtout, elle aimait la musique, les tubes jazzy-blues de l’époque et elle adorait danser. La future icône a ainsi grandi entre la honte et la fierté ouvrière, dans un univers étriqué, oublié, sans horizon, ce monde à la fois proche et lointain des périphéries et bleds perdus superbement décrit par Larry McMurtry (puis Peter Bogdanovich) dans La Dernière séance, ou plus récemment et plus près de chez nous par Nicolas Mathieu dans Leurs enfants après eux. Le père jupitero-lunaire et la mère solaire sont probablement à la source du tempérament « bipolaire » du rocker, écartelé durant toute sa carrière entre les hymnes festifs propres à faire danser tout un stade et les ballades sociales et mélancoliques qui pourraient inciter à se pendre si elles n’étaient aussi belles, justes et profondes.
Dans la maison Springsteen, il n’y avait pas de livres, seulement la radio et de temps en temps la télé : c’était là le bain amniotique culturel ordinaire de la classe ouvrière américaine des années cinquante, essentiellement façonné de standards jazz-pop et de sitcoms en noir et blanc, bref, le désert pour le petit Bruce de 8 ans qui préférait rêvasser au pied ou en haut de son arbre. Et puis soudain le rock a surgi, comme un séisme, un éclair, une révélation biblique. Pour le petit Bruce Springsteen, cette foudre s’est manifestée par la première apparition d’Elvis Presley au Ed Sullivan show : le blues et la country mixés, un chant sensuel, une beauté sauvage, un corps élastique qui hoquette et se démantibule, une énergie sexuelle… D’un seul coup d’un seul, un monde s’ouvrait pour Bruce, avec mille possibles, mille rêves d’ailleurs, mille chemins pour s’inventer soi-même.
Tout en ayant désiré le succès, Springsteen s’est toujours méfié des feux d’une gloire trop massive.
La suite de l’histoire est un peu plus connue. Après avoir transpiré quelques années avec différents groupes, joué dans des clubs, des facs, des patinoires, des bowlings, des hôpitaux, des bars et même des bar-mitzva, à Asbury Park et sur toute la côte du New Jersey, Bruce Springsteen signe en 1972 un contrat chez Columbia avec John Hammond – le type qui avait découvert Billie Holiday et Bob Dylan, rien que ça. Dès lors, sa carrière connait un crescendo régulier, depuis les premiers albums loués par la critique mais mal vendus au mégablockbuster Born in the USA (1984), en passant par Born to run (1975), le disque qui a mis Springsteen en couverture simultanée de Time et Newsweek, ou The River (1980), le double album qui a certifié son statut de dernier grand rocker classique, un peu à la façon dont Clint Eastwood peut être perçu comme le dernier grand cinéaste classique. Mais tout en ayant désiré ce succès, Springsteen s’est toujours méfié des feux d’une gloire trop massive, des malentendus et des pressions d’une notoriété trop forte.
En témoignent des albums comme Nebraska, Tunnel of love ou The Ghost of Tom Joad, oeuvres sombres, intimistes, musicalement à l’os, par lesquelles la megastar s’est employée à refroidir la chaudière du rock-business quand elle devenait trop brûlante. On pourrait citer aussi ses apparitions impromptues et récurrentes dans les bars du New Jersey où il vient taper le bœuf à la coule, comme jadis, ou encore ses innombrables dons pour des œuvres sociales locales. Tout au long de son parcours, Springsteen s’est toujours efforcé de garder une cohérence entre ses origines blue collar, ses actes, ses chansons et ses textes – si son paraitre et son statut social sont au niveau du nirvana des stars de « l’entertainment », son être profond est toujours resté fermement enraciné dans le sol ingrat du New Jersey prolétaire. Alors que la fracture entre les « élites » et le « people » est à la une des médias et des débats intellectuels, Bruce Springsteen a pour ainsi dire un pied de chaque côté de cette barrière supposée étanche.
De ce point de vue de passe-muraille social, l’évolution de l’arc de vie du chanteur est assez remarquable. Voilà un gars qui a grandi dans un milieu blanc, catholique, ultrapatriarcal et qui est devenu un symbole du progressisme, de la tolérance, de l’ouverture d’esprit, jouant avec des musiciens noirs quand la mixité n’était pas encore si fréquente, devenant l’un des premiers à soutenir publiquement le mariage gay, questionnant le masculinisme à l’ancienne dont il est en même temps une icône aux yeux de certains. « On fait partie de la classe ouvrière, on a toujours voté démocrate » disait sa mère. C’était une époque où les prolétaires blancs ne votaient pas encore Trump. Et au temps du trumpisme triomphant, Springsteen l’enfant de blue collar fut le supporter n°1 d’Obama.
Voilà un type qui a vécu gamin dans un foyer sans livre et qui est devenu l’un des plus grands écrivains de chansons de son temps, le grand chroniqueur de l’écart entre l’utopie du rêve américain et la réalité politico-sociale du pays, dont les textes sont désormais étudiés au lycée et à l’université. Après avoir passé sa vie à édifier une discographie qui est une autre forme de « grand roman américain », il a logiquement fini par écrire un « vrai » livre, Born to run, son autobiographie, l’une des meilleures du genre rock. Outre son talent de narrateur, Springsteen y dévoile avec honnêteté et courage ses épisodes dépressifs aigus, sans doute l’un des moteurs secrets de son inspiration et de son étonnante faculté à enchaîner des concerts de 3 ou 4 heures y compris ces dernières années, à bientôt 70 ans – et on comprend mieux désormais cette phénoménale endurance : plongé dans le tourbillon scénique et la grande communion avec son public, Springsteen n’a pas le temps de gamberger, de déprimer, de craindre de finir par ressembler à son père et de vieillir aigri et à demi-fou.
Après s’être produit partout Springsteen atteint à Broadway un genre de Graal géographique, professionnel et symbolique.
Pour ceux qui connaissaient bien le travail du monsieur, cette autobiographie (et sa qualité littéraire et introspective) étaient tout sauf une surprise : dans ses concerts comme dans ses interviews, le Boss lâchait toujours des bribes de sa vie qui se connectaient parfaitement avec ses chansons. Bien sûr, les textes de Springsteen ne sont jamais directement autobiographiques, ils mettent en scène des personnages fictifs mais inspirés de sa vie, de celles de ses proches, amis et connaissances, à tel point que son existence, ses chansons et son autobiographie finissent, sinon par se confondre, à tout le moins par former un ensemble d’une grande cohérence. Et c’est ce processus de miroir permanent entre la vie et l’œuvre qui atteint un sommet de cristallisation avec les shows de Broadway (désormais disponibles en cd, vinyles et sur Netflix).
Après s’être produit partout, des bouges du New Jersey aux stades du monde entier, Springsteen atteint à Broadway un genre de Graal géographique, professionnel et symbolique. Broadway, c’est le lieu sacré et prestigieux de l’entertainment américain, l’endroit où s’est forgé le « great American songbook » avec sa farandole de classiques chantés par tous les grand-e-s (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Bing Crosby, Louis Armstrong, Dinah Washington…), c’est le saint des saints de l’excellence et de la respectabilité de la chanson et du spectacle. Et c’était aussi ce lieu inaccessible pour la famille Springsteen, tant concrètement que symboliquement. Certains pourraient penser qu’en s’installant à Broadway, le Boss s’est embourgeoisé, a trahi le rock voire la classe ouvrière, a parachevé son institutionnalisation, voire son devenir-muséal : ce serait une vision facile et réductrice qui ne prendrait pas en compte les mécanismes sociaux et freudiens qui gouvernent une vie, et notamment une vie américaine, pays où le succès n’est pas un tabou mais un totem.
En se produisant ainsi pendant plus d’un an au Walter Kerr Theater, Bruce Springsteen soldait de nombreux comptes de sa vie : il prenait possession d’un lieu qui était « interdit » à ses ascendants, il allait au bout de la logique de ses précédentes tournées acoustiques en privilégiant la part littéraire et chroniqueuse de son art, il paraphait sa vocation à élever le rock au rang d’art majeur, manière de rendre au rock tout ce que le rock lui a offert. Le Boss à Broadway, ce sont les textes et leur sens plutôt que la performance physique et spectaculaire du rock à pleine vapeur, le Springsteen de l’intellect et de l’introspection plutôt que le Bruce du corps, des muscles et de la sueur. Ce show de Broadway, c’est à la fois le best of dépouillé de ses chansons clés et son autobiographie incarnée, c’est Born to run (la chanson) désossée par le grand âge de la sagesse et du re-souvenir et Born to run (le livre) mis en présence et en voix par un verbe qui se fait chair, c’est le songwriting, la musique, le théâtre et la vie de Springsteen fondus en un seul objet.
Entre les chansons se déploient de longs monologues comme des pages arrachées à son bouquin, tirades où Springsteen fait preuve de recul, d’humour et de détachement.
En déroulant ses classiques teintés d’autobiographie (Growing up, sur ses premières espiègleries de gamin, My Hometown, sur son bourg natal rongé par la dépression économique, My Father’s house, sur la présence intimidante de son père, Tenth avenue freeze out, sur sa rencontre avec Clarence Clemons…), le rocker fait tourner le film de son enfance grise et pauvre, des rapports difficiles avec son père taciturne autoritaire ou heureux avec sa mère joyeuse optimiste, du surgissement du rock qui l’a sauvé du déterminisme social et d’un destin promis à l’usine (ou au chômage), de la rencontre avec des misfits de son genre, passionnés de musique, qui deviendront les membres de son E Street Band…
Entre les chansons se déploient de longs monologues comme des pages arrachées à son bouquin, tirades où Springsteen fait preuve de recul, d’humour et de détachement par rapport à sa jeunesse de prolo et à son extraordinaire parcours de rocker superstar. « Je viens d’un endroit où tout était vaguement teinté d’imposture… Ainsi, je suis connu pour être monsieur Born to run (né pour fuir) alors que j’habite aujourd’hui à dix minutes de mon bled natal ! Mais Born to come back (né pour revenir), ça n’aurait intéressé personne !… J’ai écrit des dizaines de chansons sur la voiture alors qu’à 20 ans, je n’avais toujours pas le permis de conduire !… J’ai écrit sur la vie ouvrière et l’usine alors que je n’ai jamais de ma vie exercé un job de 9 à 5 ! ».
Ce faisant, Springsteen, s’autodéprécie, s’autocritique, s’autodémythifie, mais il le fait avec humour, mi-sérieux mi-vanneur. Ainsi, il ne faudrait surtout pas entendre dans ce type de propos, « je suis un imposteur, je vous ai menti dans les grandes largeurs durant toute ma carrière, vous pouvez jeter tous mes disques » mais plutôt, et en vertu de l’ironie qui les sous-tend, « j’ai un peu exagéré, j’ai créé tout un univers de fiction en chansons dont j’étais le metteur en scène, le scénariste et l’acteur principal, mais pas le personnage central. Mais cet univers fictif est néanmoins très proche du mien et si les protagonistes que je décris n’étaient pas moi, ils étaient inspirés par mes sœurs, mes beaux-frères, mes amis, mes parents, mes oncles, mes tantes… et ils auraient pu être moi si je n’avais pas connu le succès ». Un jour, en interview, j’ai questionné Springsteen sur l’écart entre ses personnages du bas de l’échelle sociale et sa condition de superstar richissime, écart que certains lui reprochent, et il a répondu peu ou prou ceci : « je n’ai jamais oublié d’où je viens et toute la richesse et célébrité du monde ne change rien à l’affaire. J’écris et je chante pour rendre honneur à mes parents ».
Cette classe sociale, il s’en est certes extirpé à la sueur du rock et au talent du songwriting mais le fond de sauce prolétaire reste attaché au fond de la casserole de sa psyché.
Ses parents « et les gens comme eux » aurait-il pu ajouter, héros ordinaires et anonymes du quotidien, qui triment pour de faibles rétributions financières et symboliques, qui sont au cœur du moteur springsteenien parce qu’on ne se défait pas aisément des vingt premières années de sa vie, celles qui vous ont façonné. Springsteen a beau avoir accumulé tous les honneurs et toutes les richesses, il porte toujours en lui comme un ADN les angoisses, les souffrances et les complexes de sa classe sociale et des stigmates familiaux au milieu desquels il a grandi. Cette classe sociale, il s’en est certes extirpé à la sueur du rock et au talent du songwriting mais le fond de sauce prolétaire reste attaché au fond de la casserole de sa psyché. Certains ne survivent pas à cette tension majeure entre une enfance de gueux et une vie adulte de roi (Elvis, Marilyn…)
Malgré les épisodes dépressifs sévères, Bruce Springsteen a non seulement survécu à ce grand écart social mais a réussi à intégrer cette dimension dans son travail, exemplairement dans son autobiographie et dans ce spectacle de Broadway : en se retournant sur sa vie et son œuvre, il pose toutes les bonnes questions. Peut-on réussir quand on est un enfant de prolo de Freehold ? Peut-on devenir un honnête citoyen, ouvert, informé et doté d’esprit critique quand on a grandi dans une maison sans livres et que l’on était un cancre à l’école ? Peut-on dépasser les déterminismes sociaux et culturels de son milieu ? Peut-on faire du rock une machine à danser et ressentir, certes, mais aussi à penser ? Peut-on être riche, célèbre, hyper-inclus et continuer à chroniquer les vies suffocantes des exclus de ce monde ? Quand on est parvenu au sommet de la pyramide sociale, faut-il persister à se poser des questions voire à sans cesse se remettre en question ? Peut-on être un patriote, aimer son pays, en être même devenu une des incarnations les plus vivaces, et néanmoins persister à continuellement l’interroger, le soumettre à inventaire, en dénoncer les dérives, en évaluer les réussites et échecs à l’aune des idéaux des pères fondateurs ?
Springsteen on Broadway pose toutes ces questions et y répond affirmativement, mais un oui complexe qui ne fait nullement l’impasse sur toutes les difficultés de ces questions et réponses. Sur Broadway, Bruce Springsteen boucle la boucle d’un parcours de vie et d’artiste assez exemplaire, mais en laissant la fin ouverte, comme s’il prenait soin de ne pas transformer sa vie en recette figée, en mode d’emploi valide pour chacun. Entre Freehold et Manhattan, une heure de voiture seulement, mais aussi une existence entière de luttes, d’échecs, de victoires éblouissantes, de doutes et de questionnements : telle est la route de Bruce Springsteen racontée sur Broadway, depuis les marges invisibles de la société jusqu’à son hypercentre, depuis l’anonymat des vies minuscules jusqu’au sommet scintillant de l’affiche, tour à tour triomphal tapis rouge et sentier caillouteux bordé de ronces. Tant que le Boss aura souffle de vie, ce chemin et ce cheminement continueront.
