Jean-Luc Godard : un essai revisite la période Mao – sur Godard. Inventions d’un cinéma politique de David Faroult
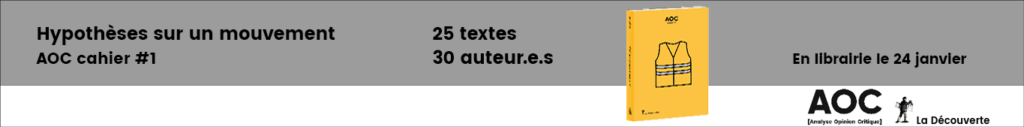
Comme pour Picasso, il est possible de distinguer des « périodes » dans le parcours de Jean-Luc Godard, bien que s’y inscrivent aussi des lignes de cohérence. L’une d’elles tourne autour des années dont Mai 68 est l’épicentre, qui ont vu le cinéaste opter pour le marxisme, se ranger politiquement du côté de l’extrême gauche, et mener une réflexion pour mettre en résonance révolution et cinéma.
C’est sur cette période, lors de laquelle le cinéaste se montre très productif, que David Faroult, maître de conférences en cinéma à l’Ecole nationale Louis-Lumière, a choisi de porter son travail de chercheur, dont le livre qu’il publie est le fruit longuement mûri : Godard. Inventions d’un cinéma politique. Même si les films de cette époque – qui s’ouvre avec La Chinoise en 1967, et compte notamment Le Gai savoir, British Sounds, Pravda, Vent d’est, Luttes en Italie, Vladimir et Rosa, ainsi que Week end, One + One et Tout va bien – sont facilement accessibles, ce moment de la production godardienne reste méconnu.
Comme le constate l’auteur : « entre basculements de la conjoncture politique et évolutions artistiques, un tournant est constaté a posteriori, mais cette étape communiste de l’évolution de Godard, à bien des égards décisive, demeure peu étudiée par comparaison aux autres, qui pourraient pourtant s’en trouver éclairées ».
C’est qu’elle est aussi considérée avec une certaine condescendance. Exemple : dans la biographie qu’il a consacrée à l’auteur d’À bout de souffle, Jean-Luc Godard, tout est cinéma (2010), Richard Brody écrit : « L’expérience de Godard dans ses années-là, et en particulier l’effort qu’il investit dans la réalisation de ces films, peut être comprise comme un ensemble d’antiscénarios, de scripts de rechange pour des films qui ne se feront pas — et cette expérience s’avère plus importante, du point de vue artistique, que les films eux-mêmes. » Or, loin d’une approche biographique – d’où le peu de lignes consacrées à l’affaire Henri Langlois, et encore moins à l’arrêt du festival de Cannes en 1968 – , c’est bien aux films réalisés, c’est-à-dire à l’œuvre de Godard en cette période, que s’attache David Faroult, y discernant, tels qu’ils sont, un profond intérêt.
On sait aussi que ces années 68 de théorie et de militance exacerbées sont, depuis plus de 30 ans, disqualifiées, quand elles ne sont pas stigmatisées, en particulier par ceux là-mêmes qui y figuraient aux premiers plans, endossant l’habit de « renégats » tels que les avait dénoncés Guy Hocquenghem dès 1986. Une doxa s’est ainsi peu à peu installée, dont le Godard de cette époque peut constituer une cible facile. Au mieux, on affirme paresseusement qu’il avait alors perdu son cinéma. Au pire, cela donne Le Redoutable, mettant en scène le réalisateur durant le mois de mai. Sous couvert d’iconoclasme, le film de Michel Hazanavicius s’attaque à la personne en falsifiant la réalité et prétend mettre au jour, non sans poujadisme, la misère de sa pensée, ou plus exactement ce que le film tient pour tel.
Pour autant, Godard. Inventions d’un cinéma politique n’est pas le fait d’un admirateur béat, fasciné par son idole. David Faroult ne cache pas sa réprobation vis-à-vis de certaines réflexions du cinéaste, « injustement méchantes, bêtement bourgeoises, sexistes, homophobes, paresseuses, idiotes, décevantes, conservatrices, essentialistes, ambiguës… » Mais il conteste les accusations sans fondement solide, comme celle, grave, d’antisémitisme, régulièrement renouvelée, jusqu’à l’obsession chez certains, et qui puise son origine dans un plan d’Ici et ailleurs (1974). Le film appartenant au corpus ici considéré, David Faroult saisit l’occasion pour déconstruire la séquence en question. Nous y reviendrons.
Godard. Inventions d’un cinéma politique n’est pas davantage une tentative volontariste de réhabilitation d’une part de l’œuvre, même si le livre invite à regarder celle-ci à nouveaux frais. Se démarquant de l’exercice critique, David Faroult analyse les films en apportant des données contextuelles, historiques et idéologiques, qui viennent les éclairer, et les confronte aux nombreux écrits ou déclarations, synchrones ou après coup, de Jean-Luc Godard. De même qu’aux propos de ceux qui ont travaillé auprès de lui, en particulier Jean-Pierre Gorin, avec lequel il a fondé le groupe Dziga Vertov et co-signé quelques films, dont Tout va bien (1972).
Dans cette perspective, l’auteur adjoint à son étude plusieurs documents, souvent inédits, comme le compte rendu d’une réunion de juin 1970 du groupe Dziga Vertov, et des traductions d’entretiens. « Le projet, écrit David Faroult, n’est pas d’évaluer, ni de “comprendre” ou d’expliquer l’œuvre de Godard, ni enfin d’élucider son “sens caché”, mais plutôt de situer, pas à pas, un parcours politico-cinématographique dans l’histoire qu’il a traversé. Il y a lieu de le faire, car cette œuvre, avec ses tâtonnements, ses apories, ses limites mêmes, a exploré et peut-être élargi les possibilités des arts politiques ». Projet amplement réalisé, au long d’un ouvrage fouillé, toujours clair et passionnant, qui renverse à l’occasion des idées arrêtées devenues des poncifs. Pourquoi n’a-t-il pas, jusqu’à aujourd’hui, reçu d’accueil critique dans la presse ? Mystère…
Peut-être pas toujours au fait de l’histoire du communisme dans ses composantes maoïstes ou marxistes-léninistes, le lecteur est reconnaissant envers l’auteur de ne pas l’abandonner dans ces arcanes.
Afin de mesurer le parcours politique effectué par le cinéaste, David Faroult remonte en amont et ouvre son livre avec À bout de souffle (1960), qui a révélé le nom de Jean-Luc Godard au monde entier. Le film est en adéquation avec les positions « apolitiques-donc-de-droite » que les Cahiers du cinéma, dont sont issus des cinéastes de la Nouvelle Vague, avaient adoptées via la politique des auteurs pour affirmer une lecture non influencée par les sujets réputés de gauche ou les appartenances partisanes.
Si À bout de souffle a une dimension révolutionnaire, celle-ci se situe strictement au sein du cinéma, autant du point de vue esthétique que technique, où le film « bouscule les usages et les règles », écrit Faroult. Quant au suivant, Le Petit soldat (1960), qui a pour objet la guerre d’Algérie, sa confusion au plan politique – qui ne manque pas d’être soulignée à sa sortie – est telle que Godard suspend pour un temps de s’aventurer sur ce terrain-là. David Faroult observe cependant une « souterraine politisation », dans la première moitié des années 1960, où le combat contre la censure étatique, très active, joue un rôle. Il décèle aussi dans certains films (Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande à part…) des indices qui montrent l’attraction qu’éprouve Godard pour ce que représente alors le Parti communiste. Tandis qu’il voit dans Masculin Féminin (1966) un « lyrisme sociologique ».
1967 est l’année du « tournant politique » avec La Chinoise, dont David Faroult s’empresse de nier la valeur prophétique qui lui est généralement attribuée, ce qui n’enlève rien, à ses yeux, de son importance. Il reste que Jean-Luc Godard y manifeste un intérêt précoce pour un courant politique émergeant, qui deviendra le maoïsme, « susceptible, à partir de la Chine, de reconfigurer les forces communistes autour de positions radicales à l’échelle plus vastes ».
Peut-être pas toujours au fait de l’histoire du communisme dans ses composantes maoïstes ou marxistes-léninistes, le lecteur est reconnaissant envers l’auteur de ne pas l’abandonner dans ces arcanes, dont le livre pourrait être lu, secondairement, comme un précis du « gauchisme », tant il fait preuve de didactisme pour donner à comprendre. Les querelles théoriques d’alors paraissent aujourd’hui picrocholines ; elles étaient essentielles dans une époque de grande intensité politique. David Faroult l’illustre, par exemple, avec cette grande figure inspirante que fut Althusser, désigné dans Vent d’est (1970) comme un « maître d’école révisionniste », alors que le film suivant, tourné quelques mois plus tard, Luttes en Italie, est l’adaptation d’un texte du philosophe.
C’est aussi le moment où Jean-Luc Godard change ses méthodes. À partir de La Chinoise, l’étape du montage devient déterminante – c’est là que la structure du film s’élabore. Il développe la technique des collages, dont les significations idéologiques sont toujours plus précises. David Faroult note, à propos du Gai savoir, réalisé en 1968, que l’évolution de ses collages témoigne, parmi d’autres indices, « de ce que le cinéaste inscrit de plus en plus délibérément son travail au sein de l’art politique ». En même temps, il s’agit de simplifier au maximum les motifs, un peu à la manière dont Brecht, référence récurrente pour Godard, incitait à ne pas produire d’« images du monde trop complexes ». Quitte à donner du grain à moudre à ceux qui n’y voient que du simplisme militant.
Or, beaucoup de ces films étant commandés par des chaînes de télévision, il faut, dans un « contexte télévisuel hostile », rappelle Faroult, « détonner » (au point que certains se verront empêchés de diffusion). Pendant toute cette période – dont la suite atteste qu’elle a, de ce point de vue, posé des jalons –, Godard n’aura de cesse d’interroger la fonction et les possibilités dialectiques du montage, questionnement placé sous l’opposition féconde de Vertov, l’auteur de L’Homme à la caméra, et d’Eisenstein.
Jean-Luc Godard a opté pour les positions du premier, consacré, si l’on peut dire, par le choix du nom du groupe qu’il contribue à fonder à la fin de l’année 1969, « Dziga Vertov », dont les éléments moteurs ne seront jamais plus de deux : lui-même et Jean-Pierre Gorin. Toujours plus proche du courant maoïste, le cinéaste met en cause la position sacro-sainte de l’auteur, statut qu’il a pourtant âprement défendu dans les années 1950.
À partir de Vent d’est, il fait disparaître son nom au sein de ce collectif. Mais cette volonté de rupture, qui traduit « une nouvelle pratique de production et de circulation des films » – « faire politiquement du cinéma politique », selon la célèbre formule – se heurte au fait que seul le nom de Godard permet de trouver des financements. En plus du contexte de repli du mouvement enclenché depuis Mai, cette contradiction ne permettra pas au groupe Dziga Vertov de s’imposer durablement : dès 1972, Tout va bien sera signé Godard-Gorin.
Comment déclarer la guerre au cinéma bourgeois ? Comment faire en sorte que les films viennent des ouvriers et non qu’ils leur soient seulement destinés ?
Godard. Inventions d’un cinéma politique montre à quel point ces années de radicalisation ne correspondent en rien pour le cinéaste à un temps de crispation. Au contraire, il y a quelque chose de remarquable, d’enthousiasmant même, à le voir dépenser tant d’énergie pour prendre en charge ses multiples questionnements du moment et tenter d’y trouver des solutions formelles, chaque film intégrant, en outre, son autocritique.
Comment déclarer la guerre au cinéma bourgeois ? Comment faire en sorte que les films viennent des ouvriers et non qu’ils leur soient seulement destinés ? Comment « rompre avec les formes dictées par l’appareil idéologique au sein duquel on agit » ? Comment « fabriquer des films qui puissent être utiles aux militants eux-mêmes : à l’élévation de leur autonomie politique, plutôt qu’à l’élargissement de leur audience » ? David Faroult nous fait avancer, « pas à pas » en effet, au long de ces interrogations qui se reflètent de films en films, jusqu’à ce que le maoïsme décline et que Godard prenne ses distances avec la démarche militante en même temps qu’avec Jean-Pierre Gorin.
Godard. Inventions d’un cinéma politique s’achève sur Ici et ailleurs, pour lequel le cinéaste, cette fois accompagné d’Anne-Marie Miéville, reprend, en 1974, des images tournées quatre ans plus tôt par le groupe Dziga Vertov. Prises dans les camps d’entraînement palestiniens en Jordanie, elles devaient entrer dans la constitution d’un film qui aurait eu pour titre Jusqu’à la victoire, laissé en suspend après les massacres de « Septembre noir ». David Faroult inclut Ici et ailleurs dans son étude parce que ce film clôt définitivement la période maoïste non seulement en s’en détachant mais en la critiquant âprement. « Apprendre à voir ici pour entendre ailleurs », dit la voix d’Anne-Marie Miéville. Godard reste solidaire des revendications du peuple palestinien.
Mais, « si un soupçon pèse dorénavant sur le dogmatisme des réflexes militants, les efforts misent sur la recherche inlassable d’une meilleure compréhension du fonctionnement du cinéma lui-même », écrit l’auteur. Lequel revient sur ce plan où le visage d’Hitler se substitue à celui de Golda Meir, dont beaucoup de commentateurs se sont emparés jusqu’à aujourd’hui, le jugeant indéfendable. « Ils isolent ce moment de son contexte aussi bien dans le film que par rapport à l’état de l’historiographie du nazisme en 1974 », objecte David Faroult. Qui détaille notamment une séquence précédente, où une main dépassant d’un cortège du Front populaire et le mot « populaire » sont isolés.
Puis « un glissement s’opère sur le portrait d’Hitler, tandis que la main, seule, semble dès lors évoquer un salut nazi. En déduirait-on que Godard assimile le Front populaire au nazisme ? » Plus loin, après une citation de Daniel Cohn-Bendit comparant, en 1968, ce que fait le président des Etats-Unis, Lyndon B. Johnson, au Vietnam à ce qu’Hitler a commis à Auschwitz, David Faroult écrit : « L’invocation d’une identité ou d’une comparaison avec le nazisme exterminateur était alors suffisamment répandue pour qu’un des mots d’ordre de Mai 68 restés les plus célèbres soit “CRS = SS”, lui-même apparu dans les grandes grèves de l’immédiat après-guerre ».
Quand, en 1968, François Truffaut tourne La Sirène du Mississipi, Claude Chabrol La Femme infidèle et Jacques Rivette L’Amour fou, Jean-Luc Godard choisit de se mettre au diapason des événements, et d’en intégrer la portée révolutionnaire dans son cinéma. Cela ne le rend pas plus méritant que ses collègues de la Nouvelle Vague. Pas moins pertinent non plus. L’ouvrage de David Faroult permet de prendre la mesure de l’importance de cette période dans le parcours du cinéaste de Rolle, où déjà sont en germe des idées nouvelles, comme celle qui donnera les fameuses Histoires du cinéma. Ne quittant jamais les rives du cinéma, Jean-Luc Godard a appréhendé ces années 68 ni en activiste ni en théoricien, mais en artiste.
David Faroult, Godard. Inventions d’un cinéma politique, éditions Amsterdam, coll. « Les Prairies ordinaires », 565 p.
