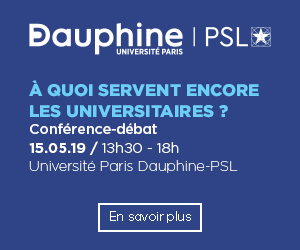Daniel Steegmann Mangrané, précis d’inexistence
Récemment, j’ai découvert un appareil à ôter les tiques. Il s’agit d’une toute petite fourche en plastique à deux dents. On place l’appareil sous l’insecte en essayant de coincer le rostre entre ces dents. Ensuite, il suffit – paraît-il – de dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, donc) afin de ne pas laisser les mandibules de la bête sous la peau. Je vais présentement faire la tique dans l’œuvre Daniel Steegmann Mangrané, visible jusqu’au 28 avril à l’IAC de Villeurbanne (« Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière ») et jusqu’au 6 mai à la Nottingham Contemporary en Grande-Bretagne. Merci de me dévisser à la fin.
Daniel Steegmann Mangrané est né à Barcelone en 1977 mais il travaille à Rio de Janeiro au Brésil. Certains magazines branchés prétendent que la forêt amazonienne est son atelier. Et c’est vrai qu’il aime bien les arbres et les insectes, surtout les phasmes, ces êtres étranges qui ressemblent à des brindilles et des feuilles jusqu’à être indiscernables. Ma première rencontre avec son œuvre remonte à l’hiver 2015. C’était à la Fondation Kadist (Paris XVIIIe) pour Kiti Ka’aeté (2011). Pour savoir ce qui signifie Kiti Ka’aeté, il suffit de demander au site de l’artiste : « Ka’aeté est le mot Tupi-Guarani pour la forêt profonde, qui est loin du territoire des hommes : c’est le lieu mythique où vivent les dieux et les esprits, où les chemins connus sont interrompus et où l’on ne pénètre pas. Kiti signifie couper avec un instrument tranchant, et donc par la main de l’homme, par la technologie. » Kiti Ka’aeté est aussi le titre générique d’une série d’œuvres, dont 16 mm et Phantom (voir plus loin).
En l’occurrence, ce Kiti Ka’aeté-là était un rectangle photographique de 17 x 13,5 cm, constitué de losanges assemblés représentant des vues de feuilles tropicales, collé en transparence dans un mur. Il ressemblait au résultat immobilisé d’un kaléidoscope dans la « Mata Atlântica » mais rétroéclairé, comme un vitrail. Je note l’entrée « Cathédrale » pour un futur dictionnaire D. Steegmann Mangrané. En tant que vieux mâle blanc linéaire et binaire, biberonné au cisgenre Marcel Proust, je pense en le regardant aux lanternes magiques, aux spectres, choses ondulantes et disparaissantes, mais aussi fuyant sur les murs pour mieux témoigner de leur inatteignabilité. Steegmann Mangrané titille en moi la pulsion scopique, ce que je retrouve dans ses pénétrables (prévoir aussi une entrée « Pénétration »). Mais si l’on coupe, de la main de l’homme, l’accès (déjà interrompu) à la demeure des dieux, cela fait peut-être moins par moins égale plus : une certaine façon de retrouver cet accès. Au moins en tant que désir, si l’on peut dire que cet accès laisse essentiellement à désirer.
Ma deuxième rencontre avec l’œuvre de Dani ne se fit pas attendre : c’était au Nouveau Musée national de Monaco, au printemps 2015, à l’occasion de l’exposition collective « Construire une collection ». Il y avait 16 mm (2009-2011), (’(^ (2014), qui ressemble un peu à / (- \, et Espaço avenca (2014), quatre branches très fines et nues d’un arbuste, entremêlées, déguisées en phasmes. 16 mm est une véritable expérience perceptuelle, qui met à bas les catégories de l’espace et du temps. Après avoir expérimenté la pulsion scopique, nous voilà à la place d’une caméra pénétrant le brouillon de la forêt vierge : nous sommes embarqués dans un travelling où le mouvement de la caméra (suspendue à un câble) est indexé sur celui du dévidement de la bobine du film, soit 18 cm par seconde. Cette coïncidence exacte de la durée et du parcours produit une sorte d’annulation, de flottement, de sentiment d’éternité perturbant : comme si l’on avait tout le temps de débrouiller le fouillis des feuillages ou plus exactement de se livrer à l’apophénie, cette liberté qui consiste à voir Satan dans les nuages ou le cul de votre voisin dans la Lune.
La seule abduction possible, à mon sens, devant 16 mm, est celle de notre disparition.
Si l’on veut faire l’intéressant.e, il pourra être utile d’aller chercher un article de l’artiste et théoricienne allemande Hito Steyerl : « Une mer de data : l’apophénie et la (mé)connaissance du motif » (2016). Celui-ci commence par une phrase provocante : « Ne rien comprendre à ce qu’on voit est la nouvelle norme. » À cela, Steyerl propose une solution : la bonne vieille apophénie ou hallucination volontaire. Et de s’appuyer sur Rancière et la distinction entre signal et bruit. L’apophénie fait son miel du bruit et de l’illisible du feuillage confus. Le signal, c’est la caméra sur son câble tendu, traçant une droite dans le bruit de la forêt, comme le note Benjamin Meyer-Krahmer dans le catalogue Animal que no existeix du CRAC Alsace (2015), créant une dichotomie entre culture et nature, géométrie et chaos, à laquelle il propose de substituer le concept de « gribouillage ». Ce dernier, en effet, n’est ni un vrai chaos – à cause de l’intention –, ni de l’ordre – puisque les informations contenues dans le gribouillage ne sont pas permutables.
Le sens du gribouillage (la jungle), argumente Meyer-Krahmer, ressortit plutôt à cette opération logique qu’a définie Peirce : l’abduction. À savoir, le fait de poser une hypothèse à tout hasard parce qu’elle semble déterminer la conclusion que l’on cherche (exemple : Satan comme hypothèse de mon observation des nuages cornus). Et de citer Peirce : « Il y a une masse de faits qu’on traverse, examine. Ce sont à nos yeux un nœud confus, une jungle impénétrable. Incapables de les envisager mentalement, nous tentons de les démêler par écrit. Mais leur intrication est si complexe que nous ne pouvons ni nous satisfaire de penser que ce que nous avons rédigé représente ces faits, ni avoir une idée claire de ce que nous avons écrit. Mais soudain tandis que, penché sur notre résumé, nous tentons d’y mettre de l’ordre, une idée vient : si nous supposions être vrai quelque chose que nous ne savons pas être vrai, ces faits s’organiseraient de façon lumineuse. C’est cela l’abduction. »
La seule abduction possible, à mon sens, devant 16 mm, est celle de notre disparition. C’est d’ailleurs à peu près l’effet que font tous les travellings qui ne cherchent pas à imiter les saccades ou le rythme de la marche (celui du début d’Hiroshima mon amour de Resnais, dans le couloir de l’hôpital) : ils nous sortent de notre corps, nous projettent en dehors du réel auquel nous sommes habitués. Le but avoué est même de nous fondre dans le monde, afin comme on l’a dit, de restaurer l’accès que la technique a tranché.
À la fin de la même année, chez Esther Schipper, à Berlin, j’expérimentai le tout neuf Phantom (Kingdom of all the animals and all the beasts is my name) : une reproduction en 3D pour Oculus Rift de la forêt amazonienne dans laquelle on pouvait se déplacer (un peu). Sauf que les arbres, les feuilles, étaient constitués de points de lumière, d’une sorte de matière céleste au travers de laquelle on passait. On était de fait privé de corps, virtualisé, disséminé. Là encore, une façon de nous faire penser « en forêt » puisque l’essai d’Eduardo Kohn est une référence obligée de l’œuvre de Daniel Steegmann. Dans un entretien avec l’anthropologue, l’artiste note de fait que « la pensée n’est pas seulement dans notre tête mais participe d’une plus large écologie de pensées », ce qui va avec ce constat : « Nous devons dépasser le paradigme actuel et la division stricte qu’il opère entre le corps et l’esprit, la nature et la culture. Le paradigme moderne est clairement arrivé à son terme : nous sommes tous confrontés à la crise écologique mais nous ne la dépasserons pas si nous n’essayons pas de penser différemment ». En cela, sans doute, les expériences que propose Steegmann Mangrané, qui visent à faire de nous des « animaux qui n’existent pas », peuvent aider.
À la 14ᵉ Biennale de Lyon, en 2017, l’artiste présentait A Transparent Leaf Instead Of The Mouth (2016-2017). Il s’agissait d’un vivarium où étaient installés des phasmes, ces insectes mimétiques auxquels Georges Didi-Huberman a consacré un article éponyme dans son essai paru en 1998 et que Steegmann place au centre de sa réflexion depuis au moins le film Phasmides (2012). Le phasme, en effet, ressemble en général tellement à une branchette ou une feuille qu’il est invisible. L’œuvre était donc parfaitement réussie, puisqu’on ne voyait rien (et qu’on était donc un peu déçu.e). Comme l’écrit Didi-Huberman, « le phasme a fait de son propre corps le décor où il se cache, en incorporant ce décor où il naît. » Il porte en lui le « démon de la dissemblance » : parce qu’il mange le décor où il vit, lequel devient en quelque sorte second et parce qu’on ne saurait l’envisager. Le phasme (« fantôme » en grec) est le fond qui est la figure, la copie qui dévore l’original. Bien sûr, on pourrait répondre que le phasme ne ressemble à une feuille ou une brindille que pour nous humains et quelques autres animaux mal finis tels les oiseaux. Peut-être que les fourmis et les araignées distinguent les phasmes aussi bien que nous les éléphants dans les magasins de porcelaines.
En 2008, Steegmann découvre cet insecte et par la même occasion que nos yeux nous trompent (il en avait ramassé un sur une branche et croyait l’avoir perdu avant de le voir réapparaître en secouant le support). Ou plus exactement que le réel est fragile, sa représentation encore plus (au cinéma, par exemple) et que les positions de sujet et d’objet sont au minimum interdépendantes. Il commence à faire des recherches et lit donc l’essai de Didi-Huberman. Dans un article de Roger Caillois pour Minotaure (« Mimétisme et psychasthénie légendaire », juin 1935), il trouve une autre piste : le mimétisme ne serait pas un moyen de défense contre les prédateurs (car il est inefficace la plupart du temps) mais, traduit Steegmann, « un désir de se dissoudre dans le monde ».
À l’entrée de « Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière » à l’IAC, le.la visiteur.e reçoit des retranscriptions de textes de la poète outsider Stela do Patrocínio (1941-1992) : « C’est pas moi qu’aime naître / C’est eux qui m’mettent à naître tout le jour / Et toujours quand j’meurs ils m’ressuscitent ». Patrocínio se sentait bien dans son état de « dissolution » explique l’artiste : mais revenir de sa psychose par la médication (quand on la « mettait à naître ») lui était une violence. Donc nous revoilà à la question de « l’animal qui n’existe pas » et sous une forme volontariste. Ou plutôt comme une résistance à la réapparition. On trouverait Stela do Patrocínio et ses délires au début de la carrière de Steegmann : en 2001 il installait Orange Oranges (2001), une tente à jus de fruit qui permettait de vivre une expérience sensorielle psychédélique grâce à sa perturbation de la vue. Et là encore, c’était moins le moment de la fonte dans le décor qui importait que le retour au réel, seul capable d’opérer un « état d’ouverture » : « L’art peut reconfigurer notre rapport à la réalité, déclarait Steegmann à Kohn dans le même entretien déjà cité. L’important n’est pas ce qui se passe durant l’exposition mais ce qui se passe quand on en sort et qu’on revient à la réalité. »
Le lieu développe son propre magnétisme : tournants que l’on évite ou qui au contraire invitent.
Pour « Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière », l’artiste a opté pour une version radicale de notre dissolution : nous avions été caméra avec 16 mm, puis avatar avec Phantom. Nous voilà à présent hors de nous-mêmes tout en restant dans notre corps, et dévorés par un espace blanc percé de lumière. En effet l’exposition de Villeurbanne, contrairement à celle de Nottingham, n’est pas un best-of. On n’y trouve que le film Phasmides projeté, au fond du parcours. Le reste, c’est de l’espace. On pénètre dans le hall principal de l’IAC, on pense à celui du Fridericianum de Kassel, habité d’un unique zéphyr créé par Ryan Gander pour la Documenta (13). Mais là c’est plus enveloppant, il y a comme un appel ou une mémoire à l’œuvre. Toute l’architecture du bâtiment a été redessinée, des cloisons ont été placées.
Daniel Steegmann Mangrané a dessiné les plans en une nuit, en superposant trois mouvements, indique-t-il, pour former une sorte de palimpseste où se croisent le parcours du.de la visiteur.e, celui de l’artiste et celui imaginé par l’architecte du bâtiment. Et il y a des coins, des angles ainsi créés, note-t-il, qui ont une gravité spéciale puisqu’on y retourne toujours sans faire exprès. Et de fait, j’ai testé, le lieu développe son propre magnétisme : tournants que l’on évite ou qui au contraire invitent. Recoins disparus de cette nouvelle épistémè de l’espace, qu’on ne découvre qu’au bout d’une demi-heure de… de quoi au fait ? D’existence pure et indélimitée. Déambulation. Les salles sont pourvues de cônes de lumière qui pénètrent l’espace, un peu comme si un rai tombant d’un vitrail se matérialisait dans une structure en bois. Pure géométrie, également. Quand on (re)découvre Phasmides, on se rappelle que les bestioles erraient certes dans le film sur des branches, mais aussi sur des formes blanches triangulaires en carton, sortes de pyramides primordiales, éléments d’une structure à venir. Peut-être que ces formes sont celles qui guident la lumière dans l’IAC. Peut-être que nous sommes ces phasmes sans fond ni figure.
Au début de son tube Mondes animaux, mondes humains (1934), Jakob von Uexküll commence par exposer le cas de la tique enceinte : celle-ci, réagissant à l’odeur de l’acide butyrique, se laisse choir du haut de sa tige d’herbe sur ce qu’elle pense être un mammifère. Si c’est chaud, parfait, elle reste. Elle trouve un morceau de peau pas trop velu et y enfonce la tête pour aspirer le sang. Puis elle pond et meurt. La tique est limitée à un ensemble de signaux auxquels elle répond et cet aller-retour constitue son monde. C’est pareil pour nous et tous les animaux. Ce qui ne nous sert à rien ne fait pas partie de notre Umwelt, de notre milieu. Si l’on superposait tous les milieux de tout ce qui vit, le monde ressemblerait à un chaos, note Uexküll. Si l’on enlève presque tout, comme dans « Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière », il y a peut-être une possibilité que je voie un peu mieux le monde comme la tique et que j’aie un peu distendu la boucle récursive entre mon Merkwelt (mon monde perceptif) et mon Wirkwelt (mon monde d’action). Qu’entre signe et bruit, j’aie abduit à coups d’apophénie.
Grâce à Dani, je suis désormais une tique qui pense différemment l’écologie.
Daniel Steegmann Mangrané, « Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière » exposition à l’Institut d’Art Contemporain jusqu’au 28 avril à l’IAC de Villeurbanne et jusqu’au 6 mai à la Nottingham Contemporary en Grande-Bretagne