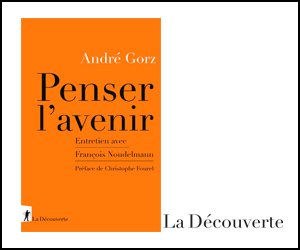Mythifier la violence pour mieux la voir – à propos d’Oreste à Mossoul de Milo Rau
Au départ, il y a Mossoul, cité antique détruite, point géographique et symbolique depuis lequel lire le monde et ses mythes, et non l’inverse. Il s’agit bien ici, dans cette Orestie irakienne, de mythifier le réel, et non de donner corps au mythe. De sorte que c’est « à la manière d’ISIS » qu’Agamemnon étrangle Iphigénie, « façon djihad » qu’Oreste commet son matricide : bourreau derrière, victime à genoux, tête couverte, l’histoire de la violence se raconte au présent chez Milo Rau, à travers ces formes physiques du meurtre – postures et costumes compris – désormais familières dans l’inconscient collectif, que sont les exécutions de Daesh.
Mais qu’allait faire Oreste à Mossoul ? La nouvelle création de Milo Rau cultive, comme à chaque fois, un art de la tension saisissant, par lequel le spectateur se confronte au paradoxe suivant : tandis que la virtuosité de la mise en scène nous plonge dans l’apnée de ses boucles dramaturgiques, nous immergeant dans l’espace scénique comme dans un lieu étanche au dehors, au réel, ce n’est que de ce dernier dont parle Milo Rau : du monde, de l’époque, de son hémorragie de violence. L’irréductible sauvagerie humaine, la substitution de la justice à la vengeance sont les clefs de voûte de cette Orestie irakienne qui, malgré de puissantes images, laisse un ténu sentiment de déception.
C’est l’un des paradoxes du théâtre de Milo Rau : la radicalité de ses sujets, conjuguée à l’habileté technique de sa mise en scène, absorbent le spectateur dans l’espace de la représentation, gangue pourtant inconfortable tant la monstration de l’insoutenable oblige celui-ci à interroger ce qu’il voit, à questionner sa propre pulsion scopique : c’est la force de ce théâtre, dont les images – scéniques comme filmées – engloutissent sans neutraliser, sidèrent sans fasciner. Pas un raclement de gorge, pas un froissement de manches, ce soir-là dans la salle, lorsque Agamemnon, à l’orée du spectacle, raconte le sacrifice de sa fille Iphigénie : le public retenait son souffle à l’unisson. C’est autant du malaise que de notre capacité à l’accueillir avec avidité que le silence, compact et dense, témoignait ce soir-là.
Alors que les lumières ne sont pas encore éteintes, le charismatique acteur belge à gueule défaite Johan Leysen, qui joue Agamemnon, évoque la genèse du projet, son rapport personnel à Mossoul, son rêve d’enfant de devenir archéologue. À la manière d’un pacte rousseauiste dans les Confessions, sa parole subjective institue le spectacle – semble instituer ? n’oublions pas qu’on est au théâtre – sous le signe de la vérité, créant un effet de distanciation néo-brechtien par lequel Milo Rau nous emmène au cœur de son chiasme, où le théâtre est réaliste et le réel théâtral.
L’universalisation de la violence vaut comme une prophétie auto-dissuasive, qu’il revient au théâtre de faire, puisque le politique n’en prend pas la peine.
Pourquoi re-présenter cette violence ? Si cette cérémonie dissécatoire des meurtres n’amène aucun doute sur sa nécessité, c’est qu’elle attire l’attention sur leur horreur : loin de les édulcorer, elle les extrait d’un contexte qui les banalise — Internet et son inflation d’images sans hiérarchie ; en mettant en scène la barbarie, Milo Rau la dote d’un surcroît de gravité, donnant à la violence un destin qui, loin d’aboutir à son fatalisme, alerte au contraire un peu plus sur son pouvoir et son danger : Hybris des Atrides, d’ISIS, du sang qui gicle, la sauvagerie humaine est bien un invariant de l’espèce, tandis que le désastre d’une ville lui donne l’air de ressembler à toutes les autres. Cette universalisation vaut comme une prophétie auto-dissuasive, qu’il revient au théâtre de faire, puisque le politique n’en prend pas la peine.
L’étranglement en temps réel d’Iphigénie en djellabah, à genoux, consiste en quatre minutes d’éructations insoutenables, de râles étouffés, jusqu’au poids sourd du corps qui s’effondre ; les hurlements d’Oreste qui appelle sa mère avant de l’exécuter dans un bain de sang, le film simultané du meurtre, images grises tirant sur le vert sale d’une caméra DV cheap, donnent à l’ensemble l’allure triviale d’un fait divers domestique, ajoutant au malaise palpable. Le réveil, en pleine nuit, d’Egisthe et Clytemnestre, effarés et terrifiés par les menaces d’Oreste, apporte un suspense rarement vu au théatre. Et ce qui déroute, dans cette danse macabre, c’est notre mutuelle fascination pour ces images d’horreur – celle du public, et, de toute évidence, de Milo Rau lui-même. La catharsis a beau justifier cette représentation, elle ne nous dédouane pas de cette séduction. Il y a du Marquis de Sade chez Milo Rau, dans cette manière d’exposer l’horreur dans une forme parfaite qui, sans l’esthétiser, la rend d’autant plus intense et manifeste.
Comment transposer un mythe « européen » au Proche Orient, sans tomber dans les deux écueils classiques ? Le risque, d’un coté, d’une position de surplomb, d’un écrasement de Mossoul par le mythe européen, du réel par le récit, d’une maladresse d’un parallélisme qui nie ceux qu’ils croient révéler. L’écueil, d’un autre coté, du culte condescendant aux martyrs, de l’autorité de la souffrance, d’un label – malgré les irakiens – d’intouchabilité inhibant un spectateur qui voudrait, comme si ça ne suffisait pas, trouver à redire.
Dans le sillage de Pasolini, qui avait en son temps, proposé une transposition du mythe en Afrique de l’Est, dans son film-essai Carnets de notes pour une Orestie Africaine, Milo Rau gravite au dessus de ces deux abîmes, les effleurant chaque fois sans jamais y basculer, rendant ce chemin des crêtes d’autant plus passionnant à suivre qu’il en surmonte toutes les ornières. Fascinant de voir son frôlement d’orientalisme (Cassandre, jouée par la comédienne irakienne Susana AbdulMajid, mangeant sensuellement avec les mains) sans jamais y tomber. Il y parvient en rendant les images hostiles, de sorte qu’on ne peut jamais s’y abandonner – y prendre plaisir : lorsque le joueur de Oud Suleik Salim Al-Khabbaz entame une mélodie, ce n’est pas la musique qui délecte mais l’effroi qui traverse à l’évocation de l’interdiction par l’État islamique de jouer, et à la nécessité qu’il avait de se cacher sous peine d’être tué. Cette intransigeance, il l’inflige à tous : le choix de rendre Oreste homosexuel a été difficilement reçu par les participants irakiens.
Si le tragique advient lorsque deux nécessités s’opposent, alors on est en plein de dedans.
Intenses et violentes, les images de Milo Rau troublent ; comme celle, filmée, d’une jeune irakienne, couverte d’un niqab, à qui le metteur en scène propose de jouer Iphigénie : un seul plan, un regard, et une multitude de sentiments contradictoires : absurdité et nécessité d’un plan si long sur un visage invisible ; sentiment d’une femme qu’on ne laisse pas apparaître – passant d’un masque à un autre – du niqab au rôle; intensité de son regard, de sa présence ; menace du noir, partout : en fond, sur elle, depuis ses yeux.
Seule la reconstitution du jugement d’Athéna (quant au crime d’Oreste), interprétée par une femme irakienne, est un peu lourde ; le jeu d’écho se prolonge: ce n’est pas le tribunal d’Oreste mais celui des djihadistes qui se déroule sous nos yeux. À un chœur de jeunes irakiens, elle demande : faut-il les pardonner ou les exécuter ? Un long plan sur leurs visages silencieux en guise de réponse. Si le tragique advient lorsque deux nécessités s’opposent, alors on est en plein de dedans.
Si l’on s’en réjouit sur le plan du réel – les victimes n’engendrent pas des bourreaux, le cycle de la violence semble suspendu – on peut seulement remarquer que la volonté appuyée de montrer cette perplexité – que faire, des djihadistes ? – aboutit à un sentiment quelque peu attendu et convenu : cette jeunesse irakienne, à chaud, voudrait la mort de ceux qui ont anéanti leurs vies, leur ville, mais sa force est sa raison, celle qui lui permet de différencier réaction et jugement, pulsion et jugement, vengeance et justice. Quelle autre réaction possible que l’embarras, à cette question posée par Athéna ? On imaginait – déjà – les irakiens refuser le déferlement de violence, même contre leurs bourreaux. Cette réaction, Milo Rau semble vouloir la (dé)montrer, geste un peu superflu qui frôle le surplomb.
Les frappes de Milo Rau sont telles qu’on en attendait peut-être trop : le spectacle déroule son analogie de départ, générant le plaisir d’un dispositif parfaitement maîtrisé, sans renverser des intuitions qu’on avait déjà. La subversion de ces intuitions – subir la violence ne transforme pas nécessairement en bourreau – subsiste toutefois par le doute qu’introduit le dispositif : cette perplexité du chœur irakien, qui semble si réelle, est-elle jouée ? Cet impossible choix entre pardon et exécution – où la justice, sommet par le milieu, peut commencer – est-ce du théâtre ou la réalité de sentiments vécus ?
Milo Rau a de l’audace : il envoie un pavé de trivialité dans la mare sacrée des mythes : lors du dîner de retour de Troie, Agamemnon et Clytemnestre évoquent des abattement de cloisons dans la cuisine, des changements de mobiliers, un cortège de remarques domestiques. Expédier les Euménides en quinze minutes, clore le spectacle de façon ultra-abrupte sur une fin à tendance transhumaniste (une opération physique par laquelle Oreste peut tout oublier), choisir, pour interpréter ce dernier, un comédien peu charismatique – renversement du héros ? –, Milo Rau assume, mythifie le réel tout en démystifiant le mythe, convoque une musique pop et sirupeuse (« mad world ») comme thème principal du spectacle : manière de dé-hiérarchiser les références, de pointer le dérisoire d’une époque qui ne fait le constat de ce « mad world » que par le chant.
Si le spectacle fonctionne, c’est aussi par la recherche constante dont il semble témoigner, l’éloignant de tout discours revendicatif ou didactique. L’implication des comédiens, professionnels et non professionnels, la pluralité des nationalités (conformément aux principes du Manifeste de Gand) dans un projet qui parle du monde, donnent l’impression d’un engagement total de leur part – engageant symétriquement, avec force, le spectateur. Une émotion réelle traverse l’attention avec laquelle ils se regardent, se considèrent — de la scène à l’écran. Composition extrêmement juste, ou vérité des rencontres? Sans doute les deux. C’est ce qui fait la force sourde du spectacle de Milo Rau (comme des précédents) : l’impression que le redoublement du réel, le théâtre, le faux ont crée du « véritable » réel.