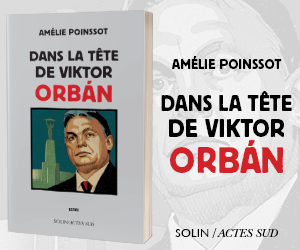Au Festival de Cannes, une journée particulière
Ce sera le mercredi 22 mai. La date n’est pas prise au hasard. Ce jour-là s’est concentrée une multiplicité d’événements qui cristallisent beaucoup de ce qui fait l’importance du Festival, et aident à en comprendre les enjeux. Cannes est la plus importante manifestation cinématographique du monde, par la qualité des films présentés, par son attractivité planétaire, par le nombre de personnes accréditées, par le diversité des rapports au cinéma qui s’y déclinent dans le triangle de la cinéphilie, du business et du glamour. Et c’est un cas à part dans la gigantesque galaxie des festivals de cinéma, dans la mesure où il est prioritairement réservé aux professionnels.
Être au Festival de Cannes, pas forcement en compétition officielle mais dans une des 6 sélections réunies durant 12 jours en mai au bord de la Méditerranée, peut changer la vie des films, et de ceux qui le font, davantage qu’aucun autre festival – et, à la différence des Oscars, tous les films peuvent espérer en bénéficier quand le concours pour les statuettes hollywoodiennes est réservé à certains types de produits très particuliers. Et les effets de Cannes bénéficient au cinéma dans son ensemble, à sa place dans le monde, à la capacité de comprendre ce qui s’y joue.
8h30 : Séance du matin d’un film en compétition, accessible à la presse sur présentation du badge idoine, et à ceux des accrédités qui se sont inscrits et ont retiré un billet. Ascension des marches sans tambours, trompettes ni photographes, juste les contrôles de sécurité, nombreux mais désormais très courtois et bien rôdés. Au programme, Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Et, très vite, la certitude qu’après une bonne semaine (la manifestation s’est ouverte le mardi 14), on se trouve en présence d’une offre de cinéma de première grandeur[1].
Depuis le début, les belles propositions n’ont pas manqué, en compétition (Atlantique de Mati Diop, Les Misérables de Ladj Ly, Le Jeune Ahmed des frères Dardenne, Les Siffleurs de Corneliu Poumboiu, Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles) ou dans les autres sections (Être vivant et le savoir d’Alain Cavalier, Zombi Child de Bertrand Bonello, Jeanne de Bruno Dumont)… Il ne s’agit donc pas de dire « ah enfin un bon film ! », on en a vu plusieurs, on ne doute pas qu’il y en ait encore au programme. Ce qui advient de singulier avec ce film est d’une autre nature : le sentiment, très largement partagé entre festivaliers (c’est rare, à Cannes) d’une sorte de plénitude dans l’accomplissement d’un contrat de cinéma.
Parasite n’est pas un chef d’œuvre, ce n’est même sans doute pas le meilleur film de Bong Joon-ho. Mais c’est le bon film au bon moment.
Quels sont les termes de ce contrat, évidemment non écrit, et qui ne devrait surtout pas être formalisé ? Un agencement dynamique d’éléments spectaculaires (comédie, drame, fantastique, violence), une capacité à évoquer des enjeux réels (injustice sociale, manipulation des apparences), l’accomplissement d’un parcours artistique personnel (depuis son deuxième film, Memory of Murder, le cinéaste sud-coréen a marqué par ses films les grands festivals internationaux). Séquence après séquence, Bong Joon-ho affirme sa réussite dans toutes ces dimensions à la fois. Secondairement, la réussite de son film conforte l’importance majeure de l’Asie sur la carte mondiale du cinéma, et en particulier la qualité de la production sud-coréenne, bien relayée par Cannes depuis la découverte de Hong Sang-soo et de Park Chan-wook.
Tout contribue à installer le sentiment que les étoiles se sont alignées. L’histoire à la fois burlesque et cruelle des membres d’une famille déshéritée s’infiltrant progressivement dans une riche demeure associe plaisir immédiat de spectateur, ouvertures à de multiples questionnements, et inscription dans des contextes (la carrière de l’auteur), l’importance du pays et de la région dont il provient, d’une manière qui s’impose comme une évidence – évidence dont on se réjouit à posteriori qu’elle ait mené à la récompense suprême, ce qui n’avait rien de garanti, toute l’histoire des palmarès cannois montre qu’un autre jury aurait pu choisir autrement. Parasite n’est pas un chef d’œuvre, ce n’est même sans doute pas le meilleur film de Bong Joon-ho (Mother y prétendrait à meilleur droit). Mais c’est le bon film au bon moment, qui réconcilie exigence envers un artiste singulier, plaisir du spectateur, et inscription dans une histoire plus ample, dont Kore-Eda a écrit un an plus tôt le précédent chapitre avec Une affaire de famille.
11h : au terme d’une marche aussi rapide que possible sur la Croisette (10 minutes pour le kilomètre qui sépare le Palais du Festival officiel du Miramar où sont projetés les films de la Semaine de la critique), arrivée ric-rac pour découvrir un premier film, sans rien savoir ni de l’œuvre ni de son auteur, un Chinois du nom de Gu Xiao-gang. Sur la scène, avec son air d’étudiant en 2e année il disparaît presque au milieu des nombreux membres de son équipe. Pour présenter le film, le délégué général de le la Semaine Charles Tesson, grand connaisseur des cinémas d’Asie, évoque rien moins que A Brighter Summer Day, le chef d’œuvre d’Edward Yang. Et il a raison. À mesure qu’on découvre la fresque immense qu’est Séjour dans les monts Fushun, s’impose l’idée qu’on est en train de découvrir un cinéaste de première grandeur.
Le titre du fil reprend celui d’un des plus célèbres rouleaux de la peinture classique chinoise, dite « de montagne et d’eau » (shanshui). Avec un sens impressionnant du rythme et des mouvements, du récit et de l’ellipse, ce jeune Gu compose un portrait de la Chine contemporaine en inventant des traductions cinématographiques aux grands principes esthétiques de la culture millénaire dont il est issu. Ici Cannes joue un autre de ses rôles, la découverte out of the blue d’un talent d’ores et déjà incontestable, et dont il y a beaucoup à attendre. Dans la salle, même si elle n’est pas immense, 10 critiques français parmi les plus importants, 20 critiques étrangers parmi les plus influents, 15 responsables de festivals venus d’un peu partout dans le monde, voient cela, comprennent cela. La vie de Gu Xiao-gang a changé, même s’il lui incombera désormais de faire avec son nouveau statut, ce qui est loin d’être facile. Et le cinéma contemporain dans son ensemble s’est, au moins un peu, transformé.
14h : Avaler une salade dans une brasserie. À la table d’à côté, des producteurs, des distributeurs et des animateurs de ciné-clubs commentent le tournant libéral qui menace l’organisation du cinéma en France, tournant annoncé par Emmanuel Macron lors d’un déjeuner avec les ténors des dites industries culturelles lundi 13 mai. La Société des Réalisateurs de Films a publié une série de textes alertant sur les dérives du pouvoir actuel, cherchant à obtenir des réponses, voire un soutien, des pouvoirs publics en charge du cinéma. 60 ans exactement après qu’à l’initiative d’André Malraux le Centre National de la Cinématographie fut passée de la tutelle du Ministère de l’Industrie à celle du tout nouvellement créé Ministère des Affaires culturelles, l’absence de retour est telle qu’un des articles s’appelle « Le CNC est-il encore notre maison ? » Cannes c’est aussi cela : des rencontres, inévitables et souvent utiles, nées de la simple présence de tant de gens concernés par les mêmes questions dans un si petit espace. A cette terrasse, l’heure est à l’inquiétude, où se mêlent tristesse et colère de n’être pas entendus par les instances qui sont supposées être les interlocuteurs, et les soutiens de ceux qui font le cinéma.
Changement d’humeur lors d’un bref détour au pavillon des Cinémas du monde, pour profiter de la machine à café, et croiser des amies de l’Institut français. Ici on se félicite de la qualité des projets venus d’Indonésie, de Jordanie, du Laos, d’Argentine, du Kenya, des échanges avec des producteurs, des scénaristes, des possibles coproducteurs. Ici on s’apprête à recevoir une trentaine d’éditeurs français dont des livres pourraient être adaptés à l’écran… Ici des camarades critiques et responsables de festivals indiens expliquent les risques pour le cinéma indien non mainstream suite au triomphe annoncé du BJP dans leur pays, un réalisateur brésilien décrit la destruction du secteur culturel par le gouvernement Bolsonaro. A une autre table, une directrice de salle néerlandaise raconte l’organisation de programmations pour sensibiliser les enfants à la crise climatique. Formation, information, création ou entretien de réseaux : ce sont, à côté des sélections prestigieuses, à côté des montées des marches sous les flashes, quelques unes des fonctions utiles que permet un endroit comme Cannes.
15h10 : Il est déjà temps de faire la queue pour accéder au Grand Auditorium Lumière du Palais, afin de voir la séance de 16h, pour découvrir le nouveau film de Xavier Dolan, Matthias et Maxime, en présence de l’auteur et de ses acteurs. Dolan, comme cinéaste, est né au Festival de Cannes, où la sélection à la Quinzaine des réalisateurs de J’ai tué ma mère en 2009 a révélé ce jeune prodige de 20 ans. Dix ans plus tard et avec son huitième long métrage, force est de constater une certaine répétition avec un film qui, sans démériter, n’apporte rien à une œuvre menacée de faire du surplace. C’est, aussi, un effet des grand-messes cinéphilo-médiatiques, et un risque auquel les meilleurs doivent savoir échapper.
18h30 : Projection pour la presse de Roubaix, une lumière, le nouveau film d’Arnaud Desplechin. Avec lui, et avec ce film, aucun risque de tomber dans le même travers que son jeune collègue québécois. Le cinéaste de La Sentinelle et de Conte de noël ne s’est jamais répété. Et, s’il creusait dans la plupart des ses réalisations un sillon reconnaissable, même si toujours inventif, il fait cette fois, du moins en apparence, un grand pas de côté, en accompagnant un policier responsable du commissariat de Roubaix, leur commune ville natale – commune au commissaire Daoud et au cinéaste Desplechin. Roubaix, une lumière est, au sens strict, un film exceptionnel, alors même qu’il semble emprunter une des plus habituelles voies de la fiction cinématographique, l’enquête policière dans un milieu urbain contemporain. Ce qui est exceptionnel ici tient à cet être double qui porte le film, cet être composé à la fois du cinéaste et du personnage principal, admirablement incarné par Roschdy Zem.
Roubaix, une lumière : difficile, dans toute l’histoire du cinéma, de trouver un film qui, sans rien esquiver des noirceurs du monde et des hommes, prend à ce point le parti de comprendre, contre le parti de gagner, ou de juger.
Avec une impressionnante virtuosité, le scénario met en place d’autres paires qui font écho et décalent à l’intérieur même du récit ce redoublement : le tandem contrasté que forment le commissaire expérimenté et le jeune policier venu d’ailleurs, le couple de jeunes femmes suspectes du crime qui occupe longuement les enquêteurs, et les spectateurs. Desplechin a toujours été un cinéaste dialectique, il en magnifie ici les ressources, non sans malice. Mais l’essentiel n’est pas ici. Il est dans la stratégie du film, telle que le policier et le réalisateur la mettent en œuvre de concert, même si chacun dans son rôle. Une stratégie qu’on appellera, faute de mieux, une politique de la douceur.
Difficile, dans toute l’histoire du cinéma, de trouver un film qui, sans rien esquiver des noirceurs du monde et des hommes, prend à ce point le parti de comprendre, contre le parti de gagner, ou de juger. La misère est là, la violence, le mensonge, la ruse, le meurtre. Au beau milieu, Desplechin-Daoud avancent, écoutent, regardent. C’est tendu, c’est effrayant, mais jamais la possibilité de s’imposer, de dominer – comme flic pour l’un, comme cinéaste pour l’autre – n’est la réponse choisie. Non seulement le commissaire Daoud est totalement étranger à l’idée de violence policière au sens habituel, mais il n’impose même jamais ni la force de sa position sociale et juridique, ni celle d’une intelligence plus acérée. Et s’il ne le fait pas, ce n’est pas d’abord, ou pas seulement pour une raison morale, mais pour une raison pratique : la vérité est à ce prix. Daoud n’est ni un héros ni un anti-héros, c’est un type qui invente la possibilité de ne pas relever de ces catégories.
Cette approche est aussi celle du metteur en scène, qui se refuse à capitaliser sur toute forme de geste (dans le scénario, l’utilisation des décors, le jeu des acteurs, le montage…) qui relèverait d’un coup de force, ou même seulement d’une manifestation de sa puissance comme réalisateur. Un tel parti-pris est d’autant plus radical qu’il est aux antipodes des postures transgressives, affichant une radicalité qui le plus souvent non seulement ne dérange personne mais renforce l’ordre établi, posture si communément exhibée dans les arts contemporains, cinéma compris. Roubaix, une lumière n’a pas gagné de prix au Palmarès, c’était prévisible tant le film déjoue tous les mécanismes du cinéma de fiction, tout en ayant l’air de s’inscrire dans son contexte. La douceur fait rarement gagner des points dans les compétitions.
Et si, à cet égard, on peut mettre en regard le film de Desplechin et celui de Bong Joon-ho, c’est pour pointer combien le premier déjoue le contrat spectaculaire, le troc libidinal de séduction, de prédation et de jouissance de cette prédation et de cette séduction, troc qui définit la position du spectateur y compris de tant de films magnifiques, et que Parasite pratique avec brio. Bien sûr la proposition d’Arnaud Desplechin restera aussi passionnante lorsque le film sortira en salle. Mais sa présence au milieu de tant de films, y compris très réussis, qu’organise le Festival de Cannes, met d’autant mieux en évidence ce qui s’y active de singulier, et d’infiniment audacieux.
21h : Diner avec des confrères américains, critiques du New York Times, de Film Comment, de Variety, d’IndieWire, … C’est un rituel amical, ce sont, si on veut, des mondanités. Mais c’est aussi très utile pour se frotter à d’autres sensibilités, d’autres manières de regarder le cinéma que celles fréquentées à longueur d’année avec des critiques français, parisiens. Leurs opinions, leurs réactions ne valent ni mieux ni moins que d’autres, elles aident seulement à mieux comprendre combien les mêmes films peuvent être perçus différemment au sein de contextes de réception différents. Et nulle part ailleurs qu’à Cannes ne coexistent autant de ces contextes différents. Deux heures plus tard, il faut quitter la table, comme chaque nuit, il y a un papier à écrire…