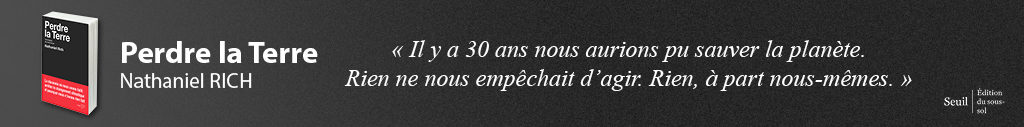La femme qui marche – à propos de Marcher jusqu’au soir de Lydie Salvayre
Il peut arriver qu’on entre dans un livre pour de mauvaises raisons, ou disons des hasards, la coïncidence d’un titre : Marcher jusqu’au soir, de Lydie Salvayre, a été pour nous de ceux-là. On nous l’avait recommandé, vivement, mais nous résistions un peu (avouons-le) devant le principe qui nous semblait artificiel d’une collection baptisée « Ma nuit au musée »… Et puis la curiosité l’a emporté, à cause de Baudelaire, d’abord, auquel est ainsi emprunté un bout de vers :
C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ;
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir…
C’est l’extraordinaire sonnet « La Mort des pauvres », dont il se trouve que nous avions nous-même cité la fin, un peu en douce, sésame discret d’un livre écrit longtemps dans l’idée du soir, de la nuit venant (Une nuit en Tunisie, si l’on peut s’autoriser à le mentionner ici). Marcher jusqu’au soir… ce titre magnifique prend son sens au bout d’un chemin qu’on emprunte en se disant, dans un premier mouvement, qu’on y retrouve la Lydie Salvayre de toujours, avec sa prose faussement orale, emportée, rhétorique et si maîtrisée, sans grande surprise pourtant : elle (s’)agace, module sa colère entre mots rares et mots crus, invective à l’imparfait du subjonctif, s’autorise encore toutes les coquetteries et jubilations de la révolte. Elle a accepté, en tout cas, le défi d’une « nuit au musée », le Musée Picasso, à Paris, où est exposée la célèbre sculpture L’Homme qui marche d’Alberto Giacometti. Qu’est-ce qui peut naître d’une telle expérience ? quel texte, quel choc, quel livre ? Il faudra, pour répondre et arriver « jusqu’au soir », passer par les étapes successives d’une sorte d’aventure intérieure, où d’abord il ne se passe rien – et c’est cela, bien sûr, qui est passionnant. Cloîtrée volontaire, prisonnière du moins consentante de l’institution, l’écrivaine doute, et met son trouble en mots, fait encore des phrases :
« Mais qu’est-ce que je suis venue foutre ici ? me demandai-je assez vite, d’art et de beauté lasse. À quelles sirènes ai-je cédé ? À quelles sirènes artistiques, à quelles sirènes littéraires ai-je eu la faiblesse de me soumettre, me demandai-je en laissant parler mon cœur ordinaire, tandis que mon cœur d’écrivain, plus endurant, plus apte à la patience que mon cœur ordinaire (…) me disait tiens bon ma fille, attends, attends encore un peu, prends le temps de t’acclimater à cette froideur et à ce silence, prends le temps de trouver tes marques, le bonheur d’admirer va finir par t’atteindre car la beauté est une flèche lente – je connaissais mon Nietzsche – et une heureuse inspiration va bientôt te saisir. »
C’est le constat du vide, avec un peu de pose, mais déjà du risque : le rien qui l’assaille réveille l’angoisse des origines, la peur jamais vraiment vaincue de l’illégitimité, l’immense orgueil aussi d’avoir gagné sa place au rayon – noble – des bibliothèques… Blessure sociale, retour au père, recours constant aux textes, comme pour s’armer encore contre le monde (Rilke, Hölderlin, le vieux compagnon Pascal, l’aimée Virginia Woolf…) : tous les livres de Lydie Salvayre, au fond, semblent aboutir à cette nuit à nu, si l’on peut dire. Et rien cependant ne se passe, nulle émotion ne survient devant la sculpture si fameuse, silencieuse et pourtant si parlante, a priori, de Giacometti : un blanc révélateur dans le noir de la nuit au musée, quelque chose peut-être comme un échec, un raté. Ce sont moins alors les questions générales que pose l’écrivaine – si importantes soient-elles : la part du déterminisme social dans le rapport à la culture, le musée comme espace problématique d’une expérience de l’art, etc. – que le récit personnel de son trouble, qui compte et nous emporte : comme une obligation à la sincérité, presque aux aveux. Le musée pour soi devient révélateur, épreuve, chambre de torture (plutôt que cabinet d’analyse) pour se dire telle qu’on se voit, vraiment, et admettre sa fragilité derrière les circonvolutions de la colère… Rappeler la blessure presque fondatrice d’un mot, par exemple, dans un dîner mondain – « Elle est bien modeste » – qui a touché à ce qu’on est et qu’on ne veut pas être : la violence sociale, dans sa pureté presque chimique.
Rien ne se passe, et c’est ainsi que tout arrive : Lydie Salvayre endosse d’une certaine façon l’échec de ce qui devait être une émotion programmée, elle franchit les portes de la nuit et son mot de passe est justement celui de modestie, déplacé, telle une épithète homérique, vers la figure même de l’artiste. Elle sort de la cellule, la chambre noire du musée – vide de tout texte « sur l’art » – pour se rapprocher de l’art en acte, s’identifier au sculpteur, faire le parcours de l’œuvre muette vers celui qui en a conçu le mystère – l’invitation. Et ce sont des pages captivantes, alors, d’appropriation pure et simple de Giacometti-le-modeste, à travers une sorte de compilation, ou plus exactement de montage d’éléments de sa vie et de son caractère, qui dépassent l’anecdotique pour glisser vers un autoportrait en miroir : celui d’un artiste littéralement impeccable, indifférent à l’argent, loin de toute préoccupation de « marché », riche seulement de son génie et aussi d’une forme de dinguerie… « Est-ce que je ne l’idéalise pas trop ? », se demande Lydie Salvayre. On veut croire que non : c’est bien parce qu’il préfère l’humain à l’institution – les gens plutôt que les musées, le chat sauvé de l’incendie plutôt qu’un Rembrandt, etc. – que finit par s’opérer avec lui une authentique rencontre. Marcher jusqu’au soir raconte cette rencontre, et c’est un peu une histoire d’amour.
Le chemin ne s’arrête pas là, pourtant. Le livre en effet décrit dans sa dernière partie quelque chose comme une révélation : L’Homme qui marche, en écho à l’expérience de la maladie qu’a connue Lydie Salvayre, désigne un point d’arrivée dont le titre du livre donne la clé métaphorique et baudelairienne : la mort. « La Mort des pauvres ». La mort partagée, simple, ce « terminus » dont le pressentiment, sans doute, a empêché l’écrivaine d’agir, réagir, sentir, dans sa si difficile nuit au musée. Et cette prise de conscience est comme une passerelle possible pour repenser la fonction de l’art, ou plutôt sa légitimité dans l’expérience qu’en proposent les musées, quel que soit le mal qu’ait pu en dire la romancière au départ de son parcours – presque de sa passion. Après un dernier détour de considérations sur la « mort du monde » (la fin programmée de la planète, notre quotidienne apocalypse écologique, etc.), elle peut en tout cas se confronter à nouveau à la sculpture qui s’était tue, et revoir son jugement sur un espace institutionnel désormais envisagé comme une voie vers l’impossible, cet évident idéal : « il arrivait que l’art ajoutât à nos joies et notre faim de vivre, il arrivait qu’il défiât souverainement la mort ou qu’implacablement il nous le rappelât, il arrivait qu’il aiguisât notre refus d’un monde où nos corps étaient formatés tout autant que nos âmes, il arrivait qu’il exaltât notre goût de l’impossible lorsqu’on nous intimait de ne plus l’espérer… ».
Peut-être un tel retournement semblera-t-il un peu artificiel, comme une forme de happy end imposé par la collection même, presque une manière de pirouette, forcément riche d’émotion, en tout cas éminemment sincère, dans l’espèce de foi qu’elle retrouve et veut communiquer. Les questions générales s’y résolvent dans l’affirmation d’une épiphanie individuelle : c’est bien de « Ma nuit au musée » qu’il s’agit, pour un livre qui ne saurait tenir lieu de manifeste ou de traité, mais qui dit avec une force assez formidable, et un culot magnifique, le dépassement des médiocrités dont les puissances du présent, hélas, ne cessent de nous assommer. Cette énergie vaut reconnaissance, qui fait croire au pouvoir des métamorphoses : que l’échec devienne beauté, dans une réversibilité qui nous redonne un peu d’espoir – nous en avons besoin.