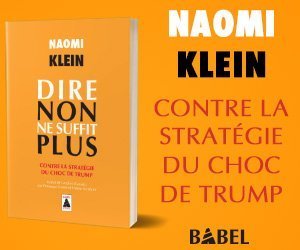Une autre lumière d’août – à propos de Heartland de Sarah Smarsh
Il y a quelque chose de faulknérien dans ce beau livre de Sarah Smarsh, Heartland. Moins introspectif, plus réaliste et autobiographique que le chef d’œuvre de William Faulkner, Lumière d’août (1932), il met en scène également une femme, Sarah Smarsh elle-même, et l’enfant qu’elle a décidé de ne pas avoir, et qu’elle prénomme August, en écho au cycle de la nature qui a bercé son enfance. Le Sud faulknérien laisse la place aux grandes plaines du Midwest, l’un des greniers à blé du pays ; les white trash de l’Ouest remplacent les rednecks du Sud. Tout comme Faulkner, Sarah Smarsh rend visible ces oubliés de l’Amérique dont elle fut dans sa jeunesse.
Pour sa fille imaginaire, elle raconte la vie de femmes sur plusieurs générations dans les terres, ingrates et pauvres, du Kansas. Contrairement au projet faulknérien, Smarsh a des visées sociologiques et politiques immédiates : elle ambitionne de donner des clés pour comprendre ce monde rural en colère, rendu récemment très visible avec l’élection de Donald Trump à la présidence en 2016. Ensemble, la richesse fictionnelle, sociologique, politique et féministe fait de Heartland l’un des ouvrages les plus intéressants pour comprendre l’Amérique contemporaine.
Avant tout, le livre est un récit autobiographique. Sarah Smarsh narre son parcours de « transclasse » qui l’a conduite de la pauvreté des comtés ruraux aux élites universitaires et journalistiques dans le pays le plus riche du monde. En s’adressant à sa fille, elle évoque le parcours des femmes de sa famille dont le parcours fut étonnamment similaire tout au long du XXe siècle mères trop jeunes, malheureuses en couple, dures à la tâche. De la crise de 1929 au triomphe du néolibéralisme dans l’Amérique de Ronald Reagan, leur monde ne cessera de se dégrader.
Si l’auteure n’est pas sociologue, elle en possède l’acuité du regard.
La « modernisation » des campagnes avec l’essor de l’agro-business contribuera à les marginaliser et à les endetter encore plus. Fragilisés par le capitalisme dominant, les hommes perdent leur raison d’être sociale en ne pouvant subvenir aux besoins de la famille. Les familles implosent de l’intérieur et se recomposent souvent de manière chaotique. Mais la famille élargie demeure souvent un point de stabilité dans une communauté profondément disloquée par l’exode rural, la mécanisation et l’individualisme. Les grand-mères, les tantes ou les sœurs sont très présentes dans le récit de Smarsh, et jouent un rôle affectif particulièrement important. L’Église incarne l’autre élément de continuité dans ce monde en plein bouleversement. Car, dans les comtés ruraux du Midwest, où l’éthique du travail et de la responsabilité sont particulièrement fortes, nul ne se tourne vers le gouvernement fédéral ou l’assistance sociale. Sa mère accumule les petits boulots après son divorce pour offrir à ses enfants une vie décente, et fustige les « reines de l’assistance » (welfare queens) auxquelles elle ne veut surtout pas être assimilées.
Ce regard de l’intérieur sur la pauvreté constitue une plongée sociologique dans l’autre Amérique – cette Amérique pauvre, composée majoritairement de Blancs. Si l’auteure n’est pas sociologue, elle en possède l’acuité du regard. Avec finesse, elle offre une lecture compréhensive, au plus près des actrices et des acteurs ; avec justesse, elle rappelle l’intériorisation de la culpabilité et de la responsabilité par les pauvres eux-mêmes. La pauvreté est vécue comme une honte sociale au pays de l’abondance. Comment est-il possible d’être blanc et pauvre aux États-Unis ? La réponse est toujours individuelle et renvoie à un échec personnel. À aucun moment, les forces structurelles à l’œuvre ne sont mises en cause pour protester contre cet état d’inégalités. Les pauvres, nous dit Sarah Smarsh, s’en accommodent sans remettre en cause le système qui a produit ces mêmes inégalités. De très belles pages sont consacrées aux stratégies de ruse pour vivre décemment, pour faire vivre toute la famille, pour ne pas montrer sa pauvreté en public. Jusqu’à l’université, Sarah Smarsh s’ingénie à masquer son milieu d’origine et avoue sa gêne à recevoir une bourse au mérite pour petits blancs pauvres (White Trash Scholars), comme la surnomme les autres étudiants du campus.
Smarsh livre un intéressant réquisitoire politique pour celles et ceux qui, comme elle, ont été attirés par le vote conservateur, par ces candidats qui défendent leurs valeurs et ne les méprisent pas à longueur de discours.
En raison de son approche compréhensive et réflexive, Smarsh refuse toute lecture héroïque. Elle ne cache rien des violences faites aux personnes elles-mêmes, notamment aux femmes, et aux corps. L’accoutumance aux médicaments et aux antidouleurs fait partie du quotidien d’une population usée par les échecs répétés et l’invisibilité croissante dans le pays.
Au fil des chapitres, Smarsh livre un intéressant réquisitoire politique pour celles et ceux qui, comme elle, ont été attirés par le vote conservateur, par ces candidats qui défendent leurs valeurs et ne les méprisent pas à longueur de discours. Elle rappelle que c’est à un président démocrate, Bill Clinton, que l’on doit la réforme de l’assistance sociale de 1996, réforme dont les conséquences seront de culpabiliser encore plus les plus démunis. Le succès du conservatisme et la victoire contre l’URSS ont renforcé l’idée d’un pays sans classe sociale. Dans son enfance, autour d’elle, tout le monde pensait appartenir aux « classes moyennes ». Les white trash, ce sont les autres ; ce n’est que des années plus tard qu’elle prendra conscience de son état de pauvreté et de l’existence de classes sociales dans le pays le plus riche du monde. Un jour, sa mère la gronde même en l’entendant fredonner une chanson country à succès (Trashy Woman).
Cette dépolitisation des débats et son corollaire, le mythe américain d’une richesse partagée par tous, expliquent le paradoxe politique de petits blancs pauvres votant pour des élus républicains qui les appauvrissent encore plus. Dans un ouvrage célèbre également sur le Kansas, What’s the Matter with Kansas, écrit en 2004, le journaliste Thomas Frank y voyait le résultat d’une manipulation des élites ; plus compréhensive et pragmatique, Smarsh renvoie à l’incapacité à construire une explication du monde qui intégrerait les inégalités entre classes sociales. C’est grâce à un cours de sociologie à l’université qu’elle s’est mise à remettre de la politique là il n’y avait que de l’émotion et de l’irrationnel. Sans honte, sans culpabilité, désormais, elle est devenue une citoyenne à part et une femme émancipée.
Car ce livre est pour finir un remarquable réquisitoire féministe. Sans surplomb, avec beaucoup d’empathie, elle dit tout son amour pour « la femme blanche pauvre : clope à la bouche, bébé sur la hanche, porte moustiquaire de la caravane tenue ouverte avec la jambe. » Ce portrait de sa grand-mère et de sa mère aurait pu être le sien et celui de sa fille imaginaire. En refusant la maternité, l’auteure rompt le cercle vicieux de la pauvreté que connurent toutes les femmes de sa famille avant elle. Sarah Smarsh réinvente ainsi un espace des possibles où le politique reprendrait le pas sur la domination économique et les mirages culturels. Comme l’héroïne de Faulkner, le voyage redonne du sens à un monde qui l’a perdu. Il reste désormais à rendre la lumière aux millions d’hommes et de femmes qui vivent dans la grisaille.
Sarah Smarsh, Heartland, traduit de l’américain par Hélène Borraz, Christian Bourgois éditeur.