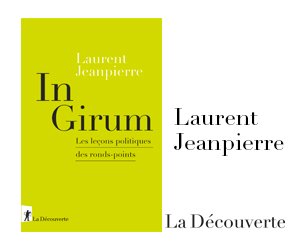Et au milieu coule le Brexit – sur Le Cœur de l’Angleterre de Jonathan Coe
N’en déplaise aux populistes d’outre-Manche, pressés d’en finir au plus vite avec la dictature (sic) bruxelloise, il coulera encore beaucoup d’eau sous les ponts de la Tamise avant que le Brexit ne fasse sentir la totalité de ses effets. Parmi les plus délétères d’entre eux figure au premier chef celui-ci, à savoir que, le jour venu, quelque chose de l’ordre d’une identité nationale composite, stratifiée, et, partant moderne, se verra bel et bien soustraite du substrat commun, débouchant, qu’on le veuille ou non, sur une perte autant collective qu’individuelle.
Aux Anglais, sommés de se détacher de leur arrière-pays continental, il sera dérobé quelque chose, une part intime, et essentielle, d’eux-mêmes leur sera retranchée ou prélevée, et ce, à vif, c’est-à-dire sans anesthésie. Seul un romancier de la trempe de Jonathan Coe pouvait exprimer la réalité d’une telle amputation avec la force et la netteté requises. Laquelle force n’exclut ni les nuances, ni les hésitations. Ainsi, il arrive que son dernier roman en date, Le Cœur de l’Angleterre, s’égare du côté d’une certaine nostalgie anglo-anglaise, celle-là même au nom de laquelle le Brexit fut finalement adopté, le 24 juin 2016 (par seulement 51,89% des votants, rappelons-le).
Tendre et rageur, choral et subjectif, tranchant et empathique, prévisible tout en se révélant inattendu, Le Cœur de l’Angleterre donne à réfléchir autant qu’à rire.
Tout autre, pourtant, est son propos. En apparence, du moins, le romancier tire à boulets rouges sur la somme des politiques (et des politiciens) qui ont précipité cette issue, en « cassant » le pays, en creusant de plus en plus les fractures de tous ordres (générationnel, familial, sociologique, géographique, économique…) et en soufflant sur les braises de la haine, raciale entre autres. Ce faisant, il s’interroge surtout sur le devenir du bien le plus précieux entre tous, à savoir le vivre ensemble, ce qui fait lien, en l’occurrence, ce qui fait nation. Et si réserves il peut y avoir, elles tiennent à la méthode retenue, et n’entament en rien le plaisir pris à cette impitoyable radiographie d’une Angleterre du milieu (Middle England, dans l’original), comprenons des Midlands, proche de celle d’un Tolkien, qui en avait fait le territoire des hobbits. Mais c’était autrefois…
Tendre et rageur, choral et subjectif, tranchant et empathique, prévisible tout en se révélant inattendu, Le Cœur de l’Angleterre donne à réfléchir autant qu’à rire. Il s’ouvre en avril 2010 et se clôt en septembre 2018. Mais c’est à saisons renversées qu’il se déploie, d’un printemps de deuils et de déclins à un automne possiblement de renouveau. Chacune des séquences constituant la matière première de ces annales, en somme, suit la précédente à raison de deux ou trois mois d’intervalle, mais c’est parfois davantage – jusqu’à deux ans dans le cas le plus extrême. C’est dire si le romancier prend ses aises, exerçant souverainement sa liberté d’aller et de venir, glanant en chemin ce qui constituera sa pitance et celle de son lecteur.
Au menu, des moments plus incontournables que d’autres – généralement des occasions de cohésion et de consensus, aux fins de contrecarrer la désunion accélérée du royaume, comme par exemple la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, et sa retransmission à la télévision. S’y renoue, bien trop fugitivement, l’unité nationale, au prisme des standards du rock et de la pop anglaise – au passage, la bande-son du livre, de Shirley Collins à Amy Winehouse, en passant par les Animals et Shirley Bassey, est l’un des atouts maîtres dans la main du romancier. Au mitan, ou presque, de ces huit années de vie communes, décisives comme jamais elles ne le furent dans un passé récent, se tient la journée du référendum de juin 2016, soigneusement évitée, stricto sensu, mais vers laquelle tout converge, en amont, et d’où tout procède, en aval.
Au milieu, donc, coule le Brexit, accusé de tous les maux, et donc de couler l’Angleterre qui en a accouché, mais ce dernier n’est jamais, telle est du moins la conviction du romancier, que le symptôme d’un mal plus profond, dont l’origine se situe en 1979, avec l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Et Coe de tenir la chronique, mi-fictive, mi-réaliste, de ces années colère où l’État-providence achève de se désintégrer. Nous sommes doublement en pays de connaissance. D’abord parce que l’histoire en est récente, et que cette chronique, c’est aussi, un peu, la nôtre, de ce côté-ci de la Manche. Qui ne voit en effet combien le mouvement des Gilets jaunes a fait éclater au grand jour une colère assez comparable à celle qui s’est exprimée dans les urnes anglaises ? Ensuite, parce que Jonathan Coe renoue avec le personnel romanesque des bestsellers par lesquels il s’est fait connaître, en France tout particulièrement.
De fait, par maints côtés, le projet à l’origine d’au Cœur de l’Angleterre s’apparente à une reconstitution de ligue dissoute. Les ligueurs en question tenaient déjà le haut du pavé dans Bienvenue au Club et Le Cercle fermé, romans férocement satiriques, et les voici opportunément remis en selle, selon un procédé, celui des personnages récurrents, popularisé en son temps par Balzac. Précisons, à toutes fins utiles, qu’il n’est franchement pas nécessaire d’avoir lu les romans antérieurs pour saisir tout le sel de la présente intrigue.
Le premier à remonter des brumes du passé est donc Benjamin Trotter. Désormais quinquagénaire, il vit seul dans un moulin, sur les rives de la Severn. Divorcé, il écrit, mais il se trouve à la tête d’un roman impubliable de mille pages. À la fin du roman, Rose sans épine a pu voir le jour, une fois dépouillé de tout ce qui l’encombrait – il a même figuré un temps sur la longue liste du Booker Prize, et Benjamin a désormais le projet de monter un atelier d’écriture créative dont il serait l’enseignant en titre. Cet atelier, il va l’ouvrir dans un vieux moulin, situé sur les berges d’une rivière… mais française cette fois, puisque qu’il s’agit de la Sorgue, dans le Vaucluse cher aux bobos. C’est dire si, malgré son canevas d’apparence préétablie, Coe parvient à surprendre. De fait, ce sont deux ou trois surprises qu’il nous réserve. Pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur, on glissera pudiquement sur la dernière.
Tous les moyens sont bons, semble-t-il, de la part de l’écrivain, pour exorciser la fatalité du Brexit, ce poison, ce cancer qui n’en finit pas d’infecter le body politic anglais. Et s’il est vrai que le romancier dispose de tous les pouvoirs, y compris celui d’accoucher d’une humanité nouvelle, alors acceptons-en l’augure… De l’avant-dernière surprise, en revanche, on peut parler. D’autant plus qu’elle nous concerne, nous autres Français. Sans (trop) crier gare, le personnage de Benjamin, le plus proche de l’auteur, assurément, et le roman en sa compagnie, migre, franchit allègrement la frontière (tant qu’il est encore loisible de le faire sans contraintes ni paperasseries superflues), laissant derrière lui un pays profondément déchiré et meurtri pour se transporter en France, l’autre pays des rivières (et des fromages, plus accessoirement). Dans un autre vieux moulin, bientôt baptisé The Rotter’s Club, histoire d’enfoncer le clou. Pour l’heure, l’atelier n’a qu’un seul élève inscrit, Alexandre, qui écrit des nouvelles en français, langue que Benjamin, le romancier d’un seul livre, ne lit pas… Il fallait bien cette ironie de dernière minute, prestement évacuée d’un revers de la main par la sœur de l’écrivain, pour faire passer, tant bien que mal, la pilule de cette transplantation que rien ne laissait présager !
La coloration, qu’on veut croire ironique, des scènes finales, troussées à la façon de Cédric Klapisch dans L’Auberge espagnole, en dit long sur les illusions auxquelles peuvent conduire l’idéalisation, quand ce n’est pas la naïveté en matière d’« harmonisation européenne ».
Entendons-nous bien. Quoique moins affirmée que celle d’un Julian Barnes, la francophilie de Coe est réelle, n’en doutons pas. Il est familier, par exemple, des Rencontres de la Villa Gillet, à Lyon, qu’il transpose fort habilement à Londres par le biais de la fiction. Sa connaissance de Marseille, essentiellement le campus, près de la gare St-Charles, mais aussi la Cité radieuse, les îles du Frioul, sans oublier Aix, lui sert à camper l’un des épisodes les plus réussis de la saga amoureuse de Sophie, la nièce du romancier.
À certains moments, Coe semble hésiter : entre la fiction et l’analyse, la critique socio-politique et le roman de mœurs, le pastiche et la vérité historique avec laquelle il est bien tenu de composer.
La troisième surprise n’en est pas vraiment une, à la réflexion. Elle tient à la forte probabilité d’une suite bientôt donnée au Cœur de l’Angleterre. Tout le talent de Coe, et il est grand en la circonstance, se trouve mobilisé en cette fin de parcours, de façon à garder toutes les options ouvertes, au premier chef celle d’un prolongement romanesque. À coups d’interrogations faussement hésitantes, de modulations toutes en retenue, s’énonce la quasi-certitude d’une suite à ce qui se veut déjà la suite d’une suite. C’est assez téléphoné, argueront les uns, c’est subtilement anglais, répliqueront les autres. Reste une série de questions que le lecteur francophone est susceptible de se poser. Combien de temps une rivière française, fût-elle la Sorgue, dont on connaît la longue et riche histoire, peut-elle prétendre assurer la relève imaginaire de la Severn, le plus long des cours d’eau britanniques ? Combien de temps, surtout, avant que « la morsure de la nostalgie » – la nostalgie, ce mal incurablement anglais – ne reprenne ses droits ? Combien de temps avant que le soleil brûlant de la Provence ne lasse ou ne fane, incapable de rivaliser avec les ciels gris et plombés de l’Angleterre des Midlands, avec sa langue, sa tempérance (qui n’est qu’un mythe, nous le savons désormais, au regard de l’hystérie à laquelle aura donné lieu le Brexit), avec tout ce qui fonde l’âme et la musique d’une nation comme Albion[1] ? Pas longtemps, on serait prêt à le parier.
En attendant la suite annoncée en creux, donc, et une fois tournée la dernière page d’un livre dévoré d’une traite, tant le plaisir qu’il procure est indéniable, des réserves et des interrogations demeurent. Elles touchent aux limites du genre et de l’exercice. Au regard du raidissement meurtrier de la politique, outre-Manche – « la politique peut tuer les gens », et de fait, elle a tué Jo Cox, députée travailliste du Yorkshire –, que vaut une partie de jambes en l’air, entamée sur le registre de la grosse farce ? L’écart est abyssal, et pourtant, la verve de l’écrivain passe en force, faisant fi de différences irréductibles entre faits et fictions qui se retrouvent ainsi mis sur le même plan, à l’instar du sinistre River of Blood Speech d’Enoch Powell, le 20 avril 1968, et de la mise à pied de Sophie, pour des propos censément transphobiques qu’elle aurait tenus.
À d’autres moments, Coe semble hésiter : entre la fiction et l’analyse, la critique socio-politique et le roman de mœurs, le pastiche et la vérité historique avec laquelle il est bien tenu de composer. De ce fait, il louvoie souvent entre nostalgie et rage, passéisme et progressisme, empathie et condamnation, pitreries et compassion devant ce qui ressemble à une véritable « tragédie existentielle ». Toutefois, on sent bien, par-delà les pirouettes génériques et les prouesses stylistiques, quasi circassiennes, qui occupent un temps le devant de la scène, que quelque chose tient Coe à cœur. Le mot, du reste, est présent dans le titre, Le Cœur de l’Angleterre, dans la traduction (excellente de bout en bout) de Josée Kamoun, faisant craindre fugacement un excès de pathos, mais il n’en est providentiellement rien, tant l’humeur du livre, et partant son humour, commandent qu’on tourne le dos au sentimentalisme. Et ce, quand bien même Benjamin Trotter, de son propre aveu, n’est pas loin de connaître la période la plus faste, la plus heureuse, de sa vie de personnage, ce qui ne manque pas de piquant, quand on rapporte son bonheur fictif – et du coup hors sol ? – aux tribulations diversement colériques d’un pays qui se donne le sentiment de s’enfoncer dans le malheur. Un tel décalage, du reste, ne manque pas d’interroger.
Mais venons-en au fond de la question. Ce qui tient si fort à cœur au romancier, ce menteur professionnel, c’est la vérité qu’on doit à ses concitoyens. Une vérité si longtemps tue, maquillée, travestie, et devenue objet d’un jeu obscène de la part des hommes et des femmes politiques, désormais la proie de leurs sacro-saints communicants. L’un des moments les plus forts du livre, c’est celui où l’un des spin doctors de David Cameron en vient à reconnaître que « On est grave dans la merde », et que personne au gouvernement n’a la moindre idée de ce que le Brexit signifie, pour reprendre le mot devenu célèbre de Theresa May (Brexit means Brexit).
Autre moment de vérité, quand la réalité apparaît sous son jour le plus cru : au cœur de l’hiver, le père de Benjamin, ancien contremaître, découvre la désindustrialisation de l’Angleterre. Laquelle se dévoile à l’endroit même où se tenaient les anciens ateliers automobiles de British Leyland, désormais réduits à la condition de morne friche, mitoyenne d’une grande surface : « il n’y en a plus que pour les fringues de luxe, les bars à prosecco et ces saloperies de salades en barquette ». Sourcier, quand il débusque la colère enfouie, sorcier aussi, dès lors qu’il évoque comme nul autre l’âme du pays natal, le romancier ne guérit cependant pas les maux dont souffre l’Angleterre. Mais dire son fait aux charlatans de la politique et à leur toxicité sans pareille – et Boris Johnson n’est pas loin – n’est-ce pas le début d’une salutaire prise de conscience ?
Ce qui le tient aussi en alerte, ce serait la nécessité qu’il y a à ne pas s’endormir sur ses lauriers, comme de ne pas céder aux attraits de la trop confortable complaisance, jamais bien loin du conformisme, tous deux véhiculés par l’idéologie du progressisme libéral, de pair avec le profond patriotisme culturel qui le sous-tend. Or, Coe ne le sait que trop, ne serait-ce qu’en sa qualité d’écrivain de race blanche et de sexe masculin, il est un parfait représentant de cette idéologie-là, en lointain successeur d’E.M. Forster, l’auteur de Retour à Howards End (1910).
Si la boucle du récit se boucle, par la grâce d’un truc de romancier, la rivière du Brexit n’en a certainement pas fini, elle, de couler.
N’est-ce pas à ce titre que Benjamin privilégie, entre toutes, les notes d’un romantisme sublime quoique tardif de The Lark Ascending (1914), romance pour violon, piano et orchestre de Vaughan Williams, d’après un poème de George Meredith ? Mais gare à rester « connecté » – le mot est, justement, de Forster – à la petite musique, très peu lyrique celle-là, volontairement acide et même franchement désaccordée, qui monte des profondeurs du pays. À l’évidence, elle n’est pas au programme des Proms, ces concerts-promenades donnés au Royal Albert Hall, à South Kensington, pendant l’été londonien, lesquels se concluent invariablement, lors de la dernière soirée, par une manifestation aussi consensuelle qu’il est possible de le concevoir d’un authentique patriotisme musical, le public en transe communiant à cette occasion avec l’orchestre et reprenant en chœur couplets et hymnes nationalistes.
Cet autre chant – chant du bouc, et partant, du pays qu’on sacrifie, composé et interprété par les victimes des politiques d’austérité successivement imposées par les élites politico-financières britanniques, lesquelles auront volé leurs concitoyens « comme au coin d’un bois en toute impunité » –, Le Cœur de l’Angleterre donne à l’entendre, mais comme à contrecœur, risquera-t-on, à moins que ce ne soit à contretemps. D’où ces flottements dans la ligne mélodique du roman, continûment anglais « dans la fibre », mais passant par plusieurs états, de l’anglais « bon teint » (dyed-in-the-wool) à l’anglais compatible avec l’europhilie, cette dernière l’emportant in fine, en raison, sans doute, du profond embarras éprouvé devant les manifestations d’un chauvinisme outrageusement xénophobe. Et si l’embarras, la honte, la confusion, se trouvaient au cœur de l’équation complexe dont procède, en dernière analyse, l’anglicité ? En toutes circonstances, du reste, mais jamais aussi fortement qu’en celles du Brexit ?
Comprendre qu’il faille, devant l’inacceptable, rompre avec les formulations « nuancées et équitables », est une chose. Se trouver à l’unisson d’une colère en est une autre. Elle rime pourtant, cette colère, en français du moins, avec Angleterre. Et elle vient de loin, ajouteraient les historiens et les politologues, attentifs à rapporter l’histoire longue, à la fois du Protest et du Dissent. Mais alors, pourquoi Benjamin Trotter en quitte-t-il les rivages ? Nous voici donc ramenés à l’endroit d’où était parti cet article, et où le roman prend fin. Ajoutons toutefois que si la boucle se boucle, par la grâce d’un truc de romancier, la rivière du Brexit n’en a certainement pas fini, elle, de couler. Et de gronder, pour sûr…
Jonathan Coe, Le Cœur de l’Angleterre, traduit de l’anglais par Josée Kamoun, Gallimard, coll. « Du monde entier », 560 p.