Faire œuvre de silence – sur Le Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena
Le Ghetto intérieur est l’histoire du grand-père de Santiago H. Amigorena, Vicente Rosenberg, qui en 1928 a quitté la Pologne pour émigrer en Argentine. Quelques douze ans plus tard, en 1940, Vicente tient un magasin de meubles, et c’est un jeune papa heureux amoureux de son épouse, Rosita Szapire, un dandy qui aime en fin de soirée rejoindre ses amis au café ou jouer au poker.
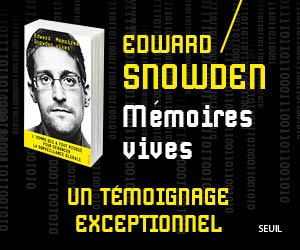
C’est depuis cette vie-là qu’il apprend la construction d’un mur destiné à isoler le ghetto de Varsovie, où sa mère vit et va se trouver piégée. La douleur, l’impuissance et la culpabilité écrasent alors Vicente, l’enfermant dans le silence pour le restant de ses jours. Un silence d’où son petit-fils, né en Argentine et exilé en France à douze ans avec ses parents, n’est jamais totalement sorti, et qu’il explore depuis vingt-cinq ans, plume en main.
Car Amigorena dévoile aujourd’hui l’origine de son travail d’écriture, une somme autobiographique débutée en 1998 : « combattre le silence qui m’étouffe depuis que je suis né ». Surtout, en préambule du Ghetto intérieur, il explique qu’il avait, dès le départ, pensé à l’avance son œuvre construite comme un immense livre, en six parties de deux chapitres chacune. Ainsi a été conçu et s’est échafaudé sur vingt-cinq ans ce travail autobiographique puissant, débordant et pourtant toujours maîtrisé, encore inachevé à ce jour.
Le Ghetto intérieur raconte l’histoire d’un homme qui perd la parole, car il fait au sens propre l’expérience de l’indicible.
« Les quelques pages que vous tenez entre vos mains sont à l’origine de ce projet littéraire », prévient-il dans son introduction. En effet ce Ghetto intérieur, qui raconte quatre ans de la vie de Vicente, éclaire tout le travail publié jusqu’à aujourd’hui, et le titre même du premier ouvrage publié d’Amigorena, Une enfance laconique. Avec ce texte, Amigorena nous donne à lire comment un traumatisme peut se transmettre de génération en génération, sans un mot. Dépassant le genre autobiographique, l’auteur aborde nombre de questionnements universels.
Ce livre n’est pas seulement un des plus déchirants de l’automne. C’est avant tout le travail d’un écrivain confirmé et il fascine tant par sa construction que par les problématiques formelles qu’il soulève.
Le Ghetto intérieur raconte l’histoire d’un homme qui perd la parole, car il fait au sens propre l’expérience de l’indicible. Vicente passe ses journées de plus en plus plongé dans le silence, ni sa famille ni ses amis ne peuvent plus tirer un mot de sa bouche. L’auteur lui prête cette pensée : « Plus de mots. Plus de langues. Ni allemand, ni polonais, ni yiddish. Ni espagnol ni argentin. Plus de mots. Plus de noms. Plus de noms pour rien. Ni pour la musique, ni pour le piano, ni pour la chaise, ni pour la table. Ni vitrine, ni magasin, ni rue, ni voiture, ni cheval, ni ville, ni pays, ni océan. Ni massacre. Ni douleur. Plus. De. Mots. » En décortiquant ce processus d’enfermement, Amigorena dans ce livre a relevé un défi majeur pour tout écrivain : choisir d’écrire sur ce qui n’est pas dit. Et donne de fait une définition de son travail d’écriture : trouver des mots pour qui n’a pas de voix.
Outre la thématique du silence et des non-dits, ce livre est un grand texte qui pose des questions essentielles sur l’identité. Amigorena campe un personnage à l’identité complexe, avant même qu’il ne quitte sa terre natale. Au sortir de la première guerre mondiale, Vicente se sentait peut-être plus polonais que juif, avant d’essuyer des insultes antisémites qui l’ont poussé à partir en Amérique latine.
Ce que raconte le livre d’Amigorena, c’est que l’identité d’un individu est loin d’être figée, et qu’elle se définit peut-être surtout par les conditions extérieures et le regard des autres. Ainsi un ami de Vicente, à la question « Mais on est toujours un peu juifs, tu ne penses pas ? », s’écrie : « Juifs ?! Mais on fait plus rien comme des Juifs… Même tes parents, malgré un accent à couper au couteau, ils préfèrent se parler en espagnol qu’en yiddish ! Et même eux ne portent plus jamais la kippa ! Et ça fait longtemps qu’ils ont oublié le goulash, le bortsch et le gefilte fish ! ils ne mangent que de la viande, des pizzas et des pâtes, comme nous, comme tous les Argentins ».
Amigorena sans apporter de réponses pose la principale question de l’époque moderne, à savoir si un individu peut ou doit se définir par rapport à son pays natal, à celui où il vit, par rapport à sa langue, par rapport à sa religion. L’identité est donc non seulement vue comme non figée dans le temps, mais multiple par essence. Amigorena remarque : « L’une des choses les plus terribles de l’antisémitisme est de ne pas permettre à certains hommes et à certaines femmes de cesser de se penser comme juifs, c’est les confiner dans cette identité au-delà de leur volonté, c’est de décider, définitivement, qui ils sont ». Là encore, Amigorena aborde cette problématique en tant qu’écrivain. Il construit son personnage autour de questions, de suppositions, de recoupements d’informations, plutôt que de lui asséner une personnalité définie dès le début du texte.
Amigorena rappelle ici quelques évidences : un migrant ne part pas seulement pour des raisons politiques ou économiques.
Plus largement, à travers l’expérience de Vicente c’est aussi l’identité du migrant, quel qu’il soit, qui est questionnée par Amigorena. Sur le sol argentin, Vicente n’a plus jamais parlé yiddish, langue qu’il a fini par oublier. Il ne pense jamais à son pays natal, tout occupé à construire sa nouvelle vie à Buenos Aires. Trouver du travail, se marier, avoir des enfants, mais aussi passer des heures à parler avec ses amis. C’est la montée du nazisme, la guerre, l’invasion de la Pologne, le ghetto de Varsovie et les lettres de sa mère qui le renvoient à ses souvenirs. Ainsi le personnage de Vicente traduit l’expérience complexe du déplacement comme possibilité, avortée, d’une renaissance. Et c’est ainsi qu’il faut décrypter la culpabilité qui étreint Vicente. Il ne se remet pas d’avoir laissé sa mère à Varsovie même s’il ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Mais n’aurait-il pas dû, justement, le prévoir ?
La culpabilité qui l’étreint est à l’aulne de la complexité de sa vie, et de toute vie. Vicente souffre de savoir sa mère loin de lui et en danger, mais il a quitté la Pologne en étant ravi de s’éloigner d’elle. « L’exil lui avait permis, aussi, de devenir indépendant ». Ainsi Amigorena introduit de la complexité dans ce qui, de l’extérieur, peut paraitre simple. Il rappelle ici quelques évidences : un migrant ne part pas seulement pour des raisons politiques ou économiques. Il peut aussi partir pour partir, ou partir pour des raisons privées.
En parallèle à l’histoire de Vicente, Le Ghetto intérieur analyse le processus de la solution finale. Amigorena revient ici aux fondamentaux. Travaillant en historien, il interroge les documents et la chronologie : comment les choses se sont-elles déroulées exactement ? Implacablement, il donne les chiffres, les dates, les étapes. Il cite des faits, en quelques phrases neutres et frappantes. Ainsi quand il parle de la construction du ghetto de Varsovie : « Quatre cent mille personnes dans quelques pâtés de maisons. Quarante pour cent de la population de la ville dans quatre pour cent de sa superficie. Cent vingt-huit mille habitants au kilomètre carré. C’est-à-dire une densité six fois plus importante que celle de Paris intra-muros aujourd’hui ».
Dans une construction littéraire vertigineuse, Amigorena crée un décentrage intéressant. En nous parlant de la façon dont on a appris l’existence du ghetto de Varsovie en Argentine, il nous donne de fait à regarder la situation de l’extérieur. Mais, parce qu’il est le narrateur, et qu’il tente de comprendre son grand-père, parce qu’il ne disparait jamais lui-même du livre, il nous propose d’examiner à la fois la situation de Vicente et la construction du ghetto de Varsovie depuis ici et maintenant.
Il est fascinant de d’observer comment Amigorena travaille, assumant un point de vue singulier, plutôt de reconstruire des faits grâce à un narrateur extérieur, par exemple, ou en se mettant dans la voix de son grand-père. Ainsi, en tant que narrateur, il passe sans cesse de Varsovie à Buenos Aires et de Buenos Aires à Varsovie, afin de prendre son lecteur par l’épaule et de lui donner la mesure de ce qu’il s’est joué durant ces quatre terribles années.
Aux passages concernant la vie de Vicente, émouvants, bousculés dans la retranscription des pensées du héros mais aussi de celle de ses proches, des passages où la fiction se fraie un chemin, puisque Amigorena imagine, et met en scène des discussions entre Vicente et ses proches, il oppose la description froide et clinique des faits qui se déroulent à plusieurs milliers de kilomètres, l’avancée des nazis et les meurtres de masse qu’ils commettent. Deux formes d’écriture cohabitent, qui se révèlent l’une à l’autre.
Le Ghetto interieur est un roman d’apprentissage, mais à l’envers, pourrait-on dire, puisque le héros, impuissant, est transformé par des événements qu’il ne vit pas.
Mais cette plongée dans l’Histoire relève elle aussi de la thématique du silence. Car, alors que les nazis s’organisent pour éliminer les juifs, Amigorena pose la question : qui a parlé ? Ou au contraire qui a su et n’a rien dit ? Pourquoi est-ce que la parole n’a pas circulé ? Il relève les articles de journaux qui, très tôt, auraient dû logiquement alerter l’opinion sur l’horreur en marche. Il retrouve un article du Daily telegraph, daté du 16 juillet 1942. Sous le titre : « Les Allemands tuent 700 000 juifs en Pologne », cet article informe de l’existence de chambres à gaz mobiles. Amigorena constate : « Ce scoop incroyable faisait deux colonnes dans la page 5 d’un journal qui en comptait six. Et le moins qu’on puisse dire c’est que sa parution, à l’époque, n’avait pas produit un bruit retentissant ».
Pour Amigorena écrivain, là encore tout est question de langage. Car comment parler de quelque chose que l’on n’a pas encore nommé ? « Vicente, comme le reste de l’humanité, pouvait savoir mais ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait mettre aucune image sur ce qui se passait à douze mille kilomètres de distance de là où se déroulait son drame personnel. Il ne pouvait mettre aucune image, ni l’appeler d’aucun nom ».
Cette difficulté à nommer, elle est toujours là après-guerre, et l’auteur souligne combien, entre holocauste, shoah, génocide, il a été difficile de trouver comment parler de ce qu’il s’était passé.
Et pourtant des choses sont dites, ou plutôt écrites, tout au long de ce livre. Outre les articles de journaux, Amigorena nous donne à lire les lettres que son arrière-grand-mère a envoyées en Argentine depuis le ghetto de Varsovie. Des lettres de plus en plus rares et de plus en plus laconiques. Là encore, elles sont à observer à l’intérieur d’un processus d’écriture, comme une mise en abyme du travail d’Amigorena. Car ces lettres importent autant par leur contenu que par ce qu’elles taisent, ce qu’elles laissent deviner sans le dire, ce qu’elles suggèrent du dénuement et de l’horreur sans même que leur autrice, l’arrière-grand-mère du narrateur, y ait probablement songé.
Enfin, un autre intérêt littéraire de ce livre est qu’il s’agit d’un roman d’apprentissage, mais à l’envers, pourrait-on dire. Puisque le héros, impuissant, est transformé par des événements qu’il ne vit pas.
À la fin du livre, Amigorena dans quelques pages magnifiques s’interroge sur l’écho de cette histoire en lui, et établit un lien entre la vie de son grand-père et la sienne, sa propre culpabilité de ne pas être resté en Argentine : « Je n’ai pas été là où j’aurais dû être. Mais je ne me plains pas ». Car ce livre est, avant tout, un livre sur la transmission, et sur ce qu’on fait, consciemment ou pas, du malheur qui nous a été donné en héritage : « J’aime penser que Vicente et Rosita vivent en moi, et qu’ils vivront toujours lorsque moi-même je ne vivrai plus -qu’ils vivront dans le souvenir de mes enfants qui ne les ont jamais connus ».
Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, POL, 192 pages.
