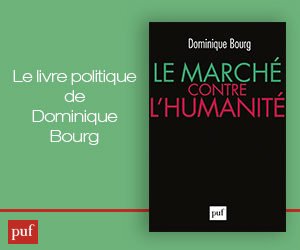Le syndrome Ulysse – à propos du Présent qui déborde de Christiane Jatahy
Sur un écran en fond de scène, des Ulysses modernes, qu’ils soient au Liban, en Afrique du Sud, en Palestine ou en Grèce ; jamais vraiment à leur point d’arrivée ni à leur point de départ, mais pris dans les feux du voyage. Comme déracinés de leurs terres natales, ils ne distinguent pas encore l’horizon qui les accueillera.
Pour Christiane Jatahy – présentant son projet utopique au début du spectacle comme à l’avant-première d’un film –, ils raniment à eux seuls les arcanes les plus vigoureux de la mythologie. Non pas qu’ils les reflètent volontairement : les acteurs à l’écran sont, tout simplement, des hommes et des femmes « aptes » à raconter l’Odyssée aujourd’hui. N’est-ce pas déjà beaucoup ? Ils racontent de vive voix une histoire que le spectateur de France ne peut plus prendre en charge. Autrement dit, nous – sédentaires et confortables amateurs de théâtre –, serions devenus incapables de faire le récit d’une fable que nous avons nous-mêmes bâtie et apprise de génération en génération.
O Agora que demora est donc une double expérience de dépossession : à l’image, des hommes dont l’histoire est malmenée – celle des réfugiés – se réapproprient des récits venus d’ailleurs. En l’occurrence, les nôtres (si tant est qu’on n’y voit pas une lecture trop « choc des civilisations ») : les acteurs se retrouvent face à une fable, exhumée par-delà les siècles, qui leur correspond mieux que quiconque. Sans doute le spectacle parle-t-il mieux en France qu’à São Paulo, où il a été créé en mai dernier, car d’un côté ou de l’autre du plateau, chacun traverse ainsi une épreuve douloureuse de désidentification de soi… N’est-ce pas quand on risque de perdre son héritage qu’on désire plus que jamais s’y reconnecter ? Tous déracinés, et tous en recherche d’histoires auxquelles s’arrimer.
Précisément : un espace entre l’écran et la salle semble avoir été désigné pour accueillir les imaginaires en marche : le plateau de théâtre. Une mer à franchir : littérale et métaphorique. La Méditerranée, bien sûr, mais également toutes les autres mers, et tous les autres océans… Sauf que la scène est complètement vide : les 8000 litres d’eau de Ithaque – Notre Odyssée I ont migré dans l’esprit du spectateur. Il ne reste qu’un « no man’s land » de sept mètres de profondeur, pour reprendre les mots de la Brésilienne : une barrière entre deux mondes que tout semble désunir.
Tout comme on viderait l’eau une piscine, c’est le théâtre lui-même qui est vidé de sa substance dans le Présent qui déborde. L’absence est criante : on ne regarde forcément que le vide faramineux qui se niche entre deux pleins. Dans son plus simple appareil, le plateau rappelle frontalement l’expérience de dépossession ; à moins qu’il ne soit la dépossession même, puisque du « spectacle de théâtre » attendu, il ne reste plus grand-chose de sa définition originelle. Au fond, O Agora que demora semble parler de l’art du théâtre comme d’un trou béant entre le réel et le cinéma ; un passage (à) vide, lui-même dépossédé, qu’il faut repeupler de toute urgence.
Jatahy met en scène la perte et la réappropriation de l’identité. Ou du moins son désir : ainsi, le plateau est l’habitacle d’un combat invisible entre des mondes qui veulent se rejoindre et s’harmoniser.
Pourtant, il y a également de vrais instants de théâtre, dans cette Odyssée ; mais faute de pouvoir habiter le plateau, les acteurs doivent se réfugier dans la salle, avec le public. Que leur reste-t-il à faire, s’ils sont exclus de leur terrain de jeu initial ? Regarder ce qui se déroule à l’écran, certes. Quelquefois, ils parachèvent l’action : ils commentent et bruitent le film, ils dansent quand ça chante, et ils chantent quand ça danse… Ils résonnent avec l’écran, de sorte que la salle, peu à peu, devient comme un appendice poétique de la fable d’Homère. Et à force d’être des réservoirs de réactions, les acteurs étendent la résonance à la salle toute entière, le public devenant à son tour un écho psychophysique du récit.
Dansant avec les acteurs dans la salle et sur l’écran, voilà qu’ils « complètent chaotiquement le réel » à partir de la narration documentaire, pour reprendre l’expression d’Olivier Neveux (c’est peut-être ça, le sur-réel, et c’est peut-être ça aussi, le « présent qui déborde » …). Rares sont les salles qui s’intègrent à la dramaturgie : elle en est ici un des éléments dialectiques majeurs, avec l’écran – tous deux polarisés par le vide fantasmatique du grand plateau.
Une chose est sûre néanmoins : ça veut discuter d’un côté comme de l’autre. À son habitude, Jatahy cherche à complexifier les frontières entre les médias (plus que les effacer, comme on dit souvent à tort). Pour ce faire, plusieurs procédés, tous plus percutants les uns que les autres : plusieurs acteurs que l’on voit à l’image sont présents dans la salle ; certains d’entre eux répondent directement à l’écran (de sorte que des scènes de l’Odyssée s’improvisent par-delà des milliers de kilomètres) …
Car O Agora que demora, à l’instar de Milo Rau dans Oreste à Mossoul, transforme le régime médiatique en régime médiumnique. C’est-à-dire que l’écran appelle la salle tout comme la salle appelle l’écran : d’une pierre deux coups, Jatahy met en scène la perte et la réappropriation de l’identité. Ou du moins son désir : ainsi, le plateau est l’habitacle d’un combat invisible entre des mondes qui veulent se rejoindre et s’harmoniser. Cette scène maritime, que l’on imagine jonchée du sang et des cadavres des compagnons d’Ulysse, la Brésilienne veut la cautériser à tout prix : elle est la condition du futur entre les peuples.
Guérir la mer donc, et guérir le théâtre par la même occasion. Ainsi des acteurs qui témoignent de leurs souvenirs, comme s’ils cherchaient à se mêler à ceux qui, par-delà les flots, n’ont pas pu traverser. Ils leur tendent une main généreuse : « on a tous été un peu Ulysse dans le passé, et on peut le redevenir un jour », souffle la metteuse en scène dans un discours.
L’une d’entre eux, qui a décidé de repartir dans sa terre natale syrienne en 2015 – choix de très mauvais augure –, puis revenue en France, la connaît particulièrement bien, cette mer : elle sera la seule à occuper franchement le plateau pour raconter. Autant dire qu’elle peut marcher sur l’eau ; et quel pouvoir ! – À elle seule, elle est l’Ulysse en déréliction, qui se déracine plus vite qu’une brindille, à force d’être brinquebalé sur l’eau… Faudrait-il, s’il en est ainsi, se forcer à souffrir pour se rapprocher de ceux qui sont loin ? À ceux qui taxent Le Présent qui déborde de « starifier » la misère, il faut reparler, on ne peut plus simplement, de bienveillance et de compassion.
Les comédiens ne s’immiscent pas exactement dans le documentaire qui leur fait face : ils ne font qu’exprimer un potentiel, celui de devenir Ulysse à leur tour.
Car Christiane Jatahy n’encourage à rien d’autre qu’à un futur apaisé. Elle, qui a installé sa régie dans un coin sombre à jardin (comme pour attester de son implication), est la seconde personne à oser marcher sur le plateau : souriante, modeste, terriblement émue. Assez longtemps après la présentation du projet (qui, il faut bien le reconnaître, est un chouïa trop propédeutique), elle revient sur la scène pour inviter le spectateur à terminer son Odyssée au Brésil, sa terre natale. Et pas n’importe où : à l’endroit où son grand-père ne fut jamais retrouvé après un crash d’avion, en pleine Amazonie, parmi les Indiens Kayapó.
C’est une Odyssée personnelle donc, qui cherche à se refermer dans une terre ancestrale, aujourd’hui menacée par le gouvernement Bolsonaro, dont on connaît le mépris pour les considérations environnementales. Malgré lui, ce Présent qui déborde devient une fable écologique ; comme si les racines (de sa propre histoire ; de la grande Histoire) couvaient les prémices d’un avenir plus sémillant. À l’image de Tirésias conseillant à Ulysse de se retirer auprès d’un peuple « qui n’a jamais vu la mer », la metteuse en scène se retire au cœur de la plus grande forêt du monde. Une autre eau y coule, bien plus discrète, presque silencieuse : elle achève symboliquement le spectacle. Ainsi, c’est une rivière qui répond poétiquement à l’océan : dans un mouvement fluide, elle regarde le spectateur, imperceptiblement… « Tous les fleuves mènent à la mer », pense-t-on.
Au terme de Notre Odyssée, le public est invité à imiter le son délicat de la pluie sur l’eau : pour cela, il doit frapper avec l’index et le majeur tout près de son poignet, là où l’on prend habituellement le pouls. Difficile de faire plus émouvant : en tapant délicatement sur ce qui indique le battement du cœur, le spectateur se fond totalement dans l’œuvre médiumnique de Christiane Jatahy ; il se ramène lui-même à la vie de l’après-spectacle.
En réalité, Le présent qui déborde est bien plus hétérotopique qu’il en a l’air : chaque acteur qui se lève pour répondre à l’écran est comme une trouée vers l’ailleurs. Quel ailleurs donc ? Les comédiens ne s’immiscent pas exactement dans le documentaire qui leur fait face : ils ne font qu’exprimer un potentiel, celui de devenir Ulysse à leur tour. Car si Ulysse cesse d’être une personne, et l’Odyssée d’être un trajet, alors il ne reste peut-être que le terme d’état. « Le syndrome Ulysse », dirait-on pour retenir une formule : c’est-à-dire l’expérience incontestablement contemporaine d’une dépossession.
« Je n’existe pas », affirme un comédien syrien débarqué au camp de Jenine. « Je me sens au milieu de nulle part, je suis un étranger », continue-t-il. Il y a bien longtemps, le héros aux milles ruses affirmait au cyclope Polyphème (que l’on affuble parfois du sobriquet d’« escalope » dans le spectacle), « Mon nom est personne » ; Ulysse, ou le vacillement de l’identité. Si la salle semble parfois très lointaine de l’écran, personne n’est à l’abri de devenir personne, chuchote la metteuse en scène à l’oreille du spectateur attentif. Forte de toutes ces fragilités, elle cherche ainsi, coûte que coûte – et peut-être en vain – à recomposer un futur écologique par-delà les frontières médiatiques. La verra-t-on ré-insuffler le plateau vide d’un nouvel espoir politique ?
O agora que demora // Le présent qui déborde – Notre Odyssée II , écrit et mis en scène par Christiane Jatahy, d’après Homère, présenté au Centquatre-Paris jusqu’au 17 novembre.
Il sera au Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne du 4 au 6 décembre, à la Comédie, CDN de Reims les 31 janvier et 1er février 2020 (dans le cadre du Festival Far Away 2020), à la Comédie, CDN de Saint-Étienne les 6 et 7 février 2020, au CDN de Besançon Franche-Comté du 1er au 3 avril 2020.