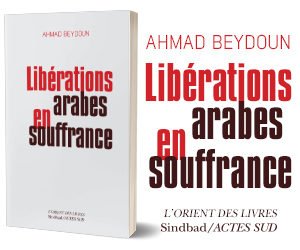Portrait-robot du grand-père – à propos de Cow-boy de Jean- Michel Espitallier
Écrire sur rien, c’est une chose. Écrire à partir de trois fois rien, c’est tout autre chose, qui est précisément ce à quoi s’attelle Jean-Michel Espitallier dans ce Cow-Boy délectable d’intelligence poétique : trois fois rien, à savoir les poussières de mémoire dont il dispose à propos de son grand-père paternel qui fut cow-boy « aux Amériques » il y a plus d’un siècle.
On le sait, trois fois rien ne font jamais rien, et d’autant moins aux yeux des lecteurs, en l’occurrence, qu’à se pencher sur cette page étrangement trouée de son roman familial, il en vient à bricoler une étonnante machine à démystifier le rêve américain qui nous a si longtemps mis des étoiles plein les yeux. Au rythme où émerge et s’affine une sorte de portrait-robot du grand-père Eugène en gardien de vaches solitaire, l’Amérique qui l’entoure change de visage : il en devient un redoutable révélateur, ce grand-père qui fut d’abord un migrant comme tant d’autres migrants d’hier ou (pire) d’aujourd’hui.
De fait, les hommes jeunes ont été nombreux ces années-là, dans les vallées des Hautes-Alpes, à partir, qui au Mexique, qui en Californie. N’empêche : avoir eu un grand-père qui certes s’appelait Eugène mais qui fut un vrai de vrai cow-boy, avec lasso, éperons et stetson « boss of the plain », ça ne devait pas être rien, pour un enfant grandi à la grande époque des westerns, c’est-à-dire en plein boom des années soixante, quand bien même on imaginerait qu’elles furent moins pétaradantes à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence, 1100 mètres d’altitude, 2476 habitants en 1968 : Espitallier avait dix ans) qu’à Londres.
Ce grand-père inconnu est mort trop jeune d’une tumeur au cerveau pour que son fils garde mémoire d’aucun de ses récits d’Amérique, s’il en fît jamais (le cow-boy est rarement bavard). Jean-Michel Espitallier ne peut que le constater d’emblée : faute d’avoir interrogé son entourage familial avant décès, de ce grand-père il est un peu tard pour faire un sujet, comme il l’affirme à la première page :
« Mon grand-père s’appelait Eugène.
Eugène gardait les vaches.
Mais c’était en Californie.
Alors Eugène était cow-boy.
C’est tout ce que je sais de lui. »
Il était peut-être une fois Eugène et son lasso et des Indiens, en Amérique… Mais qu’en faire, de ce « il était peut-être une fois », en bon français ?
Grand-mère paternelle ou même arrière-grand-mère que l’auteur a connue centenaire, personne durant l’enfance ne lui a jamais rien dit de cette histoire qui ne peut donc parvenir à en être tout à fait une : non pas que le grand-père ait jamais relevé du tabou, dans la famille, simplement nul n’en parlait plus, un quart de siècle après sa mort. Il tenait dans le roman familial à peu près la même place que les oripeaux qu’il en restait dans la maison de Barcelonnette, pendus au grenier : « une salopette en épais coton à armure de serge gris-bleu, rivetée aux poches (de chez Levi Strauss & Co., San Francisco) » et « une veste trois-quarts en cuir marron », un cuir épais, une vraie veste de vrai cow-boy : un déguisement vrai, en somme, un habit vide, mais plein d’histoires possibles – et autant dire un vrai fantôme en puissance. Il fallait bien un jour y revenir, au revenant.
Parce que cela a dû tricoter à plein régime, certains après-midis, dans la tête de l’enfant jouant au salon avec ses figurines à flingues et à plumes, comme il le raconte. Il était peut-être une fois Eugène et son lasso et des Indiens, en Amérique… Mais qu’en faire de ce « il était peut-être une fois », en bon français ? Comment associer le continuum de l’imparfait à la petite étiquette verbale, « peut-être », qui le ruine en pure hypothèse et nous renvoie aussi sec au principe d’incertitude qui n’a pas attendu la physique quantique pour informer nos vies ?
Et puis, pour commencer, c’est quoi, en vrai, un cow-boy ?
Si telle est la question, la réponse est magistrale de s’appuyer sur l’histoire sociale des États-Unis autant que sur le savoir-faire du remarquable poète que demeure Espitallier quand il passe au récit, c’est-à-dire, quand il bricole dans la langue une machine à inventer une vie dont il est indéniable qu’elle a provoqué la sienne, s’il en ignore tout.
Pour ne prendre qu’un exemple de la magistrale tekhné poétique ici à l’œuvre, la première mention de la veste de cuir susdite apparaît dans une de ces listes euphoniques dont Espitallier raffole, lorsqu’il invente l’inventaire des malles du cow-boy se préparant à rentrer d’Amérique vers 1918 : entre autres et en bonne logique, « Une chemise à carreaux rouges et beiges, peut-être (peut-être de chez Roofman & Pot, Anaheim). / Un gros pull marron en laine, peut-être (de chez Aaron, Simpson & French, Long Beach). / Des chaussettes, peut-être (trois paires, dont deux grossièrement reprisées), / Peut-être trois caleçons blancs en coton » et au milieu de ce fatras bien rangé : la veste de cuir et la salopette délestées de tout « peut-être » puisqu’on les retrouvera bientôt au grenier. Sans oublier le « bandana rouge et blanc (sert de foulard, mouchoir, chiffon, gant de toilette, serviette, taie d’oreiller, garrot, balluchon, etc.) » qui fut lui aussi et assurément du voyage, puisque le père qui ne parlait jamais d’Eugène le portait – mais uniquement pour aller à la pêche. Étrange relique, là encore, et toute mitée, à force.
Mais avant de repasser par la Caisse à outils de l’auteur, ou de descendre en Salle des machines, pour citer deux titres de l’auteur du Théorème d’Espitallier[1], mieux vaut reprendre le petit bout de fil blanc avec lequel il s’agit de recoudre une vie oubliée. Né le 20 août 1887 à Ancelles, Hautes-Alpes, un coin perdu du Champsaur (« Ancelle … on aurait dit que c’était écrit »), le grand-père Eugène est donc parti aux Amériques au tout début des années 1900, avec son frère aîné, Louis. On ne sait pas pourquoi ils sont partis, mais on peut imaginer, cerner les hypothèses, d’autant qu’ils furent nombreux ces années-là : la liste est longue et documentée.
L’Europe sera bientôt inondée d’images par une Amérique fantasmée sur grand écran, une Amérique qui trame sa légende en accéléré ces années-là.
On ne sait pas davantage pourquoi Eugène seul est revenu, une quinzaine d’années plus tard, puis resté au pays après avoir épousé la grand-mère de l’auteur (une chance pour nous, en tout cas : sans quoi on ne lirait pas ce livre). Son frère Louis au contraire ne s’en est jamais retourné, préférant (si c’est un choix) faire fortune en épousant le rêve américain – que dis-je, en l’épousant : en s’y glissant, s’y lovant, s’y coulant au plus intime, cœur battant : puisqu’au départ de l’empire industriel de Louis Espitallier & sons, il y a l’ouverture d’une boulangerie à Palm Beach qui a bientôt fourni en pain blanc tous les Balboa Studios à l’époque du muet.
L’Europe sera bientôt inondée d’images par une Amérique fantasmée sur grand écran, une Amérique qui trame sa légende en accéléré ces années-là, prétendant s’être inventée sur des terres vierges et dépourvues d’histoire, pas de pitié pour les Indiens jusqu’aux derniers, mais Eugène, lui, décide d’en revenir, sans que l’on sache si c’était pour un séjour bref ou non, rongé qu’il était (peut-être) par cette nostalgie du pays qui a poussé tant de pionniers à baptiser leurs trois abris de planches de noms de l’Ancien Monde, de Montpellier (Vermont) à London (Ohio) en passant par Paris (Texas), là encore la liste est longue et signifiante.
C’était en 1918, donc, ou un peu avant, ou un peu après : Eugène en tout cas devait être dangereusement séduisant de revenir de si loin avec quelques liasses de billets verts et son stetson. Le danger ne l’a pas loupé : si nul n’a jamais pu dire pourquoi il était revenu, il semble bien que ce soit contre son gré qu’il n’est jamais reparti c’est-à-dire rentré en Amérique (si vous suivez), lui qui ne savait plus bien où il habitait, « peut-être ». Ce qui est sûr, c’est qu’une fois qu’il a eu épousé Marie-Rose, « son nouveau nouveau monde », la belle-famille a mis son véto, proposé en revanche une situation confortable au jeune marié, après tout à Barcelonnette aussi les vaches étaient à bien garder.
Conclusion provisoire (aux deux-tiers du livre) : il « existe une règle qu’Eugène n’avait peut-être pas bien saisie. À savoir qu’un cow-boy qui se retourne est un cow-boy mort. Et voilà qu’Eugène, justement, se retourne. Il se retourne et s’en retourne. Alors, le cow-boy qui se retourne ne tarde pas à se faire flinguer par la sédentarité des familles rurales. L’Europe aux anciens parapets l’aura bientôt récupéré», qu’il soit rentré par le train jusque New-York via Chicago puis le transatlantique (hypothèse 1, la plus développée, et l’on fait tout le trajet d’époque en chemin de fer, le nez à la fenêtre, les images défilent : on ne voit pas Eugène, mais ce qu’il a peut-être vu, on est très littéralement à sa place dans le train des mots) ou qu’il s’en soit retourné par l’Ouest avec changement de bateau à Saigon (Hypothèse 2, moins détaillée, il faut savoir doser le recours aux cartes d’époque et aux images de Google Earth, qui sont d’un profit discutable au milieu du Pacifique), voire qu’il ait préféré relier Le Havre « par le cap Horn, qui sait… » (Hypothèse 3, réduite à une ligne), puisque de fait on ne sait rien, de ce retour, pas plus que de sa vie « aux Amériques ».
Rien, ou en tout cas pas franchement de quoi faire un livre, a priori, sauf à nier les trous de mémoire en les bouchant par une fallacieuse mythologie personnelle. Autant dire, se faire un film au mépris de la réalité et du sens qu’elle a pu avoir (peut-être). Jean-Michel Espitallier se refuse évidemment à cette complaisance si courante de la mystification familiale : il préfère nous faire un film en montant savamment des tas de rush empruntés à l’histoire sociale des États-Unis, tirant sa chance du fait même qu’il ne sait rien et donc n’est contraint par rien, ainsi que le suggère l’exergue, extrait de Que ta joie demeure, de Jean Giono : « Tu n’as jamais vu de port de mer ? / — Non. / — Tant mieux. Quand on voit, on n’imagine plus. ».
C’est qu’étant écrivain, c’est-à-dire poète (ce qu’on maintiendra quand bien même ses derniers livres seraient inclassables de confondre récit, poésie et essai), il est bien trop conscient des enjeux politiques consubstantiels au faire poétique, à la fabrique et à l’agencement des phrases – et en somme, conscient, comme le disait Proust, que l’usage « du passé défini, du passé indéfini, du participe présent, de certains pronoms et de certaines prépositions » est susceptible de renouveler « presque autant notre vision des choses que Kant, avec ses Catégories ».
Et puisque costume et fantôme il y a, c’est-à-dire, puisque l’habit est de source avérée, il va l’habiter de faisceaux d’hypothèses surgies de ses propres mots pour en faire une personne, avec toute l’ambivalence extraordinaire du mot personne qui peut aussi bien signifier qu’il n’y a personne : esquisser une personne prise dans le tissu des habitudes malmené par l’émigration, une personne parmi des millions d’autres migrants aux traits tirés arrivant à la même époque à Ellis Island, parmi les dizaines d’autres jeunes gens originaires des Alpes-de-Haute-Provence partis garder d’autres vaches au Nouveau Monde, autant d’individus que le texte s’amuse à énumérer pour tenter de cerner non seulement la nécessité souvent économique qui mène à l’exil mais aussi « cette petite démangeaison au fond du crâne, qui passe par un certain nombre de crânes, et qui se nomme l’appel de l’inconnu. Le genre de chose qu’on ne sait pas trop ce que c’est – d’ailleurs, c’est marqué dessus ».
C’est marqué dessus : on s’en serait voulu de ne pas citer parmi tant d’autres cette trouvaille tombée du travail dans la langue, et qui subitement nous renvoie à l’enfance, enfance de l’art et du récit, quand les mots étaient les choses. C’est la langue qui fait événement, et sous la dimension joueuse du récit, sous le goût des empilements, des strates d’hypothèses, des listes (le bonheur des listes, c’est qu’elles sont inépuisables : aléatoires, elles laissent toujours une ouverture vers une forme d’infini dans le fini le plus fini), voilà que le récit si savamment bricolé façon Géo Trouvetou invente ce qu’il raconte, voilà que surgit réellement un portrait d’Eugène au pochoir, dans la poussière du temps.
C’est le lecteur qui le voit, qui l’habite, ce fantôme, en lui prêtant ce qu’il a de plus secret, une vie intime : tant il est vrai qu’il n’est rien de plus commun que le plus secret, la face cachée de la lune en chacun, jusque dans l’emportement amoureux qui piège Eugène. Exactement comme l’on voit ce petit personnage à la tunique rouge au milieu d’une foule dans un tableau historique, on le voit sans en douter une seconde, jusqu’à s’approcher de si près qu’il n’en reste plus et en tout et pour tout que trois légers coups de pinceau, plus un pour le chapeau.
Le plus mystérieux, dans cette réussite au pochoir, c’est qu’au fil des pages se détricote et s’effiloche autour d’Eugène la légende dorée de l’American way of life.
On le voit, Eugène, en Amérique, quand « parfois il va au marché de Santa Ana pour acheter du tabac, des pièces de cuir, une bobine de fil à repriser, de la pâte de coing, une bonbonne de pétrole lampant, une couverture mexicaine, un petit sac de soude caustique en paillettes, une écumoire en fer-blanc, de la graisse, des écrous, un boisseau de pois chiches de La Nouvelle Orléans (quand il y en a), de la poudre noire, une bouteille d’essence de térébenthine, du petit câble, de la tequila, parfois, quand il le trouve, L’Union nouvelle, organe de la population française du sud de la Californie, comme ça, pour voir, parfois une brosse de chiendent, un sac de macaronis, de la cire d’abeille » et encore bien des pépites, le lecteur en prend pour trois pages d’un pur plaisir énumératif qui appelle la voix haute.
Mais le plus mystérieux dans le principe même de l’art qui nous fait voir, sentir, inventer Eugène comme le petit personnage à la tunique rouge à partir d’une accumulation de mots ou de peinture à l’huile, le plus mystérieux dans cette réussite au pochoir c’est qu’au fil des pages qui voient Eugène émerger du fond du tableau américain se détricote et s’effiloche autour de lui la légende dorée de l’American way of life.
La brutalité d’un pays aujourd’hui gouverné par un Trump qui en est bien le fils transparaît dans toutes les pages, jamais autant que dans l’accumulation des faits historiques contemporains du séjour d’Eugène, regroupés dans le chapitre «Pendant Eugène» comme dans un livre scolaire on résumerait la France sous Louis XIV, mais avec des choix plus aiguisés, d’où cette terrible litanie dont on cite ici un bref extrait : « Au mois d’avril 1903, Roosevelt refuse de recevoir Mother Mary Jones, instigatrice d’une marche d’ouvriers du textile en grève pour protester contre le travail des enfants. Deux mois plus tard, une commission d’enquête reconnaît les mauvais traitements infligés aux Noirs qui travaillent dans le Sud. Entre-temps, à Maysville, Kentucky, Richard Coleman, vingt ans, accusé à tort du meurtre d’une femme blanche, est brûlé vif, très lentement afin de faire durer ses souffrances. De jeunes enfants passent l’après-midi à maintenir le feu à l’aide de brindilles et de petit bois. » La litanie est longue, il n’y a plus d’Indiens sinon dans les « réserves » mais les assassinats racistes sont innombrables, parfois « les spectateurs, dont des agents de police, ont organisé une quête pour acheter l’essence nécessaire à la crémation. » Le rêve américain ouvre grand ses ailes d’aigle aux serres acérées, ces années-là, et Eugène ne rigole pas tous les jours, c’est sûr.
Dans les entretiens qu’il accorde, Jean-Michel Espitallier aime à rappeler ce que disait Céline : « écrire c’est simplement nettoyer une médaille cachée enfouie dans la glaise, comme du sens préexistant à toute intention de le dévoiler ». C’est bien parce que « en réalité, c’est la langue qui donne du sens au réel » qu’écrire, c’est aussi « chercher dans le fouillis des langues les pièces d’une sorte de maquette à construire soi-même », dit-il encore. Et c’est tout à fait ça, en l’occurrence. Eugène qui a longtemps erré en fantôme de cow-boy méritait bien une médaille.
Jean-Michel Espitallier, Cow-Boy, Inculte, 144 pages.