Iran : la savante, les politiques et nous
Le 24 décembre, Fariba Adelkhah, anthropologue, auteure d’un article dans le premier numéro d’AOC (il y a tout juste deux ans) et prisonnière scientifique en Iran depuis le 5 juin 2019, co-signait une lettre avec sa collègue d’infortune, l’universitaire australo-britannique Kylie Moore-Gilbert, dans laquelle l’une et l’autre annonçaient se mettre en grève de la faim pour obtenir la reconnaissance de leur innocence et le respect des libertés académiques dans la République islamique et l’ensemble du Moyen-Orient.
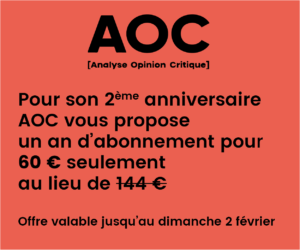
Si nous sommes sans nouvelles précises de Kylie Moore-Gilbert, toujours détenue dans le quartier des Gardiens de la Révolution de la prison d’Evin, à Téhéran, et condamnée à dix ans de prison – hormis quelques lettres glaçantes sur les conditions inhumaines de son incarcération – nous savons que Fariba Adelkhah a été transférée dans le quartier des prisonnières de droit commun, et blanchie par un tribunal du chef d’inculpation d’espionnage, le 7 janvier, tout en continuant à faire l’objet d’accusations tout aussi fantaisistes (« atteinte à la sécurité nationale » et « propagande contre la République islamique »). Elle poursuit sa grève de la faim. Elle est placée sous surveillance médicale, et reçoit à intervalles réguliers des injections de sérum qui lui permettent de résister physiquement. Sur le plan psychologique, sa détermination reste entière.
Il ne s’agit pas, dans son esprit, d’une grève de désespoir, mais d’un combat pour obtenir sa libération et, avant tout, celle de son compagnon Roland Marchal, arrêté en même temps qu’elle, toujours détenu dans le quartier des Gardiens de la Révolution, et privé de visites consulaires depuis décembre. Nous avons même cru comprendre que Fariba Adelkhah serait prête à suspendre sa grève de la faim si Roland Marchal était libéré, car elle nourrit les plus vives inquiétudes sur son état de santé – alarmes que l’on peut partager en s’interrogeant sur ce que les Gardiens de la Révolution ont à cacher pour repousser ainsi la visite consulaire due à notre collègue selon les conventions internationales dont l’Iran est signataire (Fariba Adelkhah étant binationale, Téhéran la considère comme Iranienne et ne lui reconnaît pas ce droit).
Fariba Adelkhah insiste sur son refus de toute politisation de son incarcération.
Il y a une semaine, Fariba Adelkhah, tout en poursuivant sa grève de la faim, a refusé de réintégrer sa cellule et tient depuis un sit-in dans les parties communes de la prison – il semble que le terme utilisé soit celui de bast, lieu d’asile et de protestation éthique, qui renverrait alors implicitement à la révolution constitutionnelle de 1906, au cours de laquelle les mosquées et les ambassades avaient servi de refuges aux dissidents qui réclamaient l’instauration d’un Etat de droit et de justice. Fariba Adelkhah exige de rencontrer Roland Marchal pour le réconforter et s’assurer de son état de santé, et elle s’insurge contre l’isolement auquel il est soumis. Cet entretien lui est refusé par les Gardiens de la Révolution sous le prétexte qu’ils ne sont pas mariés légalement. Selon nos informations, ils le seraient en fait religieusement, depuis leurs études communes à Strasbourg, à la fin des années 1970. L’avocat de Fariba Adelkhah et Roland Marchal s’emploierait actuellement à légaliser ce mariage pour débloquer la situation.
Fariba Adelkhah insiste sur son refus de toute politisation de son incarcération. Elle a été arrêtée par une institution bien précise, celle des Gardiens de la Révolution, dont les interrogatoires ont démontré leur ignorance la plus complète de ce qu’était la recherche scientifique, au contraire du ministère du Renseignement qui l’avait questionnée à plusieurs reprises ces vingt dernières années, parfois en lui confisquant son passeport pour quelques jours, généralement à son arrivée à l’aéroport. Elle s’étonne que dans aucun des documents qu’il lui a été donné de consulter au cours de l’instruction policière et judiciaire de ces derniers mois n’apparaisse la mention des Gardiens de la Révolution (Sepah), alors même qu’ils sont à l’origine de son arrestation et sont les maîtres des conditions concrètes de son incarcération. Elle parle à ce propos de « pouvoir à l’envers ». Elle rappelle qu’elle n’a jamais eu la moindre activité politique en Iran ou à propos de l’Iran, et qu’elle n’a jamais mis en cause la légitimité de la République islamique, en estimant que son activité scientifique était incompatible avec le militantisme politique. Elle ne se considère donc pas comme une prisonnière politique, mais comme une prisonnière scientifique, ainsi que son comité de soutien en France l’avait immédiatement affirmé, sitôt connue son arrestation.
La grève de la faim de Fariba Adelkhah n’a d’autre revendication que la reconnaissance de la liberté scientifique en général, et en particulier de celle de Roland Marchal et de la sienne propre. Elle sait que son combat est approuvé ou entendu au sein même de la République islamique, et qu’elle bénéficie de la compréhension de certains détenteurs de l’autorité politique, administrative ou judiciaire.
Ce positionnement très précisément exprimé, en dépit des circonstances dans lesquelles il est énoncé, mérite d’être entendu au moment où la liberté de la recherche est mise à mal non seulement dans les pays du Moyen-Orient, mais aussi aux Etats-Unis ou au Brésil, en Israël, en Inde, au Japon, dans les démocraties dites illibérales d’Europe centrale et orientale, Turquie comprise, et en France même : par la surveillance ou la répression policière sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou l’activisme environnementaliste, de maintien de l’ordre et d’impératifs en matière de sécurité nationale ; par le souverainisme scientifique qui conditionne l’accès au terrain à la délivrance de visas de recherche dans un nombre croissant de pays dont les régimes sont moins soucieux de coopération scientifique que de contrôle policier et de filtrage des sujets jugés sensibles ; par le poids financier et commercial des pétromonarchies et des pays émergents, à commencer par la Chine, dans les institutions et les maisons d’édition universitaires occidentales, désormais sujettes à leur influence, voire leur censure ; par des « procédures-bâillons » (Strategic lawsuit against public participation, SLAPP), des contentieux judiciaires proactifs, à l’initiative des entreprises et à l’encontre des universitaires dont les travaux leur semblent menacer leurs intérêts ; par la bureaucratisation chronophage de l’activité scientifique, selon les normes des enquêtes ou des essais biomédicaux complètement inadaptées aux sciences sociales, dont le respect, à grand renfort de comités d’éthique, produit une auto-censure d’autant plus efficace qu’elle est intériorisée par l’Université et qu’elle se veut morale ; ou tout simplement par la privatisation et la contractualisation de la recherche dans le cadre des politiques économiques d’inspiration néolibérale, et au nom d’une conception « darwinienne » de cette dernière, selon les propres termes du président du CNRS – une mise en concurrence et en individualisation forcenée qui progressivement soumet la définition itérative, selon les aléas de la sérendipité ou de la fortuité, de ses objectifs et de ses stratégies à la logique de court-terme du marché, par le biais de la contrainte financière et de l’évaluation quantitativiste. Publish (whatever), or Perish !
Sans même parler, bien sûr, de la Russie, de la Chine, de Cuba, du Venezuela, de la Corée du Nord et autres régimes autoritaires de par le monde, où la question de la liberté scientifique appelle les réponses que l’on sait, si tant est qu’elle se pose. La menace de l’instauration d’un « climat de censure » généralisé est globale, comme l’on dit désormais à tout-va, et comme le suggère la lecture du livre Liberté de la recherche. Conflits, pratiques, horizons, coordonné par Mélanie Duclos et Anders Fjeld (éditions Kimé, 2019).
Je ne vois pas d’expression plus pertinente que celle de djihad scientifique pour qualifier le comportement de Fariba Adelkhah.
De sa prison, Fariba Adelkhah demeure fidèle à l’éthique de son métier, qu’elle avait déjà exprimée, de manière prémonitoire, dans la lettre ouverte qu’elle avait adressée au président Mahmoud Ahmadinejad, en septembre 2009, pour dénoncer l’arrestation et la traduction en justice de la doctorante française Clotilde Reiss. Pour désigner son attachement à l’indépendance de la recherche, elle utilise le terme de din, littéralement « religion », et par extension « conviction forte ». Il me semble que la meilleure traduction en serait « vocation » (Beruf), au sens où l’entend Max Weber dans L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme et, bien sûr, dans ses célèbres conférences de 1917 et 1919, rassemblées en français en un ouvrage intitulé Le Savant et le politique.
Je ne vois pas d’expression plus pertinente que celle de djihad scientifique pour qualifier le comportement de Fariba Adelkhah dans la prison d’Evin. Le mot a mauvaise presse par les temps qui courent. Il ne signifie pourtant que le combat, et ni Al Qaida ni Da’ech n’en ont la propriété intellectuelle. En Tunisie, le héros séculariste de l’indépendance, Habib Bourguiba, voyait dans le développement du monde arabe le seul djihad qui importât. Et, pour les croyants, le Grand Djihad est celui qu’ils mènent contre eux-mêmes, pour devenir de meilleurs musulmans aux yeux de Dieu. A sa manière, Fariba Adelkhah est une djihadiste de l’anthropologie, une virtuose de l’enquête de terrain, restituant avec empathie la parole de ses interlocuteurs et leurs pratiques sans pour autant en être jamais dupe, et sachant garder ses distances grâce à son humour corrosif, mais nullement méprisant. Son indépendance d’esprit, son intégrité sont sans concession, ce qui naturellement lui a valu nombre d’inimitiés, de soupçons, de diffamations de la part de bons esprits qui lui reprochaient d’être tantôt trop indulgente tantôt trop critique à l’encontre de la République islamique, objet de passions politiques s’il en est.
On ne peut comprendre le djihad anthropologique de Fariba Adelkhah contre l’ignorance et le simplisme idéologique si l’on fait abstraction de son sens de la justice et de la vérité, que conditionne celui de la liberté de pensée. Il est un terme qui résume tout cela en persan : haq, à la fois, précisément, principe de vérité, de liberté, de justice. La force de Fariba Adelkhah est de ne pas en avoir une conception culturaliste, mais historique, et donc universaliste. C’est la raison pour laquelle j’ai tant appris de ses travaux dans mes propres réflexions sur la sociologie historique et comparée du politique. Etudiante, Fariba Adelkhah a lu à la fois Simone de Beauvoir et Ali Shariati, héritier d’une vieille tradition philosophique et religieuse du Khorassan et disciple de Frantz Fanon. Si on reprend ses publications sur l’ethos de la bienfaisance et de la chevalerie – le javanmardi – on voit comment elle a compris celui-ci non comme la manifestation atemporelle d’une prétendue culture iranienne, mais comme un style social, politique et religieux ancré dans l’historicité de son époque.
Djihadiste scientifique, Fariba Adelkhah est une javanmard de la recherche. C’est comme telle qu’elle est entrée en grève de la faim au fond de la prison d’Evin, pour défendre sa liberté personnelle, mais aussi la nôtre, notre liberté de pensée. Or, son combat nous pose un dilemme politique qu’il n’est pas aisé de trancher. Comment aider à sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi qu’à celle de Roland Marchal et des autres prisonniers scientifiques qui croupissent dans les geôles iraniennes, quand on est soi-même universitaire et attaché à cette « vocation » ? Comment agir efficacement, ce qui n’a jamais été le point fort de notre corporation, reconnaissons-le, avec tout le respect que l’on doit à l’art consommé de la signature de pétitions, de l’approbation de motions redondantes et de l’organisation d’assemblées générales confuses, en sachant que ce ne sont pas nous, avec nos grands mots et nos petits bras, qui allons faire reculer les Gardiens de la Révolution, mais bel et bien les politiques, les diplomates, voire les services secrets, que nous affectons de tenir à bonne distance en nous pinçant le nez ?
Instinctivement, le comité de soutien qui s’est spontanément formé à la fin du mois de juin, lorsque nous fut connue l’arrestation de Fariba Adelkhah et Roland Marchal, et qui s’est institutionnalisé à l’automne, a improvisé des réponses dont nous pouvons nous féliciter qu’elles correspondent aujourd’hui au positionnement de nos deux collègues, en tout cas de la première d’entre elles puisque nous n’avons pas de moyens de recueillir le point de vue du second. Nous avons parlé de « prisonniers scientifiques », et récusé le terme de « prisonniers politiques » pour essayer d’éviter toute récupération par l’opposition iranienne, notamment les très actifs Moudjahidines du Peuple dont nous n’avons rien à attendre du point de vue du respect de la liberté scientifique. Nous avons été amenés à nous concerter avec les diplomates français en charge de ce dossier, qui n’ont jamais cherché à empiéter sur nos responsabilités à l’égard de nos deux collègues et de notre profession, qui nous ont tenu informés autant que faire se pouvait de leurs démarches, et avec lesquels nous avons défini notre ligne d’action.
C’est ainsi que nous avons observé la plus grande discrétion lorsque nous avons eu confirmation, le 30 juin, de l’arrestation de Fariba Adelkhah et de Roland Marchal dont nous avions signalé, le 25 juin, la disparition en Iran. Le 15 juillet, la divulgation de la nouvelle de l’arrestation de Fariba Adelkhah par des réseaux sociaux iraniens a conduit le Quai d’Orsay à communiquer au sujet de cette dernière, et nous avons emboîté le pas, tout en continuant à garder le silence sur Roland Marchal, selon le vœu des diplomates. Cela nous a évidemment placés dans une situation douloureuse et embarrassante, dont nous comprenions les raisons – ne pas compliquer des négociations qui l’étaient déjà suffisamment en provoquant d’inévitables surenchères nationalistes en Iran – mais qui nous ont contraints à mentir à la presse tout au long de l’été et à n’ouvrir une cagnotte de solidarité qu’au nom de la seule Fariba Adelkhah, tout en sachant qu’elle était aussi bien destinée à son compagnon d’infortune. En octobre, la publication du nom de Roland Marchal par ces mêmes réseaux sociaux iraniens nous a permis de sortir du bois, tout en déplorant la manière dont Le Figaro avait présenté la nouvelle, faisant fi de la retenue et de l’éthique de responsabilité dont avait fait preuve la presse française depuis juillet – plusieurs journalistes avaient parfaitement identifié le second prisonnier scientifique dont bruissait la rumeur, en dépit de nos pieux mensonges.
Nous nous sommes résolus à en appeler à la suspension de la coopération scientifique institutionnelle avec l’Iran.
Dans ce contexte, il a également été très délicat de naviguer entre les organisations de défense des droits de l’Homme qui, de manière légitime, s’emparaient de la défense de nos collègues, mais au risque de politiser leur détention, ce qui était à la fois exact d’un point de vue factuel – leur arrestation par les Gardiens de la Révolution est un acte politique, tout comme les décisions de la justice iranienne, dans la mesure où celle-ci n’a pas la préséance sur ceux-là –, mais inapproprié au regard de leur propre positionnement professionnel, que Fariba Adelkhah réitère du fond de sa prison. Sur les conseils d’universitaires américains et britanniques qui avaient été confrontés à la même situation que nous-mêmes, nous avons renoncé à enclencher différentes formes de mobilisation en Europe et en Amérique du Nord dont ils nous disaient qu’elles s’étaient avérées contre-productives dans les cas qu’ils avaient eus à traiter, et nous avons sollicité des réseaux universitaires extra-occidentaux tout en sachant que l’Iran n’avait plus guère de pays amis dans lesquels il y avait encore des universitaires libres de leurs mouvements et susceptibles de nous épauler ! Cuba ? Le Venezuela ? La Corée du Nord ? L’Afrique du Sud, tout de même, et la Russie, d’où nos collègues ont promptement réagi avec générosité, mais malheureusement en vain jusqu’à présent. Nous nous sommes efforcés de décrypter pour les médias le contexte politique et international de la détention de Fariba Adelkhah et Roland Marchal, en essayant de ne pas faire prendre la vessie de l’intrigue de la série-culte du Bureau des légendes pour la lanterne de l’histoire réelle de ces derniers.
Surtout, nous nous sommes résolus à en appeler à la suspension de la coopération scientifique institutionnelle avec l’Iran, en pesant chacun de ces mots, en récusant le terme polémique de boycott, et en excluant de cet appel l’accueil des étudiants iraniens dans les universités européennes. Malgré ces précautions, notre position n’a pas toujours été comprise, notamment par les archéologues et les physiciens, très engagés en Iran, et qui ont su inspirer à la direction du CNRS une (trop) grande précaution de langage quant à la détention arbitraire de l’un de ses chercheurs, Roland Marchal. Le principal argument qui nous a été opposé avait trait à la nécessité de ne pas abandonner les universitaires iraniens en butte à la répression des autorités de la République islamique, et de ne pas les isoler davantage. Pourtant, il n’a jamais été question, dans notre esprit, de renoncer aux invitations individuelles. En outre, la coopération scientifique internationale n’a pas empêché la répression de l’Université iranienne depuis la révolution de 1979, et même depuis la relative libéralisation politique des années 1990, après la période de terreur des années 1980.
Se pose surtout, à nos yeux, une double question de sécurité et de décence. La République islamique détient aujourd’hui une quinzaine de prisonniers scientifiques occidentaux, en majorité, mais non exclusivement binationaux. Ceux-ci sont des prises de gage – nous préférons ce terme à celui, très connoté, d’otages – et servent (peut-être) de monnaie d‘échange dans d’improbables et opaques négociations. Est-il raisonnable de continuer à exposer des universitaires européens au risque d’arrestation en Iran, et peut-on raisonnablement parler de coopération scientifique institutionnelle si les universitaires européens ne peuvent plus s’y rendre ? Dans les faits, la coopération scientifique est bel et bien gelée puisque, dans sa grande sagesse, le ministère français des Affaires étrangères recommande à ceux-ci de renoncer à tout voyage dans ce pays, et que l’on peut espérer que le Haut fonctionnaire de Défense du CNRS émet des avis défavorables quant aux demandes de mission dans ce pays, y compris pour les archéologues et les physiciens.
Précisons qu’une institution scientifique ou universitaire française qui enverrait en mission en Iran un membre de son personnel s’exposerait à un risque de poursuite judiciaire de la part de la famille de celui-ci si, par malheur, devait survenir son arrestation. Pourquoi se priver d’un tel geste de fermeté alors que la suspension de la coopération scientifique est d’ores et déjà effective ? Et pourquoi se priver de toute décence quand bien même nos pulsions heuristiques nous pousseraient à accepter l’aimable invitation d’une institution iranienne, ou à poursuivre des fouilles archéologiques, alors que nous savons qu’aucune activité scientifique n’est déconnectée ou à l’abri des ingérences de l’appareil sécuritaire du régime ?
Bien sûr, il ne s’agit pas d’appréhender la République islamique comme un monolithe, et Fariba Adelkhah nous signale, de sa prison, des lignes de fracture en son sein quant au respect de la liberté scientifique. Mais, précisément, on peut en tirer la conclusion que la suspension de la coopération scientifique institutionnelle donnerait des arguments à ceux qui, à l’intérieur du régime, veulent endiguer la puissance des Gardiens de la Révolution, singulièrement lorsque ceux-ci se trouvent dans l’embarras à la suite de la destruction de l’avion de ligne ukrainien par leur force anti-aérienne, du fait d’une tragique méprise. Bien sûr, aussi, la diplomatie peut être tentée par une politique plus ambiguë, dans son souci de ménager des portes de sortie, de laisser ouverts des canaux de communication, de ne pas compromettre des accords obtenus au prix de longues négociations. Néanmoins, la situation est très différente de celle des années 1980, lorsque l’Institut français de recherches iraniennes de Téhéran était pour ainsi dire le dernier lien entre l’Iran et la France. Aujourd’hui, le dialogue diplomatique entre les deux pays est intense, tandis que les Gardiens de la Révolution poursuivent une politique systématique d’arrestation arbitraire d’universitaires étrangers qui ne devrait bénéficier d’aucune impunité.
En tout cas, je ne vois pas pourquoi les chercheurs devraient être les idiots utiles d’un jeu international dont ils ne sont pas et n’ont pas à être parties prenantes. Autant de questions, parmi d’autres, dont s’emparera le colloque « Captifs sans motif » qu’organise Sciences Po le vendredi 31 janvier, dans le cadre de la mobilisation pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Fariba Adelkhah et Roland Marchal.
Le djihad de Fariba Adelkhah dans la prison d’Evin, celui de son compagnon Roland Marchal sont bien les nôtres, et nous invitent à la résistance.
Le savant, ou supposé tel, ne peut échapper, à un moment ou à un autre, au politique, ne serait-ce que pour défendre sa « vocation ». Dans des termes moins dramatiques que ceux qu’affrontent Fariba Adelkhah et Roland Marchal en Iran, c’est bien ce à quoi les universitaires français sont exposés du fait du nouveau train de réformes néolibérales que leur impose le gouvernement. Par expérience professionnelle – et non par corporatisme – ils savent que ces dernières seront hautement dommageables à l’avenir scientifique de leur pays et, au-delà, de l’Europe toute entière, elle aussi en proie à cette formidable régression de l’ambition et de la liberté de la recherche depuis le triomphe du néolibéralisme, dans les années 1980. Nos gouvernements sont prompts à défendre l’indépendance de leur banque centrale et autres autorités indépendantes de régulation, mais jamais celle de leur Université ! Le pouvoir effectif s’affranchit du politique, et donc de la démocratie, sous couvert d’ « indépendance », ainsi que viennent de le rappeler Antoine Vauchez et Bastien François dans AOC, mais la laisse sur le cou de la science se raccourcit, sous couvert d’ « autonomie » de l’Université, dans la version française du néolibéralisme, et grâce à son pilotage par l’argent, jadis nerf de la guerre, aujourd’hui de la connaissance.
Il y a là une forme de suicide de l’intelligence et du savoir sur le Vieux Continent dont l’opinion publique n’est pas suffisamment consciente, gavée qu’elle est par le discours anti-intellectualiste de dénonciation du prétendu « politiquement correct » – ce que l’on appelait jadis la critique, dans la novlangue populiste –, par les accusations de passéisme portées à l’encontre des universitaires, par la vogue de l’ « ubérisation » du travail au prix de la précarisation générale de l’Enseignement supérieur et de la recherche, par ce climat de détestation de la chose publique qui s’est emparé de notre société alors même que les politiques libérales suivies depuis trente ans ont détruit l’hôpital, l’enseignement, les bibliothèques, la poste, les chemins de fer et même le réseau routier. Sans compter que la marchandisation de l’Université, qui entraîne une hausse extravagante de ses frais d’inscription et endette pour des décennies les étudiants pourtant menacés de chômage avant même d’entrer sur le marché de l’emploi, la transforme en institution censitaire et en fabrique de reproduction de l’inégalité sociale, non sans entraîner de fortes mobilisations comme au Canada, au Chili et en France, ou tout simplement l’exode des cerveaux qui est parfois la seule réponse à leur destruction. Le djihad de Fariba Adelkhah dans la prison d’Evin, celui de son compagnon Roland Marchal sont bien les nôtres, et nous invitent à la résistance.
