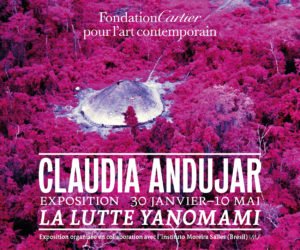Une histoire de l’art inversée – sur Sergueï Eisenstein, L’Œil extatique au Centre Pompidou-Metz
Le cinéma d’Eisenstein a produit des clichés en noir et blanc qui figurent parmi les plus puissants et les plus retentissants de notre imaginaire collectif, à nous, êtres du XXe et du XXIe siècle. Ces clichés étaient à l’origine des photogrammes et des extraits de films. Aujourd’hui et depuis longtemps, ce sont bien plus, des paraboles visuelles, des symboles qui cristallisent et fixent en quelques secondes un des plus grands bouleversements de l’histoire du XXe et sa portée universelle : le landau qui dévale l’escalier dans Le Cuirassé Potemkine, la statue du tsar déboulonnée dans Octobre…
D’où viennent ces images si fortes, si « vivantes et agissantes[1] » ? Dans quelle forge, dans quel esprit, sont-elles nées ? L’exposition qui se tient en ce moment au centre Pompidou de Metz répond avec une précision et une scientificité rares. À l’heure où nous écrivons, les plus curieux ont encore un mois pour s’y rendre et découvrir l’atelier intérieur de Sergueï Eisenstein (1898-1948), artiste total.
Loin des expositions paresseuses qui, des réalisateurs, ne montrent que des scènes répétées en boucles, assorties d’affiches et de photos de tournage, celle-ci creuse et ouvre sur l’histoire de l’art tout entière : elle met en scène Eisenstein l’homme de théâtre, l’historien de l’art, le dessinateur, le collectionneur, le théoricien, et, dans une moindre mesure, l’artiste officiel, le cinéaste aimé de Staline dont la carrière connaîtra des soubresauts liés au cynisme et à la tyrannie de ce dernier. De fait, l’exposition frappe avant tout par sa largesse et son amplitude. Les clichés les plus connus sont bien là, mais élargis et agrandis à tous les médiums que le cinéaste pratiquait et exploitait.
L’architecture du centre Pompidou de Metz s’y prête. À l’intérieur, les salles sont si hautes, si volumineuses que ce sont à peine des salles. On dirait une succession de ventres de baleine ou de cathédrales métalliques dont les scénographes ont mis en valeur les échafaudages, sans doute pour rappeler le constructivisme dont Eisenstein fut un des pères et un des fils. Le visiteur avance comme sous les cintres d’un théâtre, levant régulièrement la tête vers des écrans suspendus sur lesquelles défilent des séquences au noir et blanc sublime, contrasté, souvent terrifiant.
Au sol, le fil directeur de l’exposition est clair et parfaitement lisible : chaque espace est consacré à un film achevé ou inachevé et au matériel qui en a permis la naissance dans l’œil et le cerveau du cinéaste : croquis préparatoires, lettres échangées, tableaux de maîtres anciens vus et admirés, sculptures, courts-métrages antérieurs, extraits de films d’animation…
Les commissaires ont également ménagé une introduction et une conclusion. Un premier antre rappelle la formation théâtrale du cinéaste, l’influence de Meyerhold, le nouveau jeu des comédiens soviétiques, dit « biomécanique », et celui des baladins de la comedia dell’arte qui semble le préfigurer : voyez la série de Jacques Callot, Balli di Sfesssania, et le croquis d’Edward Gordon Craig. Un dernier antre est consacré aux livres, aux œuvres, petites et grandes, et aux artefacts que le réalisateur conservait et mettait à profit pour fabriquer ses films. La diversité de sa collection révèle un homme dont la curiosité déborde largement des cadres du réalisme socialiste.
L’exposition relie chaque pièce aux images en mouvement nées de la folle capacité de synthèse et d’invention d’Eisenstein.
Parmi les pièces que possédait le réalisateur, on relève un plan XIXe du Parthénon réalisé par un ingénieur français à l’origine de l’axonométrie ; deux photogrammes d’un film d’animation de son ami Walt Disney, dont les personnages labiles le fascinaient : il baptisa « plasmaticité » la mutation incessante de leur forme ; ou encore un masque de théâtre japonais du XVIIIe.
Ces objets ne forment ni un cabinet de curiosité ni un assemblage à la manière surréaliste. Ils ont été acquis au fil de toute une vie comme les pièces d’un laboratoire, les éléments d’une formation continue, esthétique, intellectuelle et scientifique. Le cinéaste à qui l’on reprocha son formalisme et sa fascination pour la violence n’a pas un regard d’esthète sur le monde, à peine un regard politique – un paradoxe que l’exposition fait jaillir –, il a un regard de savant et de chercheur.
Chez lui et à Metz, tous les arts sont représentés : arts populaires et arts nobles ; arts occidental, mexicain, japonais ; arts profanes et religieux. La variété est stupéfiante, mais jamais gratuite. Chaque objet a un sens. L’exposition justifie et relie chaque pièce aux images en mouvement nées de la folle capacité de synthèse et d’invention d’Eisenstein. Le visiteur a l’impression de pénétrer dans le musée intime et le chaudron créatif d’un homme dont tous les sens sont à vif et se chevauchent. Faut-il s’étonner de lire sur un cartel que l’artiste s’intéressait au développement psychique de l’homme, aux phénomènes tels que la mémoire et la synesthésie ?
Les escaliers des prisons imaginaires de Piranèse sont là, dont la noirceur se retrouve dans l’architecture du quartier ouvrier de La Grève (1924). Puis c’est une Descente de Croix du Tintoret (1556-57) dont la composition se voit ressuscitée dans la séquence du corps pendu de l’ouvrier, toujours dans La Grève : la juxtaposition des deux œuvres est sidérante, le temps semble inversé, comme si la couleur avait précédé le noir et blanc, tant la parenté entre les deux supports, pellicule et toile, est forte. Les rapprochements de ce type sont nombreux, convaincants, à la fois patents et inattendus.
Dans Octobre, la foule vue du haut, fuyant sous les coups de la répression, est filmée suivant un angle qui rappelle celui d’une gravure de Félix Valotton appelée La Manifestation. Ailleurs, le gros-plan sur le profil d’Ivan le Terrible se détache sur un fond blanc fendu par la ligne noire d’une procession : le cadrage doit tout à une estampe d’Utagawa Hiroshige intitulée Aigle au-dessus des champs de Susaki. Plus loin, l’art de filmer un visage puise dans l’esthétique des icônes, mais aussi dans la physiognomie.
Eisenstein s’intéressait à cette science du XIXe, il connaissait Grandville et ses anamorphoses de visages humains en visages animaux. Il croyait au « typage », aux types de visage dont les traits révèlent le caractère de la personne, ainsi que la classe sociale et la période de l’histoire à laquelle elle appartient. Femmes, hommes, enfants : filmés par lui, leurs visages sont tendus, tirés, parfois monstrueux, souvent effrayants ; les yeux sont exorbités, les bouches sont figées en rictus.
Sous l’œil d’Eisenstein, la chronologie semble pulvérisée, comme si la septième art était le premier.
La douceur est rare dans les films d’Eisenstein. La sensualité y est absente, sauf dans une séquence extraite d’Octobre : une femme qui appartient à un bataillon féminin chargé de défendre le palais d’Hiver baisse les armes, au sens propre, saisie par la beauté de L’Éternel printemps, une sculpture de Rodin qu’Eisenstein avait filmé au musée de l’Ermitage. L’objectif du réalisateur caresse cette variante du Baiser et alterne avec l’expression bouleversée de la soldate ; le regard de la femme fusionne avec l’enveloppe que forme par les mouvements circulaires de la caméra.
Cette rencontre entre le film et la sculpture est une pause au milieu de l’exposition. Une impression de rondeur se dégage, qui contraste avec la géométrie sévère de l’ensemble. Faut-il voir dans l’émotion de cette femme le début de la capitulation des forces de la réaction, celles qui défendent le palais des tsars ? Peut-être, car Octobre est un film de commande et de propagande.
Un siècle plus tard, extrait de son contexte historique et envisagé dans le cadre d’une exposition, le sens idéologique de la séquence s’estompe. La fascination pour la sculpture de Rodin est aussi celle d’Eisenstein, artiste à l’œil absolu, serviteur du régime, mais conservateur d’un héritage culturel et artistique revendiqué et magnifié. « Un génie n’accommode pas ses œuvres au goût des tyrans. » écrit d’Alexandre Soljénitsyne dans Une journée d’Ivan Dénissovitch[2].
Le prisonnier du Goulag a raison. Hélas, la raison de l’art et de l’histoire de l’art est autre, et c’est celle que le centre Pompidou de Metz expose. Le musée ne met pas directement en scène le débat sur la sincérité de l’engagement d’Eisenstein, même s’il est présent derrière de nombreuses images du cinéaste : celles que nous connaissons, qui ont structuré notre vision de la Révolution et de l’Union soviétique, et celles que nous ne connaissons moins, issues de films inachevés.
Eisenstein était lui-même ambivalent. Il méprisait le grand-bourgeois qu’était son père, l’architecte Mikhaïl Eisenstein, qui fit partie des nombreux Juifs russes et allemands à l’origine de l’essor de Riga au début du XXe. Et il détestait les immeubles Art nouveau conçus par ce père, les façades et les fenêtres chantournées qui ornent les rues les plus élégantes de la capitale lettone, à la limite du kitsch.
Dans ses mémoires, Eisenstein confesse son dédain pour cette joliesse bourgeoisie mais il avoue son rapport ambigu à la Révolution rouge. Octobre 1917 fut l’occasion pour lui de catalyser son génie, écrit-il, plus que celle de protester contre l’injustice sociale et de changer le monde : « La révolution me conféra le rôle le plus prestigieux qui soit à mes yeux : elle fit de moi un artiste. Pour elle, je trouvai en moi la force de rompre avec la tradition, de me libérer de la pression paternelle qui voulait faire de moi un ingénieur[3]. »
Ingénieur il était, mais génial et visionnaire. Son œuvre est un lieu où converge toute l’histoire de l’art. L’exposition de Metz le montre, illustrant sa conviction selon laquelle le cinéma était l’aboutissement des arts qui l’avaient précédés. Sous l’œil d’Eisenstein, la chronologie semble pulvérisée, comme si la septième art était le premier.
Sergueï Eisenstein, L’Œil extatique, Centre Pompidou-Metz, jusqu’au 24 février 2020.