D’un perroquet à l’autre
Virale de part en part, l’étonnante histoire de la fièvre du perroquet ou psittacose qui éclata entre 1929 et 1930 s’est déroulée en trois temps. Elle mobilise pendant quelques semaines ces oiseaux de compagnie très « charismatiques », la presse, et les plus hautes institutions nord-américaines.
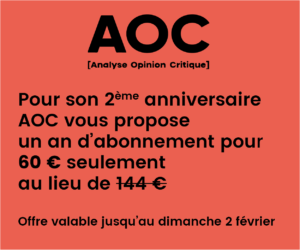
Cet épisode tragi-comique de santé publique rapporté par le prix Nobel Peter Doherty[1] se joue à la croisée de l’épidémiologie sociale, des médias et de la vulgarisation scientifique, de la psychologie des masses enfin, dans un contexte très particulier : dans le sillage de la Grande Dépression, et alors qu’insiste l’évocation encore vivace de la grippe espagnole de 1918, cette pandémie qui fit une cinquantaine de millions de morts (né en Chine, le virus de la grippe en question avait muté aux États-Unis en passant du canard au porc puis à l’homme, avant de se répandre partout).
Cette fois, tout commence le plus aimablement du monde sous un sapin de Noël : à Annapolis, un père de famille, un dénommé Simon Martin, offre un perroquet aux siens. Mais, yeux bouffis, tête pendante, plumes froissées, l’oiseau dépérit et ne tarde pas à mourir. Peu après, le 6 janvier, trois membres de cette famille se trouvent étrangement mal à leur tour. Leur médecin alerte aussitôt les autorités sanitaires de l’État du Maryland.
C’est qu’il avait lu un article sur une fièvre qui avait sévi quelques mois auparavant en Argentine et qui semblait joindre aux symptômes de la pneumonie ceux de la typhoïde. Ce syndrome inconnu – perversement venu des Tropiques via les perroquets et les perruches – s’y était avéré contagieux et mortel. Washington informé du danger à son tour dépêche une délégation du US Public Health Service.
Acte II, la presse (le Washington Post d’abord, puis le Chicago Daily Tribune et le San Francisco Chronicle) s’en mêle : elle fait sensation en multipliant informations contradictoires, recensions de cas, supputations, nécrologies et recettes-miracle. C’est alors qu’entre en scène un brillant pathologiste, le Docteur Charles Armstrong appartenant au Hygienic Laboratory de Washington, un organisme initialement chargé d’enregistrer (dans les ports en particulier) les éventuelles contaminations de choléra, de fièvre jaune ou de variole impliquant une quarantaine sanitaire.
Officier de marine pendant la guerre, employé aux services d’émigration de Ellis Island, Armstrong avait pisté des cas de grippe espagnole, et beaucoup publié – sur le botulisme notamment. Il réclame par voie médiatique des éprouvettes de sang contaminé, des spécimens d’oiseaux morts, des récits. Les citoyens américains sont invités à ne plus approcher leurs perroquets, mieux à leur tordre le cou. L’alerte est donnée dans tout le pays : des listes de perroquets sont dressées par les autorités, on dénombre une cinquantaine de cas humains dont 11 à New York.
Né au milieu du XIXe siècle, l’hygiénisme ne se limite pas à l’architecture, mais devient un courant de pensée lucratif.
Dans les années 20, la « chasse aux microbes » est devenue une obsession nationale : romans populaires et magazines se font continuellement l’écho de la propagation de ces agents invisibles et omniprésents. Né au milieu du XIXe siècle, l’hygiénisme ne se limite pas à l’architecture, mais devient un courant de pensée lucratif. On voit apparaître des produits d’origine industrielle comme les Kleenex, les bains de bouche antiseptiques, les tampons hygiéniques.
De leur côté, les scientifiques font appel aux médias pour récolter des fonds. Mais les journalistes supposés rendre compte de la recherche médicale manquent d’expertise. En revanche, ils savent reconnaître une « bonne histoire », un conte de Noël dangereux et chargé de mystère, qui met en scène, outre toutes sortes d’agents pathogènes dont un animal parlant, un « héros », et des interactions en chaîne pouvant affecter les familles américaines.
Le 15 janvier pourtant, face aux réactions de panique, la presse prend le parti de dédramatiser la crise : il s’agit en réalité d’une maladie connue depuis le siècle dernier, qui ne concerne que les Psittacidés et n’est pas transmissible par les humains. Constitué à cette occasion, le lobby des importateurs d’oiseaux fait savoir que ce prétendu mal qui toucherait jusqu’aux personnes sans contact avec les oiseaux est « le fruit de l’imagination enfiévrée d’un journaliste de Baltimore ». Et alors que le Président Hoover s’apprête à signer un décret interdisant l’introduction de ces volatiles étrangers, cela vire à la farce.
Moins de deux semaines après l’annonce de ce qui déclarait une épidémie mortelle, on se moque, on parle de « suggestion de masse », « d’hypocondrie nationale », « d’hystérie de vieilles filles » (les deux premières victimes décédées étaient des veuves) on évoque les folles mythologies des requins sur les plages, des gaz s’échappant des glacières, du prurit des corn flakes et autres niaiseries à l’avenant.
L’acte III s’ouvre sur une série de coups de théâtre : alors que la rumeur s’apaise et que cesse l’écholalie médiatique, les scientifiques mandés par le gouvernement sont atteints. Le 23 janvier, le chef du City Health Department de Baltimore, décède, suivi de l’assistant d’Armtrong. Armstrong lui-même rentre à l’hôpital le 8 février. Il guérit, mais onze autres personnes de son laboratoire sont touchées. Le Directeur, George McCoy prend l’affaire en main : tous les animaux (perroquets, pigeons, rats, cobayes, singes …) sont éliminés et incinérés ; le bâtiment est évacué. Au final, un rapport fait état de 169 cas dont 33 morts, sans compter bien entendu le nombre incommensurable de perroquets et autres martyrs à plume ayant payé cet emballement au prix fort.
Les antibiotiques peuvent venir à bout de ce syndrome de type grippal émanant d’une bactérie, Chlamydia psittaci, excrétée dans les fientes des oiseaux.
