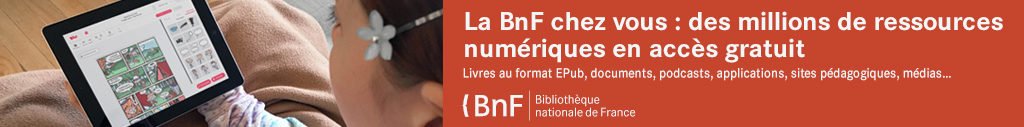L’ouvert et le néant – à propos du Complot contre l’Amérique de David Simon et Ed Burns
« C’était le plus beau panorama qu’il m’ait été donné de voir, un Éden patriotique,
un paradis terrestre américain qui s’étendait à nos pieds, et dont,
blottis les uns contre les autres, nous venions d’être chassés en famille. »
Philip Roth, Le Complot contre l’Amérique (2004)
La scène est l’une des premières de la seconde saison de The Wire. Bodie et Shamrock, deux petits trafiquants au service de Stringer Bell, se rendent à Philadelphie pour récupérer un chargement de drogues. En chemin, la radio se brouille. Le rap qui les accompagnait jusqu’alors est grignoté par les parasites, renvoyé à la matérialité de sa diffusion – ou, plus exactement, à sa localisation. Révélation pour Bodie : les stations ne sont pas partout les mêmes. Il y a un monde en dehors de Baltimore. Navigant de mauvaise grâce sur la bande FM, il attrape quelques bribes de chansons folk célébrant le Seigneur, et une lecture de Garrison Keillor. Fameux segment de l’émission « A Prairie Home companion », diffusée sur le réseau public APM entre 1974 et 2016, ses « Nouvelles du Lake Wobegon » content avec humour et affection les aventures des habitants d’une bourgade fictive du Minnesota.
Or, rien ne saurait être plus étranger au jeune homme que la culture des tomates à laquelle il est fait allusion. Bodie se récrie et, enfin, parvient à capter un nouveau morceau de rap. Ce moment, en apparence anodin dans une fresque d’une telle ampleur, insiste. C’est qu’il en rappelle un autre – lorsque le jeune Wallace, pour tenter d’échapper au commerce de la drogue et à un sentiment de culpabilité dévorant, trouvait refuge chez sa grand-mère, à la campagne. Téléphonant à un ami resté en ville, il se lamentait du chant ininterrompu des grillons. À ses oreilles, il n’y avait, là encore, que grésillement.
Il a beaucoup été dit de David Simon qu’il était le plus subtil chroniqueur contemporain du déclin et de la survie des grandes villes américaines – pour emprunter à Jane Jacobs les termes d’un essai fondamental de 1961. De Baltimore (Homicide, The Corner, The Wire) à New York (The Deuce), de La Nouvelle-Orléans (Treme) à Yonkers (Show Me a Hero), il n’a eu en effet de cesse d’inscrire l’histoire de ses personnages dans la trame des évolutions urbaines. Variant les échelles, de la défense du foyer ou du quartier à la mise en œuvre de vastes plans de rénovation, de déségrégation ou de gentrification, ses séries n’existent elles-mêmes que dans le croisement, l’évitement et la confrontation d’individus, de communautés, de groupes de pression ou d’intérêt, qui donnent à la ville son visage et son souffle.
Toutefois, il a moins été noté que cette considération avait pour envers un rapport complexe à ce qui excédait les limites de ces territoires. Un tel rapport croise, au moins, trois plans. Le premier est sociologique, et concerne les dynamiques de races et/ou de classes à l’œuvre dans la constitution des populations des centres urbains et des comtés périphériques. Pour Simon, le destin de Baltimore ne peut se comprendre sans en revenir au départ des Américains blancs dans les années 1960, en réaction à une amorce de mixité et à la diminution consécutive de l’assiette fiscale – renforcée dans les décennies suivantes par la désindustrialisation.
Le second plan est historique. Pour la plupart des citadins africains-américains, le comté évoque une zone non-cartographiée, et surtout dangereuse, car potentiellement sillonnée par des membres du Ku Klux Klan. Traitée parfois sur le mode de la légende urbaine ou du fantasme, cette crainte n’en est pas moins révélatrice de la profondeur d’une blessure collective, et indique la persistance de stratégies de prudence.
Le troisième plan est métaphysique. Si, dans The Wire, la question déchirante du jeune Dukie ne trouve pas de réponse (« Comment fait-on pour aller d’ici au reste du monde ? »), ce n’est pas uniquement pour des motifs socio-économiques. Le reste du monde est, pour ceux dont la socialisation est la plus localisée (les pauvres, donc), tout à la fois un réservoir de possibilités d’existence (l’ouvert) et le domaine d’une indétermination radicale (le néant), dont l’une des figures les plus marquantes serait les cadavres des treize prostituées anonymes découverts dans un container au début de la seconde saison de The Wire, et qu’il s’agira pour Jimmy McNulty, afin de pouvoir enquêter, c’est-à-dire leur restituer un nom et une histoire, de ramener dans la juridiction de Baltimore.
David Simon, au contraire de Roth, s’était jusqu’alors peu soucié de décrire les modalités d’expériences juives américaines.
Cela posé, il est permis d’envisager en quoi Le Complot contre l’Amérique appartient pleinement à l’œuvre de Simon. En adaptant ce récit de Philip Roth, le showrunner déploie et explicite en effet une question qui était jusqu’à présent demeurée elle-même au bord de ses fictions, comme une limite que celles-ci rendaient sensible mais qu’elles se gardaient bien de franchir, accrochées qu’elles étaient à la ville.
Modèle d’uchronie, Le Complot… avance l’hypothèse d’une victoire de Charles Lindbergh aux élections présidentielles de 1940 contre Franklin D. Roosevelt. Légende de l’aéronautique, père éploré depuis l’enlèvement et le meurtre de son fils, silhouette dessinée sur les timbres, Lindbergh possède, par ces temps de crise mondiale, les atours de l’homme providentiel. Son programme se résume à 41 mots, répétés à l’envi d’aérodrome en aérodrome, qu’un slogan condense mieux encore : « Moi ou la guerre ». Formule séduisante, évidemment, mais qui construit une fausse alternative, un piège pour la pensée.
Le pacte de non-agression signé avec le Reich, et les accointances de Lindbergh avec les plus hauts dignitaires nazis, contribueront bien plutôt à déchaîner l’antisémitisme – guerre de l’Amérique contre elle-même, vécue dans le livre du point de vue du jeune Philip, dont le monde alors s’ouvre et s’effondre d’un même mouvement, et que la mini-série considère à travers l’ensemble des membres de la famille Roth. Ce que l’aviateur précipite en fait par son accession au poste suprême, c’est un partage entre bons et mauvais citoyens, bons et mauvais Américains. Partage que produit l’antisémitisme, dans son obstination à considérer le Juif comme un être fondamentalement duplice, mais qui interroge en retour les Juifs eux-mêmes sur leurs appartenances.
De ce point de vue, il faut dire que Simon, au contraire de Roth, s’était jusqu’alors peu soucié de décrire les modalités d’expériences juives américaines. Non qu’il n’y ait pas chez lui de personnages juifs – au hasard, l’inénarrable Jay Landsman dans The Wire, ou Brad « Iceman » Colbert dans Generation Kill –, mais ce trait, peu ou pas évoqué, apparaissait comme neutre. À l’occasion, quelques mots yiddish fusaient – dans la bouche par exemple de Maurice Levy, avocat corrompu qui semblait le seul, là encore dans The Wire, à observer le Shabbat –, ou des pierres étaient déposées sur les tombes, guère plus. Évidemment, cette neutralité n’était pas sans indiquer quelque chose d’une trajectoire à la fois personnelle, sociale et historique, marquée par la perte ou l’abandon au fil des générations d’une langue, de pratiques ou de croyances liées au Vieux Monde. Mais Simon n’a, longtemps, pas trouvé là matière à témoignage ou à fiction.
Le Complot… pourtant débute un vendredi en fin d’après-midi, tandis que les gamins jouent à la guerre au milieu de la rue et que les femmes discutent en équeutant des haricots sur le porche de leurs maisons. Atmosphère joyeuse où, à l’instar des mouvements de caméra et de la clarinette d’Artie Shaw entendue à la radio, tout a la fluidité de l’évidence. Seule l’arrivée de deux hommes barbus, au costume noir et au chapeau à large bord, retient l’élan de Sandy, le frère aîné de Philip. Si leur père contribuera poliment à la quête pour établir une nation juive en Palestine, cette irruption lors du repas de Shabbat, où s’entrelacent dans la famille Roth expressions rituelles et spéculations sur le baseball, a pour les enfants l’étrangeté d’un archaïsme, comme le soudain retour d’un passé devenu incompréhensible. Avec ce mélange de minutie, de bienveillance et de didactisme qui caractérise parfois l’écriture de Simon, surtout à l’orée de ses récits, une des questions centrales de la série trouve alors à se frayer un chemin au milieu de ce bouillonnement de vie : « Papa, n’est-ce pas ici notre patrie [homeland] ? »
La réponse, positive, formulée dans un sourire tendre, ne fait pas l’objet de discussions. Le trouble est dissipé comme une vapeur. À cela, plusieurs raisons : le fait concret, têtu, d’habiter là et pas ailleurs – une des scènes suivantes montrera Philip davantage préoccupé par un potentiel déménagement dans un autre quartier de Newark que par l’exil de milliers de Juifs européens évoqué à la radio. Le partage ensuite d’un imaginaire, qui se manifeste par une connaissance aiguë des modèles d’avion (la « Lindbergh-mania » n’est pas retombée, et Sandy les reconnaît à l’oreille), la collecte méticuleuse des timbres où s’affichent grands hommes et paysages canoniques, ou encore la ferveur suscitée par le baseball, sport national s’il en est. Mais rien peut-être ne correspondrait mieux à l’« habitus américain » que la propension du père au débat, à la dispute – ce que Simon lui-même désigne souvent comme une « tradition du désaccord » (« a tradition of dissent »), à la fois condition et conséquence de la démocratie. Son héros à lui est Walter Winchell, satiriste et polémiste radiophonique qui entend bien dégonfler la baudruche Lindbergh à coup de chroniques dominicales.
Cette figure paternelle, qui construit dans le récit un axe de droiture, touche plus qu’aucune autre par sa résistance modeste, mais non moins vitale. Il est celui qui ne fuit ni ne se tait face à l’affront, qui exige même le respect de ses droits et en appelle aux institutions, comme lorsque l’hôtel où sa famille loge durant leur visite tant attendue de Washington D.C. les expulse sans motif. C’est durant ce séjour, qui voit la haine se répandre jusque sur les marches de marbre blanc du Lincoln Memorial, que se déroule d’ailleurs l’une des plus belles séquences de la série. Herman s’y livre, comme à son habitude, à une analyse de la situation politique étayée par les propos de Winchell. La famille n’est toutefois pas chez elle, mais dans un restaurant bondé. Un homme alors s’approche de la tablée et, menaçant, dévide son argumentaire antisémite et complotiste.
L’intervention du guide touristique des Roth et d’un serveur empêche la situation de dégénérer – le père, prêt à bondir, serrait sa fourchette comme une arme. L’inconnu retourne à sa place. La scène cependant ne s’arrête pas là. Herman insiste pour que chacun poursuive son repas. Et, bientôt, en réponse à l’ancien métier du guide, qui fut enseignant à l’Université de Wabash, il chante avec de plus en plus d’enthousiasme une chanson dédiée à cette rivière traversant l’Ohio et l’Indiana. Ainsi témoigne-t-il, soutenu par le sourire fragile de sa femme, du courage qu’il faut pour ne pas céder à la menace et à la peur, surtout lorsque celles-ci s’immiscent brutalement dans le quotidien[1].
En tant que citadins juifs, les Roth ne peuvent être que des Américains approximatifs, devant en tout cas faire leurs preuves au contact de la terre.
Un autre enjeu, indissoluble, réside dans ce geste : la connaissance du territoire américain, par-delà les limites du quartier, qui se confondent souvent avec celles de la communauté. Le Complot… est aussi une histoire d’exploration. Le malicieux Earl entraîne Philip dans un jeu de filature qui, de bus en bus, les emmène jusque dans les zones bourgeoises où, stupeur, les enfants ne jouent pas dans la rue. Surtout, Sandy se fait au fil des épisodes l’ambassadeur du programme élaboré par le rabbin Bengelsdorf, et appliqué par sa tante Evelyn, « Just folks », qui consiste à envoyer durant plusieurs mois des jeunes juifs dans les États ruraux du pays.
Si les parents s’y opposent dans un premier temps, c’est que, à juste titre, ils perçoivent l’enjeu idéologique derrière le discours d’ouverture et de générosité. L’initiative de Bengelsdorf, qu’il vante en appuyant son « accent sudiste » (c’est ainsi que Roth le caractérise), vise en effet non pas tant à la réforme des conditions socio-économiques aboutissant à des phénomènes de concentration ethnique – évidemment pas propres aux Juifs –, qu’à la « territorialisation » de la figure de l’éternel errant. Partant, il reconduit une opposition symbolique entre la ville et la campagne, les côtes et le centre, les États-Unis comme entité géographique et l’Amérique comme âme, esprit, essence nichés dans le « Heartland ».
En tant que citadins juifs résidant dans le quartier de Weequahic, sis à Newark, New Jersey, les Roth ne peuvent être que des Américains approximatifs, devant en tout cas faire leurs preuves au contact de la terre. Dès lors, la série se déploiera également comme pastorale et anti-pastorale. De son séjour dans une famille de paysans du Kentucky, Sandy ramène un ensemble de dessins au fusain, certains bucoliques, d’autres peu kasher – l’un montre l’éventrement du cochon mangé tous ensemble le dimanche suivant. Supports de communication visant à convaincre les adolescents de participer à « Just folks », ils sont aussi pour le garçon un trésor, un secret à tenir éloigné du regard parental – fragment d’un monde vaste, et autre.
Mais Le Complot…, en son dernier mouvement, dévoilera l’envers nocturne et cauchemardesque de la pastorale. En se cristallisant comme imaginaire d’une pureté originelle, elle produit de fait les ferments de la chasse aux allogènes. Ce qui, pour les personnages de The Wire, Treme ou Show Me a Hero, ne dépassait pas le stade de l’évocation ou de la hantise, se réalise soudain : des barrages illégaux sur les routes, des boutiques saccagées, des inscriptions racistes sur les murs et les vitrines, des membres du Ku Klux Klan déambulant dans les rues des villages.
Évidemment, ces images relèvent de l’uchronie, et n’ont donc pas exactement la même fonction ou le même statut que les fictions documentées de Simon – jusqu’alors, toutes ses séries s’inspiraient d’un travail journalistique au long cours ou de témoignages. Il est frappant néanmoins qu’elles n’apparaissent pas dans cette œuvre comme une anomalie, mais comme une confirmation – confirmation que, de leur histoire raciste, les États-Unis ne sont pas quittes. Confirmation également que d’autres récits sont nécessaires, et peut-être même une refondation de l’imaginaire national. C’est à bien des égards ce à quoi s’employait déjà Treme, qui trouvait dans les débats autour de la reconstruction de la Nouvelle-Orléans après le passage de Katrina l’occasion d’un plaidoyer pour la ville et la créolité.
Les temps ont changé, néanmoins, et le projet de Simon s’ajuste en conséquence. Les espoirs nés de la transition de George W. Bush à Barack Obama ont été remplacés par l’inquiétude et la colère que suscite l’administration Trump. L’allégorie se fait plus frontale, presque transparente. Les scènes d’émeute rappellent celles de Charlottesville en 2017, lors de la manifestation « Unite the Right », quand Lindbergh offre une version plus juvénile, plus fuyante également, mais non moins évidente, de Donald J. Trump. Simon ne s’en est jamais caché, en mettant chacun face à l’épreuve de l’intolérable, cette série a d’abord un sens au regard d’un présent marqué par la réticence à accueillir les réfugiés syriens et l’enfermement et la persécution des migrants latinos[2]. Un décodage terme à terme ne lui rendrait pourtant pas justice, car en figeant les analogies, celui-ci raterait le mouvement même de la métaphore.
Ce gouffre absolu de la mort anonyme, de l’humanité arrachée à l’humanité pour être précipitée dans un non-lieu radical, hors de tout tissu social et de tout travail de symbolisation, est sans doute le point central de l’œuvre de Simon.
Le fertile paradoxe de l’hypothèse Lindbergh est qu’en protégeant les États-Unis d’une guerre extérieure, et en déchaînant la suspicion envers les citoyens juifs, elle ramène sur le sol américain la possibilité de figurer la destruction des Juifs qui a (eu) lieu en Europe. L’écart n’est pas comblé, les expériences ne sont pas confondues, mais un partage de la douleur peut se faire jour par-delà la culpabilité. Le Complot… condense ainsi l’Holocauste – pour reprendre le terme plus couramment employé aux États-Unis – en une image, celle d’une voiture carbonisée, où ne se devine même plus la silhouette de Selma Wishnow, voisine des Roth, avant qu’un nouveau programme étatique d’« absorption » ne l’envoie avec son jeune fils dans le Kentucky. Si la série s’achève avec la compassion ambivalente de Philip envers Seldon, l’orphelin qu’il n’est pas devenu, elle reste définitivement marquée, trouée, par l’abandon de ce corps qui restera sans sépulture – tout comme les tombes juives profanées restent souillées par des résidus d’inscriptions nazies.
Ce gouffre absolu de la mort anonyme, du cadavre traité comme un déchet, de l’humanité arrachée à l’humanité pour être précipitée dans un non-lieu radical, hors de tout tissu social et de tout travail de symbolisation, est sans doute le point central de l’œuvre de Simon. Il suffit de repenser aux prostituées déjà évoquées, mais aussi aux cadavres dissous à la chaux dans des maisons abandonnées de Baltimore (The Wire), ou à ceux entassés dans des camions frigorifiques à la suite de Katrina (Treme). Dans Baltimore, sa première enquête au long cours, il notait déjà : « La naissance, la pauvreté, la mort violente, puis un enterrement anonyme dans la gadoue de Mount Zion. Dans la vie, la ville n’avait pu trouver aucun but pour ces âmes à la dérive ; dans la mort, elle les avait perdues tout à fait. […] Même si quelqu’un voulait venir au secours d’un être cher et préserver sa mémoire avec une vraie pierre tombale, dans un vrai cimetière, ce n’était plus possible. Les tombes sans indications et le registre pitoyable du gardien y avaient veillé. La ville aurait tous les droits d’ériger un monument à sa propre indifférence, on pourrait l’appeler la tombe de la Victime inconnue. »[3]
À tout rapprocher ainsi, le péril est d’abstraire ces morts de leurs conditions historiques au profit d’une indignation générale, et en dernière instance vague. Il serait même possible de considérer que l’effet collatéral de l’uchronie est de recouvrir une domination par une autre, un racisme d’État par un autre – ces images stupéfiantes de pogrom n’existent-elles pas, en vrai et en pire, s’agissant des Africains-Américains ? Ce serait néanmoins oublier que Simon se situe sur un autre plan. C’est un journaliste et un conteur, quelqu’un qui a le souci maniaque de la précision, du détail juste, de la fidélité aux êtres et aux choses, et qui en même temps considère qu’une histoire n’appartient à personne, qu’elle n’a de valeur que dans l’attention qu’elle éveille, l’imaginaire qu’elle suscite, le partage qu’elle construit, le communauté qu’elle esquisse. Et pour lui, cela vaut également pour Auschwitz – où il a perdu six membres de sa famille, en plus des quatre massacrés dans les bois en périphérie de Slonim, une ville de l’actuelle Biolérussie.
Dans The Corner, Simon écrit ainsi, à la suite de Gary McCullough, qu’il accompagne alors en tant que reporter, et qui a commencé à penser historiquement sa situation après avoir vu au cinéma La Liste de Schindler : « Avec un regard neuf, Gary scruta le gâchis, le carnage et la stupidité à l’œuvre dans son propre quartier et commença bientôt à faire des parallèles. Dans un autre lieu et un autre temps, les damnés étaient abattus et gazés et brûlés par millions avec une efficacité effarante. À Baltimore Ouest, dans un pays de libertés civiles, on assistait plutôt à la lente destruction de centaines de personnes. C’était différent, certes, et Gary l’admettait, mais c’était aussi la même chose. »[4]
En cela, il est proche de ce que pouvait écrire James Baldwin dans La prochaine fois, le feu : « Les Blancs furent et sont encore stupéfaits par l’holocauste dont l’Allemagne nazie fut le théâtre. Ils ne savaient pas qu’ils étaient capables de choses pareilles. Mais je doute fort que les Noirs en aient été stupéfaits ; au moins au même degré. Quant à moi, le sort des Juifs et l’indifférence du monde à leur égard m’avaient rempli de frayeur. Je ne pouvais m’empêcher, pendant ces pénibles années, de penser que cette indifférence des hommes, au sujet de laquelle j’avais déjà tant appris, était ce à quoi je pouvais m’attendre le jour où les États-Unis décideraient d’assassiner leurs nègres systématiquement au lieu de petit à petit et à l’aveuglette. »[5]
Ce choc ou cette recherche de la correspondance, ainsi que cette conception du récit comme agent métaphorique, n’effacent pas les particularités, bien au contraire. S’engage plutôt une forme de mobilisation non-identitaire de la mémoire et de l’histoire, ou une circularité de la reconnaissance, allant de soi aux autres, et des autres à soi. Simon, comme Baldwin, comme W.E.B. Du Bois plus tôt encore[6], tisse, relie, associe. Il pense les situations et les êtres ensemble, dans le partage de la souffrance comme dans la nécessité de la résistance. L’uchronie ne recouvre pas, elle dévoile plutôt des processus de fraternisation.
Lors d’une commémoration en l’honneur de Walter Winchell, tué par des fascistes au cours de sa campagne électorale, Le Complot… offrira ainsi l’unique figuration d’un peuple qui ne se limite pas à la foule unanime des meetings de Lindbergh. Hommes et femmes, jeunes et vieux, Blancs et Noirs, Juifs et Gentils se pressent dans les rues de New York et, de la multiplicité des corps, des visages, des allures, naît une clameur à la fois impérieuse et joyeuse. En s’élargissant, le cadre se gonfle de cette puissance d’être-ensemble, questionnant le pouvoir, affirmant ses droits. Et sans doute est-ce cela, l’Amérique.
David Simon (réalisateur) et Ed Burns (scénariste), Le Complot contre l’Amérique, diffusée en France sur OCS depuis le 16 mars.