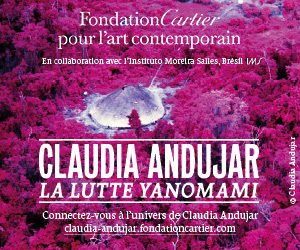Chroniques du ghetto – à propos de Robert Schindel, Edgar Hilsenrath, Josef Bor, Hélène Gaudy
La chronique s’avère le genre le plus approprié à rendre compte de l’expérience du ghetto pour deux raisons principales. Elle suppose, d’une part, une certaine neutralité du narrateur qui doit se contenter de noter, de recueillir, pas tant pour être préservé de la dureté de ce qu’il observe que pour assumer sa fonction d’extériorité : le ghetto est structure fermée, espace de confinement, ce qui empêche un narrateur puissant et souverain d’y pénétrer, de passer jugement ou de sélectionner des données en laissant libre cours à ses sympathies ou à ses rancœurs. Grâce à ce positionnement distant, le chroniqueur peut rapporter tous les niveaux de réalité, du trivial au sublime, de l’horrible au plaisant, du gore au grotesque.
D’autre part, la chronique déploie un rapport au temps spécifique qui accorde une égalité à tous les instants car elle plus attentive à la durée et à l’écoulement continu qu’à la rupture des événements, acceptant avec indifférence la répétition, la lenteur ou l’inaction. Elle rencontre ainsi la temporalité de l’enfermement et de l’exil, faite de tâtonnements, de reprises, d’apprentissages : « Les curieux événements qui font l’objet de cette chronique se sont produit en 194., à Oran », célèbre incipit de La Peste d’Albert Camus.
Lieux de l’envers urbain, lieux marginaux, lieux interdits, ghettos. Ces espaces, réels, sont aisément et souvent perçus dans une réélaboration fantasmée. Paradoxalement, alors qu’ils disent l’expulsion, ils subissent une transformation similaire à celle que les grands récits opèrent quant aux constructions nationales ou que le légendaire apporte à la mémoire des peuples. De même que la « Cour des miracles » ou la « zone » ont subi des transmutations favorables effaçant les sociologies sordides par la grâce d’un imaginaire tourmenté ou enchanteur, le XXe siècle a fait abandonner au ghetto la définition née de ses origines (Ghetto de Venise, Ghetto de Francfort) en tant que quartier réservé aux Juifs et relativement autonome pour venir peu à peu traduire l’enfermement absolu et la menace d’extinction attachés à la période nazie.
Quoique l’ambivalence entre séparation et ségrégation accompagne le ghetto dès sa conception, sa signification a évolué de lieu de vie à lieu de mort. A préciser qu’il existe une évolution parallèle qui détache le ghetto de son association à l’histoire juive pour lui accorder un usage généralisé et sociologique, souvent racialisé, qui peut lui accorder une fatalité liée à une appartenance de classe ou à une identité ethnique mais qui ne l’associe pas à un destin.
Comment vivre avec le souvenir emprisonnant du traumatisme ? Telle est la question lancinante qui parcourt le roman de l’écrivain viennois Robert Schindel.
De tous les espaces de confinement possible, le ghetto – ici, celui sous le nazisme – est particulier au sens où il n’est pas un espace de ou pour le confinement, il est confinement. On n’est pas dans un ghetto comme on est dans une ville, à savoir la possibilité d’être dans tel ou tel sous-espace de la ville, car dans le ghetto, tout est ghetto. Une ville peut accueillir un ghetto parmi ses fonctions de même qu’elle peut accueillir des jardins ou des hôpitaux, le ghetto en devenant alors une partie, mais le ghetto, lui, n’a qu’une seule fonction qui est d’être un ghetto et qui infuse tous les autres dispositifs urbains. Le jardin du ghetto où jouent les enfants n’est pas un espace d’évasion puisqu’on ne sort pas du ghetto ; l’hôpital du ghetto n’offre pas la guérison puisque les habitants du ghetto sont tous promis à la mort. Opposant l’habitable à l’inhabitable, la domus au ghetto, et prenant l’exemple de celui de Varsovie voué à la Vernichtung (anéantissement, annihilation), Jean-François Lyotard analyse : « Il faut l’exterminer parce qu’il constitue une vaine opacité dans le programme de la mobilisation totale pour la transparence »[1].
Comment vivre avec le souvenir emprisonnant du traumatisme ? Telle est la question lancinante qui parcourt le roman Gebürtig[2] (Le mur de verre) de l’écrivain viennois Robert Schindel. Le confinement des rescapés dans leur silence, celui des assassins qui se dissimulent, celui des politiques dans leur mensonge tracent une limite qui n’est pas franchie dans l’Autriche des années 1980. Ce n’est donc pas un hasard si un mur de verre sépare tous les protagonistes du roman, les descendants des rescapés et ceux des assassins, de Hambourg à Venise en passant par Terezín.
Dans l’épilogue, intitulé « Désespérés », l’auteur imagine un film où des rescapés et leurs descendants rejouent in situ la vie dans l’ancien ghetto de Bohême qui servit de vitrine aux nazis. De Vienne, les figurants partent en bus pour la Tchécoslovaquie après s’être retrouvés au carrefour du Prater, en allemand « Praterstern », allusion évidente à l’étoile jaune. À cette occasion, le narrateur formule sa compréhension de l’enfermement en substituant le paramètre temporel à la dimension spatiale: « Les regards sont dirigés vers ce lointain, nous partons dans le futur qui, en raison d’un certain passé, est si étriqué, si estropié qu’il se réduit à un présent »[3]. Permanence d’un confinement dont l’idée est reprise par la métaphore filée des corps saisis par le froid, jusque dans le ghetto de Venise où aboutit le personnage principal, l’intrigue romanesque venant ainsi établir un lien implicite entre le ghetto historique et le ghetto concentrationnaire.
Si Robert Schindel choisit le genre du roman pour évoquer un souvenir qui ne lui appartient pas directement puisqu’il est né en 1944, Edgar Hilsenrath dont la famille est originaire de Bucovine évoque sa survie dans le ghetto roumain de Mogilev-Podolsk dans une chronique hyperréaliste intitulée Nacht[4] (Nuit). Hilsenrath a toujours contesté avoir écrit une biographie car il veut octroyer à l’ouvrage une portée universelle que le titre suggère déjà. Nacht évoque toutes les nuits et surtout, révélée par le ghetto, une nuit de l’humanité, originelle, absolue et essentielle, dont on ne sort pas. Ce faisant, il tente aussi, luttant contre la mauvaise conscience d’avoir survécu, de dresser un monument commémoratif aux habitants du ghetto.
Le Maréchal Antonescu avait ordonné l’exil systématique des personnes juives vers les régions de l’est de la Roumanie, aujourd’hui en Ukraine, au-delà du fleuve Dnjestr-Nistra. La déportation massive des Juifs de Roumanie ayant débuté en juillet 1941, rares furent les survivants aux trois hivers glacials, au typhus, au choléra, à la faim et à la violence. Hilsenrath fut l’un d’entre eux. En 1944, il avait 18 ans lorsqu’il rejoignit la cohorte des prisonniers libérés par les Soviétiques vers la petite ville d’Ataki avant de pouvoir rejoindre Bucarest puis la Bulgarie. Grâce à une organisation d’aide aux survivants, il put prendre un bateau pour la Palestine. Hilsenrath, isolé, incapable de s’exprimer en anglais, en hébreu ou en arabe, vit de petits travaux et affirmera plus tard : « Je pensais que j’étais arrivé dans un pays juif et être parmi des Juifs, parmi les miens, mais je n’ai rien de commun avec eux[5] ».
La frontière qui le sépare inéluctablement des Israéliens est bien celle de la nuit européenne qui se prolonge indéfiniment. Ecrire Nuit, pendant douze ans, l’aidera à s’extirper de la dépression. Ce n’est qu’après son immigration aux Etats-Unis en 1951, l’achat d’une machine à écrire et sa découverte de l’œuvre d’Erich Maria Remarque dans laquelle il reconnaît un modèle littéraire qu’il parviendra en 1954 à donner une forme définitive aux souvenirs qui le hantent. Et ce n’est que dix ans plus tard qu’il parviendra à trouver un éditeur et que le livre fut publié, sans grand succès en Allemagne.
Chez Hilsenrath, la normalité apparente du ghetto se déchire sans cesse pour laisser place à des images charriant l’impensable, l’insoutenable.
Il est vrai qu’Hilsenrath, faisant fi du mutisme imposé aux rescapés et de leur pudeur, franchit les limites de l’indicible, ne cherchant jamais à dissimuler la turpitude à laquelle furent livrés les habitants du ghetto s’ils voulaient survivre. Nuit qui engloutit tout salut pour la condition humaine. Scène symbolique dans laquelle un vieux violoniste joue, tend son chapeau et ne reçoit qu’un crachat : « “Qu’est-ce qu’il jouait ?” demanda dans la foule une femme à son mari. […] “Je n’en sais rien, dit l’homme, ce n’était pas un air roumain. Ni un air yiddish.”/ “Ni ukrainien, dit la femme, ni russe non plus. On aurait reconnu.” / “C’était de la merde, dit l’homme, comme n’importe quelle musique” »[6].
Pas une seule fois dans cette œuvre de plus de 600 pages, il n’est question des Allemands, tortionnaires et assassins, seuls Roumains, Ukrainiens et Juifs sont présents. Le ghetto n’est pas un camp, l’ordre est établi par une police juive chargée d’exécuter les ordres car ce fut l’une des caractéristiques du système nazi de charger les victimes de se dénoncer ou de s’entretuer. Dans le ghetto, les signes de normalité sont déroutants : entre le café, « Le Grand Café », et la maison de passe, un coiffeur coupe encore les cheveux même si son activité principale demeure le marché noir ; un cordonnier exerce alors que le protagoniste principal, Ranek, vole les chaussures aux mourants et les échange contre quelques oignons pour se nourrir.
Dans les rues, parmi les mendiants, une jeune fille désirable et pourtant « une pauvre parmi les pauvres, une mangeuse d’ordures comme lui » (p. 228). La naissance d’un enfant (p. 336-337) devient incongrue, inutile, dans ce règne de la mort, d’une nuit de l’humanité, fin du monde à laquelle sont irrémédiablement voués les hommes. Chez Hilsenrath, la représentation du ghetto dévoile la part le plus obscure de l’homme, la normalité apparente se déchirant sans cesse pour laisser place à des images charriant l’impensable, l’insoutenable. « “N’aie pas peur, répéta-t-elle. Maman veille sur toi »[7]. Les mots de Deborah à son petit enfant, derniers mots du livre. Mais le lecteur ne peut les prendre comme une lueur d’espoir puisqu’ils sont prononcés dans le ghetto. Trop tard. Pour Hilsenrath, le ghetto reste à jamais nocturne.
Nuit d’Edgar Hilsenrath n’est pas La nuit d’Elie Wiesel pour une raison qui se tient à l’inverse de ce que la différence entre l’article défini et son absence pourrait suggérer ; celle-ci solennise une expérience alors que le décrochage (empli de doute) vers la transcendance opère chez Wiesel, pas chez Hilsenrath. Entre les deux nuits se tapit ce qui sépare le ghetto du camp, dégageant une différence qui n’est pas simplement chronologique – le ghetto antichambre du camp – car elle prend la forme d’un saut ontologique et théologique. Dans le camp, Dieu est accusé ; dans le ghetto, il est moqué. Dans le camp, l’être humain est néantisé ; dans le ghetto, il est ridiculisé.
Le ghetto nazi est couramment et emblématiquement rapporté à Terezín, forteresse de l’ancienne Tchécoslovaquie transformée en camp de concentration par les nazis de 1942 à 1945. Terezín : entre ghetto et camp, entre illusion et réalité, entre mensonge et souffrance, entre Allemagne et Pologne, Berlin et Auschwitz. Ghetto artificiel puisqu’il ne se développa pas organiquement et historiquement au sein d’une ville constituée mais qu’il fut délibérément aménagé, dans un lieu qui servait de prison, et que les Juifs y furent exilés et internés avant d’être convoyés vers les chambres à gaz et les crématoires.
Josef Bor publie en 1963 son Requiem de Terezín (Terezinské rekviem), 20 ans après y avoir été interné (de 1942 à 1944). Juriste tchèque, il aura perdu toute sa famille, parents, épouse et enfants, dans la shoah. Après un premier texte autobiographique, La poupée abandonnée (Opustená panenka, 1961), il livre ce récit d’un épisode advenu dans le ghetto de Terezín en 1944. Interpréter un requiem, celui de Verdi, dans le ghetto de Terezín, telle est l’idée fantasque qui s’empare de l’esprit d’un des internés, le chef d’orchestre Raphael Schächter. Fantasque d’abord à ses propres yeux car il est conscient du défi ou du scandale : une œuvre de part en part chrétienne interprétée par des Juifs dans le lieu de leur internement.
Dans le Terezín de Schachter, les notes de Verdi et les versets de la messe des défunts viennent dissoudre les remparts et les murs du ghetto.
Les enjeux sont divers : montrer l’art résistant à la barbarie, l’humanité à l’horreur, la musique à l’effacement. « Montrer l’inanité de ces idées perverses de sang pur et impur, de races supérieures et inférieures, les dénoncer justement dans un camp et par le biais de l’art, là où la valeur humaine peut être le plus reconnue. […] Une musique italienne et un texte en latin, des prières catholiques, des chanteurs juifs, des musiciens venus de Bohême, d’Autriche, d’Allemagne, de Hollande, du Danemark et beaucoup de Pologne et de Hongrie. Un Requiem dirigé par un athée, un Requiem dans le ghetto »[8]. Le ghetto n’est plus celui de Hilsenrath. Grâce au requiem, une rédemption serait possible dans la nuit.
La différence entre le ghetto et le camp tient à leur place le long d’une trajectoire : le premier occupe l’avant-dernière, ce qui l’inscrit encore dans le flux temporel, et le second la dernière, ce qui l’évince de toute continuité. Le temps s’arrête là, sauf pour ceux qui le croient transmué en flux angélique ou infernal. Et même pour eux, lorsqu’ils sont de confession catholique, le requiem occupe cette place de l’attente, déclinée sur le mode de la demande, ce que soulignent, par rapport aux autres messes solennelles, l’omission du Gloria, du Credo ou de l’Alleluia, exprimant la certitude, et l’ajout du Dies Irae, tourné fébrilement vers le futur. Quelque chose viendra après mais quoi ? Un requiem (« repos » en latin) se joue du sens premier du terme car, ignorant le calme, il cristallise l’inquiétude : « Dies iræ, dies illa, / Solvet sæclum in favílla, / Teste David cum Sibýlla ! / Quantus tremor est futúrus, / quando judex est ventúrus, / cuncta stricte discussúrus ![9] »
Dans le Terezín de Schächter, la spatialisation redouble la clôture ghettoïque puisque les répétitions ont lieu dans une cave et que la seconde représentation, ultime, prend place dans l’hôpital vidé de ses malades (relégués dans les greniers poussiéreux des baraquements, dépourvus de tout équipement) et transformé en théâtre. Alors que musiciens et chanteurs jouent la partition, les notes de Verdi et les versets de la messe des défunts viennent dissoudre les remparts et les murs du ghetto. Le chant des morts devient chant de vie et l’exil cède à la libération. Certes, Schächter a dû intervenir dans l’œuvre mais l’histoire lui en donne le droit.
Adressés aux dignitaires et officiers nazis écoutant dans le noir, les mots prennent une signification vengeresse : « Confutadis maledictis » pour les assassins, « Lacrymosa » pour le torturé, « Dies irae » pour les soldats allemands écrasés et les bombes tombant sur les villes – herméneutique attendue. En revanche, le requiem s’achève sur un « Libera me » empreint d’une douceur promesse d’éternité et cette consolation, le maestro ne l’accepte pas : « Saint Verdi qui êtes aux cieux, pardonnez mon péché ; si vous aviez été dans un camp de concentration, vous aussi, vous auriez composé votre finale différemment […][10] ». Non plus un solo en conclusion mais la puissance du chœur entier et de tout l’orchestre car les derniers mots de l’œuvre, « Liberté, liberté » doivent retentir comme un tonnerre à la hauteur de l’espérance des déportés : « Nous voulons la liberté » (p. 117) et non « Libère-nous » pour traduire « Libera nos ».
Opposant le pouvoir de la création aux forces de destruction, l’eros musical contre la mort promise, interpréter le Requiem est une vengeance contre les Nazis mais affirme aussi bien, en accord avec le « Sanctus » du livret, un retour possible vers un temps bienveillant. Au demeurant, à dissiper les aspects oppressifs du ghetto, on s’aperçoit qu’il peut tenir de l’utopie, la topographie du premier rejoignant la géographie de la seconde : un lieu clos, isolé, fortifié sur lequel stagne un temps arrêté ou suspendu.
De fait, le regard des architectes n’a pas manqué de reconnaître dans les « jungles » et autres campements de migrants des modèles d’urbanisme inédits qu’ils avaient déjà pu repérer dans les favellas brésiliennes ou dans les bidonvilles indiens. Dans et par son confinement, ce type de lieu contraint offre l’occasion d’une réinvention paradoxalement libérée de contraintes, celles que ferait peser un contrôle étatique ou une autorité gouvernante. Enfermé et enfermant, le lieu acquiert son autotoponomie, une règle spatiale propre qui ne doit rien aux ordonnances antérieures ou extérieures et développe en conséquence un ordre politique spécifique. Avec perversité, les nazis l’ont compris qui confiaient aux communautés juives des ghettos le soin d’organiser leurs propres instances d’administration et de police.
Puisque la clôture définit à la fois l’essence et la fonction du ghetto, comment y pénétrer, que ce soit par l’intellect ou par l’affect ? Terezín est exemplaire en ce que l’artificialité de tout ghetto y est redoublée par la volonté nazie d’en nier la négativité par une seconde artificialité consistant à le prétendre positif, à le déguiser en lieu de vie, un espace modèle pour la vie juive sous l’hitlérisme. On photographiera volontiers Terezín en noir et blanc car le chromatisme binaire se prête d’emblée à l’inversion de l’image, négatif/positif. Jamais le style de W. G. Sebald qui cultive l’énigmaticité en ponctuant les pages de clichés photographiques en noir et blanc, ni corrélés au texte ni détachés, n’a été plus approprié que pour son livre Austerlitz dont le personnage principal passe par Terezín sur les traces de sa mère.
À son tour, dans Une île, une forteresse. Sur Terezín, Hélène Gaudy reprend une fois encore – comme si le ghetto ne pouvait être métabolisé dans une mémoire collective une fois pour toutes – la trace, leurs traces, pour énoncer un simple questionnement : comment rendre compte d’un décor ? Tenter d’appréhender la nature de Terezín « […] sans savoir encore si ce qui me conduit ici est la question du mensonge, celle des traces ou celle de leur imbrication intime, puisque même les traces peuvent devenir mensongères selon qui les exhume et les met en scène »[11] . Elle a des compagnes et des compagnons, les guides qui l’accompagnent à Terezín et ailleurs, les témoins directs, lus ou rencontrés, les habitants actuels de la ville, les écrivains, lus ou rencontrés, quoique le lecteur soupçonne que le seul vrai guide n’a fait que la précéder, sans intention de transmission, le grand-père déporté à Auschwitz.
Un décor est un espace reconstitué, un lieu récréé, une fiction semblable au nouvel environnement qui suscite la question récurrente des exilés : comment puis-je accorder croyance à une réalité dans laquelle je n’ai pas grandi, que je n’ai pas intériorisée en même temps que j’intériorisais le monde ? Facticité et dissimulation, les deux notions disent les deux fonctions d’un décor et soutiennent l’analyse de Gaudy. Elles éclairent les deux tristes épisodes marquant l’histoire de Terezín : le film tourné en 1944, la visite de la Croix-Rouge la même année.
Parler du ghetto, c’est enfermer sa parole ; se souvenir du ghetto, c’est enfermer sa mémoire car la parole du dehors est inapte à saisir celle du dedans.
Interrogeant dans Un vivant qui passe Maurice Rossel qui fit partie de la délégation, Claude Lanzmann lui lance « Vous n’avez rien vu de Theresienstadt » (p.110) en une paraphrase, volontaire ou non, du Hiroshima, mon amour de Duras. Rossel lui-même évoque son sentiment d’une « « partie de théâtre ou d’une « farce » (ibid.). Irréalité due à la mise en scène des nazis pour cacher l’horreur mais qui rejoint l’irréalité éprouvée par les habitants du ghetto coupés de la légitimation d’un réel extérieur.
Dans tout confinement, l’intensité d’une vie concentrée dans un espace réduit suspend le sentiment d’une inscription dans l’économie du monde et défait les certitudes d’une vie subjective ou plutôt en accentue les incertitudes, transformant tout un chacun en disciple de Wittgenstein : qu’est-ce qui me prouve que le monde existe en dehors de moi ? Comme dans l’expérience exilique, les repères sont flous et l’identité subjective vacille. Il n’est pas vain de rappeler que l’œuvre première d’Emmanuel Lévinas qui fonde sa pensée de l’éthique comme un rapport jamais comblé à l’autre, Totalité et infini, appelle le sous-titre Essai sur l’extériorité. La sanction du dehors est indispensable à une subjectivité qui refuserait l’enfermement sur elle-même et en elle-même. Collectivement, le ghetto illustre cet enfermement et dessine l’autarcie conséquente qui ôte à la réalité la garantie d’une vérité.
Dans un autre film, Le dernier des injustes, Lanzmann rencontre Benjamin Murmelstein, le dernier doyen du Conseil juif de Terezin qui lui dit : « Là où commence Theresienstadt commence le mensonge./ […] Le Juif n’y a pas vécu, ce n’était pas une vie. / Le Juif n’y a pas habité, ce n’étaient pas des logements. […] » (p. 97) . Mensonge ou songe pour dire l’irréalité de tout confinement, le flottement utopique qu’il suggère. Un isolement implacable qui rapproche les images de la forteresse et de l’île jusque dans le titre d’Hélène Gaudy qui précise que la métaphore insulaire n’a rien d’un caprice esthétique : « D’une île on entrevoit bien l’image quand on s’approche ou s’éloigne des remparts, fixant cette étoile posée comme un bijou pauvre sur la plaine de Bohême, mais on ressent, surtout, l’isolement qu’elle suscite, la surveillance qu’elle permet, la peur qu’elle contient » (p. 142-143).
Le mensonge destiné à tromper le monde sur le sort des Juifs guide la prétention de Terezín à accueillir une vie normale avec services de santé, police, monnaie, commerces, écoles, bref une communauté parfaite modèle, notamment orientée vers l’exercice des arts – musique, théâtre, danse, arts plastiques – en raison de l’afflux d’artistes déportés dans le ghetto par les nazis (p. 55). Tant un lieu pour l’art que le ghetto en devient une œuvre d’art, un film puisque la machine d’effacement des traces que le nazisme instaura se double ici de la volonté d’en laisser une, odieusement trompeuse, Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (Le führer offre une ville aux Juifs), le film documentaire de propagande tourné en 1944 avec les habitants du ghetto en acteurs et figurants et réalisé par un artiste berlinois, Kurt Gerron, qui finira à Auschwitz. La vérité du mensonge-Terezín réside dans sa préservation sous forme d’une simple pellicule, vingt minutes d’images fugaces n’existant que sur un écran pour représenter un camp idéal, sans violence et sans mort : « Dans cette ville qui a toujours ressemblé à un décor se déroule [….] ce qu’elle a toujours semblé prête à accueillir » (p. 221).
Le ghetto enferme. Parler du ghetto, c’est enfermer sa parole ; se souvenir du ghetto, c’est enfermer sa mémoire car la parole du dehors est inapte à saisir celle du dedans. D’où le malaise à raconter des témoins cités par Hélène Gaudy. D’où la présence réconfortante des deux poètes morts l’un à Drancy, l’autre à Terezín, Max Jacob et Robert Desnos, spectres de leur vivant, à ce titre investis d’une parole aérienne pouvant transcender toute limite. Le ghetto enferme mais, ce faisant, il définit une forme de socialité – négative : l’inhabitabilité – tellement précise qu’elle peut se déplacer. Hélène Gaudy retrouve Terezín à Drancy ou dans la gare de Bobigny, lieux-antichambres où la mort nazie envoyait ses ambassades, villes aux rues « assoupies par une mauvaise digestion de leur histoire » (p. 175).
Des noms – Terezín, Drancy, Oradour, Guernica, Nuremberg, Vichy. Ne reste-t-il que des noms ? Comment les pénétrer, les déchirer, connaître leurs entrailles ? « Du plus petit au plus grand, maison, rue, quartier, ville, pays et presque continent, chaque point dans l’espace est ainsi susceptible d’être gagné par une ombre telle qu’en entendant son nom, quels que soient ses charmes et puis ceux qui y vivent, on perçoive l’écho, que le temps répercute au lieu de l’éteindre, de la mise à mort » (p. 188). Pourtant, comment hériter du ghetto ? En apprendre une conscience.
Vers l’extérieur, elle permet de reconnaître les ghettos d’aujourd’hui, les lieux d’exclusion – banlieues abandonnées, campements sauvages, bidonvilles – et les lieux d’un enfermement au double nom : rétention, détention. Et vers l’intérieur, une conscience qui est aussi un apprentissage.
Le père de l’écrivain et traducteur Georges-Arthur Goldschmidt a été enfermé à Terezín, un lieu qui pour Hélène Gaudy semble « silencieusement au cœur de son œuvre, la seule qu’il ne parvient pas à voir, à écrire » (p. 76). De son séjour dans le ghetto, il a laissé des dessins qui, avec d’autres dont ceux d’enfants (4 000 dessins conservés dans le Musée Juif de Prague), constituent une mémoire graphique de l’internement mais il a également légué à son fils une capacité – partagée sans surprise avec l’auteur de La métamorphose – qui enserre ce que serait la conscience du ghetto et valable pour tout confinement : « Ma femme a un regard très large, très ample, mais elle ne voit pas à la fois de près et de loin. Moi, je suis un animal, l’animal du terrier de Kafka. […] Moi, je vois les deux à la fois, parce que mon père m’a dit, tu dois regarder de manière à voir le proche et le lointain » (p. 75). Une chronique s’écrit précisément ainsi : à la fois un regard sur le détail et un regard sur l’ensemble. Leçon du ghetto, le principe du proche et du lointain : que le dedans ne fasse pas oublier le dehors mais qu’il apprenne à mieux le regarder.
Robert Schindel, Le mur de verre (trad. A.-M. Geyer), Paris, Stock, 2005.
Edgar Hilsenrath, Nuit (trad. J. Stickan et S. Zilberfarb), Paris, Attila, Paris, 2012.
Josef Bor, The Terezín Requiem, (translated from the Czech by Edith Pargeter), New York, Bard Book/Knopf, 1978.
Hélène Gaudy, Une île, une forteresse. Sur Terezín, Arles, Babel/Actes Sud, 2017.