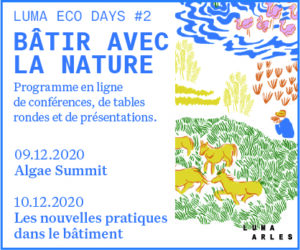Y aura-t-il de la poésie à Noël ? – à propos de Jacques Barbaut, Pierre Mabille et Charles Pennequin
Prolongements : dans C’est du propre. Traité d’onomastique amusante de Jacques Barbaut (éditions Nous) il n’y a rien sur les motifs ayant poussé un peuple à élire un type dont le nom est un mot-valise pour « sarcome de Kaposi » (une tumeur due à un herpèsvirus). Rien non plus sur les raisons pour lesquelles Édouard Louis a choisi de prendre pour pseudonyme un cousin putatif d’Émile Louis, le tueur pédophile. Encore moins que rien sur le fait que Loret est le masculin de « lorette » (demi-mondaine), le nom d’un graphomane du XVIIe siècle qui rédigeait seul sa Gazette de A à Z, ainsi que le début et le conditionnel des choses (« l’orée », « l’aurait »), mais sans leur réalisation.
En revanche, il y a quelques éléments sur Lorette Nobécourt qui décida de retourner à Laurence, son prénom de naissance, sur le passage d’Eddy Bellegueule à Édouard Louis comme, selon les mots du jeune écrivain, une mue « au sens herpétologique » (tiens, tiens…) et enfin des jeux et ris sur le nom de Barbaut, dont un calligramme, « AutopoRtrAit en bARbAut », qui a la particularité de ne contenir aucune des lettres du nom Barbaut, mais de ressembler, certes, à un barbeau.
Prolongements, disons-nous, car C’est du propre donne, comme son titre l’indique, à réfléchir sur la nature des noms propres. Difficile ainsi pour le.la lecteur.ice de ne pas penser au sien et de ne pas se demander ce qu’il ou elle pourrait en faire. Une des issues les plus simples est « l’aptonymie », qui poussa jadis Mitterrand à placer ses ministres selon l’aptitude que contenait leur nom : Delors aux Finances, Cresson à l’Agriculture et Le Pensec à la Mer.
On peut aussi devenir une phrase, exercice auquel chacun s’est déjà livré : « Nicolas boit l’eau, les Frères griment » et « Nathalie, ça rote », tandis que « Carla brunit »,… Sans parler des gens infoutus de prononcer correctement votre nom. Ainsi Heinrich Heine raconte-t-il que les Parisiens, allergiques aux diphtongues et au h aspiré, l’appellent « M. Enri Enn » et que « beaucoup réunissent les deux mots en un seul et disent “Enrienne”, quelques-uns m’appellent “M. Unrien”. »
Presque pas une ligne ici n’est de Jacques Barbaut : le livre est constitué d’extraits de textes littéraires ou critiques sur la question onomastique, de l’universitaire Hélène Aji et de l’écrivain A-J. Cronin à Malcolm X et Émile Zola, en passant nécessairement par Proust ou Cixous. Le nom étant culturellement et jusqu’à récemment le nom du père (le patronyme), la question de l’autorisation/auteurisation est centrale : « … toute écriture est l’histoire d’un nom » supposaient Philippe Bonnefis et Alain Buisine dans un essai que Barbaut dit séminal, La Chose capitale (1981).
Mieux vaut sans doute éviter, sur ce sujet, d’écrire en son nom propre-ment hérité et la méthode de composition choisie par Barbaut est donc idoine. La plupart des écrivain·e·s, on le sait, rêvent à l’anonymat ou au pseudonymat : « les ouvrages pseudonymes ne contiennent pas un seul mot de moi ; je n’ai aucune opinion à leur sujet » écrivait ainsi Kierkegaard. Sauf peut-être dans le cas de l’artiste Jean-Luc Parant : « Avec mon nom, j’ai toujours pensé que j’étais moi-même mon propre père et ma propre mère et que je n’avais besoin de personne pour n’être apparenté qu’à moi-même. »
Outre un travail érudit sur l’esthétique du nom, Barbaut livre aussi, par des rapprochements inattendus mais toujours signifiants, une sorte d’almanach malicieux, où l’on apprend que la rue Jarry de Paris n’a rien à voir avec Alfred ou que Claude Lévi-Strauss, donnant son nom au serveur d’un restaurant sur le campus de Berkeley, s’entendit répondre : « the pants or the books ? ».
Où l’on se rappelle aussi l’apport de Frédéric Bruly Bouabré à l’art africain, et que Michaux a écrit « Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence »… Puis on se prend à songer, dans le cas d’autres auteur.e.s cité.e.s – moins célèbres et retourné.e.s à l’anonymat – que si leur écriture parvient néanmoins à survivre encore un peu, c’est par éclats, dans le seul witz et l’aphorisme, par-là peut-être où, comme leur nom, elle leur échappait.
Père ancien est un livre au long cours, à la fois préhistoire de Pennequin et immédiateté, une matriochka de paternités.
Puisqu’on est dans les pères, les autorisations et le patrimoine, passons à Père ancien de Charles Pennequin (P.O.L.). C’est un livre au long cours, à la fois préhistoire de son auteur (1996) et immédiateté, une matriochka de paternités. Composé pour partie de textes déjà publiés (tels Bibine chez l’Attente en 2003) et de textes inédits, il compte parmi lui des poèmes comme Bobines dont le site des éditions P.O.L. — tentant de faciliter la tâche du lecteur en contextualisant les différentes parties – nous apprend qu’il « s’est écrit sur plus de vingt ans ».
La première remarque, c’est que pour un fils, le père est toujours ancien, étant à l’origine et à dépasser (« t’es pas cap / de mêmer »), que quand on passe père soi-même on devient vintage et que ce titre est donc excellemment classique. La deuxième remarque, c’est qu’à lire ces dix-huit textes, on a le sentiment que Pennequin a été molesté par sa mère et son père, sexuellement et mentalement. C’est en particulier le poème « Pa, ma » qui s’achève sur « Je suis un trou / je suis un trou avec du drame dedans ». Mentalement, c’est à peu près le cas de tout le monde – de l’inconvénient d’être né, disait Cioran. On pourrait donc trouver ici un mixte entre l’idiot de la famille et le suicidé de la société, qui ferait a minima de « Pennequin, le violé du patriarcat ».
Troisième et dernière remarque : Jacques Barbaut cite Buisine à propos de Proust et de « la dyade consonantique br » qui irrigue l’onomastique de la Recherche, en particulier sous la forme syllabique « ber ». Chez Pennequin, les titres sont souvent en « bin », de Bibine à Gabineau-les-Bobines, et la syllabe lie « trombine » ou « Bibi » (« moi ») au verbe « biner », creuser, qu’on retrouve entre autres dans ce recueil sous la forme « De ma bêche » : « Père mort en moi / ne dit mot la pleine / poire du patois / Pâte à mort le poids / toi la plaine noire / où l’on pleut ». « Bin » signe l’identité du trou (bine) et du moi (Ich bin).
L’ennui de la poésie (pour elle, surtout), c’est qu’on ne peut pas raconter l’histoire. Elle est donc très difficile à chroniquer. Sauf si l’on passe par la case universitaire et métrique, genre commentaire stylistique. Ou alors qu’on recense des auteur.e.s édifiant.e.s dont la sensibilité s’accorde à la standardisation perceptive de leur époque.
Mais en réalité, la poésie s’adresse plutôt à ce qui n’est pas édifié, aux sentiments non prêts-à-pleurer, aux percepts qui refusent d’être fixés. Donc elle s’éprouve, se décrit peu. On peut proposer ici une stance de Pennequin, pas forcément représentative, en pâture à votre sismographe personnel, pour voir ce que ça vous fait :
« voilà mon père avec. vos hernies bouffées. de
chaleur étourdis. sement et la jouvence. à l’extrait
d’ovaires père. et la rangée des pommes de terre ?
aller revenir au potager taille. de la vigne et des
arbres. fruitiers en espalier. écheniller palisser.
greffer les rosiers en écusson. semer les pois
mange. tout choux brocolis chi. corée scarole.
les haricots grimpants. fraises et cerises arroser.
copieusement melons. et concombres. on n’en sort
pas. on sort des morts. » (p. 125)
Le sens glisse d’un mot tronçonné à l’autre, principe du déplacement (métaphore) et de la condensation (métonymie), avec soupçon de verbigération autogérée comme par cet usage récurrent dans deux poèmes du passé simple « je pus » : « ciel bleu lune en nous / jour où nul oubli / s’annihile d’un pur jus / de je pus » (p. 162) ou « toujours trop peu je pus / et maintenant tout pareil / pareil maintenant / que le pus d’hier / le pus peu et / le peux plus / pas plus » (p. 175). Une identité entre pouvoir, puanteur et pus à verser au dossier du mâle hétérosexuel cisgenre (à sa décharge, bien sûr).
C’est une poésie presque parlée, des choses quotidiennes, qui tombent dans l’esprit et sous les sens.
Le cerveau encore plein de contrepèteries structurelles (jus, pus, je, peu), saisissons-nous à présent du « Quicktionnaire des antidouleurs ». Ah non, zut, il s’agit en réalité de l’Antidictionnaire des couleurs (éditions Unes). Un livre de Michel Toureau ? Ah non, Pierre Mabille. Celui-ci est aussi artiste, peintre, professeur de couleur (si, si) et spécialiste depuis 1997 d’une forme géométrique toute simple, qu’il décrit comme un « fuseau » ou une « mandorle » mais qui n’a en réalité aucun nom (tiens, tiens…).
Elle n’est en effet pas aussi vague que la mandorle, car elle est régie par des proportions précises : elle ressemble à deux fois une même section de sphère accolées. « Je la souhaitais difficilement identifiable, ni trop abstraite, ni trop significative, d’une géométrie floue, indéfinissable, ambiguë. Dans mon vocabulaire initial, il symbolisait le cyprès. Il a gagné en légèreté. » Le cyprès, associé à la mort, on ne sait jamais s’il vaut mieux l’avoir si près ou un peu plus loin : il marque le cimetière mais aussi la vie éternelle.
Cette forme sans nom a logiquement généré une liste infinie de termes approximatifs et échangeables (poésie religieuse ?), ce que Mabille appelle (après le critique Jean-Marc Huitorel) un « antidictionnaire » et qui, au lieu d’épingler le sens, l’ouvre et le disperse : « une barque, une Citroën 15 cv 1971 type smn, une boutonnière, un silex taillé, un pétale, une langue, une sucette, une languette, une pierre, un caillou, une bouée, … ».
L’Antidictionnaire des couleurs contient 16 pages de dessins en couleur, pour la plupart des détails d’un autre livre, Lavis, qui paraît parallèlement (éditions Unes/Galerie Jean Fournier). Lavis n’est pas en rose mais en noir et blanc, et la forme mystérieuse chère à l’artiste niche dans chacune de ses pages : à la fois en mode « Où est Charlie ? » et comme matrice générale, puisqu’on finit, à force de la chercher, par la voir partout et reformater toutes les images au diapason de notre investigation.
Dans L’Antidictionnaire des couleurs aussi, il s’agit pour le poète et artiste d’accumuler les « possibilités d’interprétation ». Dans le cas des couleurs, cela tombe bien : les délimiter dans le spectre consiste toujours à trancher de force dans la sensation et Mabille s’amuse en égrenant les fantaisistes « Blanc nuage » et le « Chevelure auburn » ou carrément le « Quatre couleurs » : « Je suis passé / today vers 15 h / prendre le courrier / dans le frigo / volé une figue / une bière / écrit sur une enveloppe / de bank au stylo / quatre couleurs je le / croyais perdu mais / non pas du tout / bonne journée ».
C’est une poésie presque parlée, des choses quotidiennes (mais pas « petites », sans niaiserie énamourée) qui tombent dans l’esprit et sous les sens comme les atomes de Lucrèce : « en coupant de l’ail rose en / tout petits dés je dis / bonjour madame la comtesse / et tu réponds salut mon pote / (les noms ont été changés) ». Mabille invoque souvent le beat Richard Brautigan, mais par-delà la position de « l’idiot » surpris devant chaque chose dans sa singularité, il peut aussi être plus tragique : « depuis vingt-quatre mille / quatre-vingt-dix heures / environ que je vis seul / je suis une guerre civile / à moi tout seul et la crise / contamine mes services secrets / taupe est un code couleur / pour mon tourment on n’y voit / rien tout est normal » (« Taupe »).
On empruntera à Mabille la conclusion de cet article-triumvirat, non sans avoir 1) renvoyé vers la concurrence (Sitaudis, Poézibao) pour une recension plus large des sorties poétiques et 2) engagé le·la lecteur·ice à neiger pour Noël : « Étant donné cet arrivage le très grand choix dont nous disposons pourquoi s’arrêter »
Jacques Barbaut, C’est du propre. Traité d’onomastique amusante, Editions Nous, 2020, 208 pages.
Charles Pennequin, Père ancien, Editions P.O.L., décembre 2020, 192 pages.
Pierre Mabille, Antidictionnaire des couleurs, Editions Unes, 2020, 88 pages.