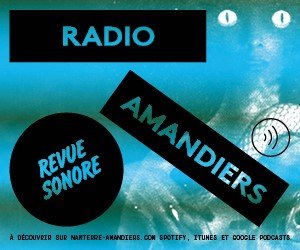River Deep Mountain High : les abysses et sommets vertigineux de Phil Spector
Regard exorbité, lèvres fines, presque pincées, traits affaissés par l’âge, perruque ébouriffée de personnage sorti d’un film de Tim Burton, Phil Spector ressemblait ces dernières années au « monstre » qu’il était et qu’incarna Al Pacino dans un téléfilm américain.
Nabab has been solitairement retranché dans son manoir de la banlieue de Los Angeles dans les années 90-2000, l’ancien monarque des juke-boxes avait été condamné à dix-neuf années de prison en 2009 pour l’assassinat d’une actrice de série Z, Lana Clarkson. Presque tout au long de sa vie adulte, Phil Spector fut un bon « client » pour les pages des tabloïds : riche, célèbre, puissant, excentrique, complexé par sa taille et son physique, porteur de postiches étranges ou de boots à talonnettes, paranoïaque, mélomane mégalomane, amateur d’armes à feu, caricature de mâle dominant à la fois rongé par ses failles et dévoré par son hybris, psychologiquement instable, parfois incohérent, puis finalement meurtrier, terminus logique d’une infernale boucle de folie.
Il se trouve que cet homme peu aimable fut aussi l’un des plus grands génies de l’histoire de la pop et du rock, l’égal des Brian Wilson, Paul McCartney, Marvin Gaye, Quincy Jones, Berry Gordy… Si le nom de Spector est peut-être moins gravé dans l’inconscient collectif que ceux des Beatles, Stones, Elvis ou Beyoncé, c’est parce qu’il n’était ni chanteur, ni musicien, ni même auteur-compositeur (il a co-écrit une toute petite poignée de ses tubes). Spector avait un rôle de l’ombre, moins connu du grand public mais tout aussi fondamental pour les pop connaisseurs : à l’instar d’un Berry Gordy (le fondateur et big boss de la Motown), il était producteur, dans tous les sens pygmalionesques que cette fonction pouvait signifier dans les années 50-60, à la fois découvreur et sélectionneur de groupes, metteur en scène de leur look et de leur jeu scénique, et surtout créateur d’un « son ».
Ce son, c’est le fameux wall of sound (« le mur du son », ou plus exactement, « le mur de son »), un empilement de voix, de chœurs, de guitares, de cuivres et de cordes, de clochettes et de castagnettes, rehaussé d’écho, organisé horizontalement selon la technique du mille-feuille et non verticalement selon les lois de la stéréo naissante de son époque. Spector était férocement attaché à la mono, ses chansons n’étaient pas pensées pour les chaînes high tech mais pour exploser dans les autoradios et les juke-boxes. Entasser quarante musiciens dans un studio pour une simple chanson, cela aurait pu donner une pop pompière, dégoulinante, surchargée, à la Queen ou à la Genesis. Or pas du tout : le miracle du son Spector est d’avoir su conjuguer le monumental et la finesse, le torrentiel et le gracile. On a souvent comparé le son Spector à l’architecture d’une cathédrale et c’est assez juste comme image de l’alliage entre le titanesque et la dentelle, comme métaphore de la profondeur d’un son où même le silence est palpable.
De 58 à 66, Phil Spector a fait tonner un déluge ininterrompu dans les transistors de ces cathédrales d’allumettes pop, de ce qu’on a appelé aussi des « petites symphonies pour les kids » : « To Know Him Is to Love Him », « Uptown », « He’s a Rebel », « Zip-A-Dee-Doo-Dah », « Then He Kissed Me », « Why Do Lovers Break Each Other’s Hearts », « Be My Baby », « Da Doo Ron Ron », « Today I Met the Boy I’m Gonna Marry », « Do I Love You », « Walking in the Rain », « You’ve Lost That Loving Feeling », « Unchained Melody », « River Deep Mountain High », sans oublier le Phil Spector’s Christmas Album, l’un des albums de Noël les plus beaux et les plus vendus de l’Histoire.
Tous ces bijoux en or sont ouvragés par les différentes formations du label Philles, les Teddy Bears, Crystals, Ronettes, Bob B. Soxx & the Blue Jeans, Darlene Love, Righteous Brothers ou autre Ike & Tina Turner, avec le maestro Spector à la baguette, et un fabuleux orchestre maison, le Wrecking Crew, assurant la cohésion musicale. Parmi ces pointures de studio, le pianiste Leon Russell, le batteur Hal Blaine, le guitariste Barney Kessel… Sonny Bono traîne aussi dans les studios Gold Star (l’antre de Spector à Santa Monica), le futur grand producteur Jack Nitzsche assiste Spector à la console. C’est toute une Spector team qui enchaîne les hits somptueux, déchirants, oscillant entre l’euphorie et l’élégie, enfilade de vitraux soniques éblouissants qui composent une des plus mirifiques chapelles sixties de la pop, aux côtés des inspirations géniales et schizophrènes de Brian Wilson, des rutilances British de l’attelage royal Lennon-McCartney ou de l’autre grande fabrique à hits des sixties que fut la Motown de Detroit.
Les productions Spector se distinguent par leurs mélodies accrocheuses, des vocaux canons et des textes qui synthétisent au mieux les préoccupations existentielles des adolescents américains.
Phil Spector était né en 1939 dans une famille juive du Bronx. À 10 ans, il vit la première tragédie de sa vie, qui gouvernera peut-être toute son existence : son père, Ben, met fin à ses jours en s’enfermant dans sa voiture et en s’étouffant aux gaz d’échappements. Un suicide au mode opératoire assez sidérant, cinq ans après la révélation d’Auschwitz au monde, pour cet homme juif américain qui avait échappé à la Shoah en vivant du bon côté de l’océan Atlantique. Le petit Phil est inconsolable. Sur la tombe du paternel, cette épitaphe : « To know him was to love him. »
Heureusement pour le garçon, il reste sa mère. Elle l’adore, c’est réciproque, d’un amour filial absolu, dévorant, étouffant. Pensez là à Woody Allen dans son segment de New York Stories, avec sa mère dans le ciel. Ou à Guy Bedos et Marthe Villalonga dans Un éléphant ça trompe énormément et On ira tous au paradis, cela donne une idée de ce que fut Mme Spector, qui débarquera souvent par la suite au studio Gold Star pour materner son fils devenu mogul.
Après le décès de Ben Spector, la famille déménage sous le soleil de Los Angeles. Face aux ados californiens le plus souvent baraqués, blonds et bronzés, le jeune Spector nourrit de sévères complexes en raison de son physique disgracieux, de sa petite taille, de son corps malingre, objets de railleries au lycée. Il ne tarde pas à en nourrir un état d’esprit revanchard et à partir à la conquête du music business, tel un Rastignac pop : à nous deux Hollywood !
De hasards en rencontres, sous la double égide de la chance et de la volonté féroce de réussir, Phil Spector entre dans le cercle de la fabuleuse compagnie Atlantic, fréquente Jerry Wexler, Doc Pomus et Ahmet Ertegun, participe à la fabrication de pépites soul-pop telles que « Spanish Harlem » et « Stand by Me » du grand Ben E. King. Il a 18 ans quand il forme son premier groupe, les Teddy Bears, et compose sa première chanson en hommage à son père dont il conjugue l’épitaphe au présent : ballade séraphique classique de ces années-là, « To Know Him Is to Love Him » devient son premier hit, il a 19 ans. Et devient millionnaire. Phil Spector était un génie et un businessman précoce. Il fonde son propre label avec un certain Lester Sill, Philles (assemblage de leurs deux prénoms), et c’est la pluie d’or sonique évoquée au paragraphe précédent.
Outre le son fantastique décrit plus haut, les productions Spector se distinguent par leurs mélodies accrocheuses, des vocaux canons et des textes qui synthétisent au mieux les préoccupations existentielles des adolescents américains. Prenons « Be My Baby », « Baby I Love You » et « The Best Part of Breaking Up », superbe brelan de hits des Ronettes décochés (et décrochés) dans cet ordre chronologique. En trois chansons de trois minutes est décrit tout l’arc amoureux que vivent la plupart des kids (et Spector lui-même, pas beaucoup plus âgé que son auditoire) : l’ivresse du désir (« Be My Baby »), sa cristallisation en plaisir (« Baby I Love You »), puis sa rupture (« The Best Part of Breaking Up »). Ce que Walt Disney était aux enfants, ou Louis B. Mayer aux adultes, Phil Spector le devient pour les ados : « the first tycoon of teens » (« le premier nabab des ados »), ainsi que l’avait défini Tom Wolfe.
Mais pas plus que chez Disney ou à la MGM, tout n’est pas que milkshake fraise, néons clignotants et délicieuses sonneries de tiroirs-caisses dans le royaume pop-rock de Phil Spector. L’homme est brutal, autoritaire, perfectionniste, il mène son écurie à la chlague, fait refaire vingt fois une partie vocale ou un son de clochette, ne connaissant ni week-ends ni 35 heures ni RTT. C’est aussi lui qui tire les principaux bénéfices financiers de sa poule aux œufs d’or, ne distribuant que la portion salariale congrue à ses chanteuses – car, on l’a remarqué, son écurie est composée à 90 % de girls groups.
Un jour, alors que les Crystals sont en tournée, Darlene Love enregistre « He’s a Rebel » : Spector sort le 45 trs sous le nom des Crystals, plus bankable à ce moment-là, sans prévenir les principales intéressées. J’ai eu l’immense privilège d’interviewer Darlene Love et La La Brooks, la principale chanteuse des Crystals, c’était en 2011 pour Les Inrocks. Si la première ne se montrait pas trop rancunière, La La Brooks avait encore en travers de la gorge les agissements de son Pygmalion cinquante ans après les faits :
« Phil nous faisait refaire sans cesse des prises, ça me rendait folle ! On avait parfois des journées qui allaient de midi à 5 heures du matin non-stop. Aujourd’hui, chaque fois que j’entends mes chansons à la radio ou dans un magasin au moment des fêtes de Noël, ça me rappelle que je n’ai quasiment rien gagné pour “Da Doo Ron Ron”, “Then He Kissed Me” ou “Santa Claus Is Coming to Town” ! Spector et nous, c’était comme un mariage à sens unique. Tous les avantages et bénéfices pour lui, rien pour nous. Si Phil n’avait pas été si égoïste, j’aurais été beaucoup plus à l’aise financièrement et je me serais mieux portée. Il a profité de moi alors que j’avais 15 ans. Ça a fait mal à ma mère, à mon père… Parfois, je fais la queue à la banque et la personne devant moi se met à fredonner “Da Doo Ron Ron” et je me dis que j’ai peut-être moins d’argent qu’elle. Ça fait mal. »
Maboul toxique en son domicile, génie absolu au studio d’enregistrement, Phil Spector a influencé tout un pan du rock et de la pop.
La La Brooks avait les mots justes en parlant de « mariage à sens unique ». De fait, Phil Spector a fini par épouser la chanteuse leader des Ronettes, la délicieuse Veronica « Ronnie » Bennett au splendide visage métissé afro-cherokee et au twang irrésistible dans la voix.
Un mariage catastrophe pour elle. Jaloux, possessif, parano, le nabab des teens enferme littéralement sa belle, lui interdit de sortir sans son autorisation, planque les clés de la maison et de la bagnole. Elle n’était pas la seule victime de ses coups de folie : Spector enfermait parfois aussi ses invités, ne les libérant qu’aux petites heures du matin comme s’il leur faisait une mauvaise blague. Un dingue. « To know him was to hate him ». De ce mariage toxique, Ronnie finira par se libérer en payant le prix fort : carrière ruinée, santé esquintée, alcoolique, dépressive. Dans les chansons les plus élégiaques des Ronettes, on croit entendre quelques échos de cette vie intime effroyable dans le vibrato déchirant de son chant.
Tyrannique au foyer, Spector l’était aussi dans son métier. Dévoré par le désir d’aller toujours plus haut, plus loin, plus fort, il épuise les Crystals et les Ronettes, rebondit puissamment avec les Righteous Brothers, un duo de faux frères et de blue eyed soul. En trois classiques (« You’ve Lost That Loving Feeling », « Unchained Melody » et « EBB Tide »), ils parviennent à repousser les limites de la majesté, de la profondeur et de la splendeur de la soul orchestrale. Avec Ike et Tina Turner, Spector veut produire le plus beau et plus puissant single de tous les temps : une ambition prométhéenne, wagnérienne, orsonwellesienne sur laquelle il se cassera finalement la gueule.
« River Deep Mountain High » est en effet une montagne russe aussi hénaurme que les profondeurs et hauteurs de son titre, le son est un roulis tectonique, Tina chante et vide ses tripes comme si elle avait cinquante fouets aux fesses (et malheureusement, on sait qu’avec ce salopard d’Ike, elle les a vraiment eus), mais la chanson s’avère être un échec commercial : l’époque est en train de changer, sous l’impulsion des Beatles, de Dylan et des Stones, le rock et la pop s’émancipent des fabriques à tubes. Grand single malade, « River Deep Mountain High » précipite la chute de la maison Philles. On est en 1966.
Maboul toxique en son domicile, génie absolu au studio d’enregistrement, Phil Spector a influencé tout un pan du rock et de la pop, des Beach boys à Bruce Springsteen, de Gainsbourg aux Beatles. C’est justement auprès des Fab Four de Liverpool que Spector se refait une santé professionnelle après la faillite de Philles. C’est lui qui reprend et arrange les bandes de l’album Let It Be, délaissé par le groupe qui a volé en éclats. Ces éclats, Spector en ramasse quelques-uns : il produit All Things Must Pass, triple album de George Harrison, ainsi que les premiers albums de John Lennon et son Plastic Ono Band. Avec eux, le son Spector se dépouille mais garde la marque de son écho et de son impact. L’ex-tycoon est donc encore là où il faut être en ce début des seventies, ajoutant d’autres classiques à son escarcelle de « producer maverick » : « My Sweet Lord », « Instant Karma », « Mother », « Imagine », « Jealous Guy », rien que ça.
Puis contre toute attente, il produit Leonard Cohen, véritable mariage de la carpe et du lapin. Que pouvaient bien faire ensemble le sage et paisible auteur de Suzanne et le fou furieux du son et de la gâchette ? Réponse, Death of a Ladies Man, album étrange, déroutant en son temps, et finalement assez bien poli par la patine des années. L’ultime production de Phil Spector sera tout aussi étonnante au premier abord mais finalement assez logique. Les Ramones ne sont-ils pas de faux frères, comme les Righteous Brothers ? Et ne sont-ils pas un boys group pop (derrière leurs guitares abrasives), pendant symétrique des girls groups des années Philles ? Les Ramones ont raconté les excentricités du producteur qui les menaçaient parfois avec son flingue entre deux refrains, mais il en a résulté un superbe album de power pop : The End of the Century est le chef-d’œuvre des Ramones et l’un des beaux faits d’armes (si l’on ose dire) de Spector.
Ensuite, la lumière s’est éteinte. De vague rumeurs parlaient d’un album produit pour Céline Dion qui serait resté lettre morte, ou au fond d’un tiroir. À partir des années 80, Phil Spector s’est enfoncé progressivement dans sa folie, vivant seul avec ses valets en livrée dans un manoir de la banlieue sud de Los Angeles, perché en haut d’une colline. Il paraît que l’escalier d’accès à la porte d’entrée faisait 88 marches. Quand son biographe, Mick Brown, décrit sa venue en ce lieu barré et sinistre, on ne sait pas si on est dans une scène d’Hitchcock, de Sunset Blvd, de Citizen Kane, de Shock Corridor ou dans une énième aventure du comte Dracula. Après quelques années au firmament du génie pop, Phil Spector a connu une inexorable et interminable chute, avec une fin minable, sordide : une actrice de série Z draguée au creux de la nuit au House of Blues, un club où elle était serveuse, ramenée chez lui, et gratifiée d’une balle au fond de la gorge. Du mur de son au mur de prison, il n’y avait qu’un court chemin sémantique.
L’homme n’était pas admirable, c’est le moins que l’on puisse écrire. Mais le producteur musical l’était, et comment. Le cas Spector, (comme Céline, Genêt, Polanski, Matzneff… ou même Duhamel), pose cette éternelle énigme humaine : comment chez un même être peuvent se mêler l’excellence et le glauque, le plus élevé et le plus bas. De Phil Spector, je retiendrai toujours le plus élevé : « Uptown » et « Then He Kissed Me » des Crystals, « Walking in the Rain » et « Is This What I Get for Loving You ? » des Ronettes, « You’ve Lost That Loving Feeling » et « EBB Tide » des Righteous Brothers, « River Deep Mountain High » d’Ike & Tina Turner, ou encore « Danny Says » des Ramones sont les plus belles chansons du monde. To hear him is to love him.