Un Américain à Marseille – à propos de Stillwater de Thomas McCarthy
Dans les décombres d’un ouragan, un homme coiffé d’un casque pellette. On ne sait pas bien si la maison est à lui, si cette ville sinistrée est la sienne, s’il est là pour aider, ou pour gagner sa croûte. Le voilà qui monte à bord d’un pick-up, entouré d’hommes qui ne parlent pas sa langue et s’étonnent de l’étrangeté de ce pays où on reconstruit à l’identique, comme si la catastrophe n’allait pas frapper, encore et encore. Ah les Américains, disent-ils. Ce peuple qui ne lâche pas l’affaire. Ce peuple qui a tant besoin de son foyer.
L’homme passe devant un drive-in, commande burger et triple boisson, rentre chez lui regarder la télévision. Cet homme-là est seul, bourru et triste, ne semble chez lui nulle part – et pourtant, on le reconnaît sous les peaux bouffies, les muscles légèrement affaissés, la casquette crasseuse, peut-être à l’acuité bleue des yeux. Cet homme, c’est Matt Damon, l’Américain, celui qui jusque là était partout chez lui.
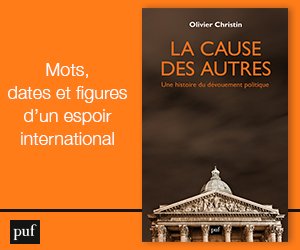
Stillwater commence par défaire tout un système de références au cinéma américain, de la fresque sociale au film d’espionnage en passant par le thriller, pour élaborer un lieu inconfortable d’abord pour le spectateur, mais qui finit par devenir hospitalier.
Stillwater, contrairement à ce que le titre suggère, n’est pas un objet tranquille. Si les premières scènes laissent présager un film social sur l’Amérique profonde, de ceux désormais bien connus qui dressent les portraits souvent complaisants de whites plus ou moins trash pris dans leur misère contemporaine, il bifurque en trois courtes séquences : un hall d’aéroport, un taxi français, une rue étroite dans la lumière méridionale, et plonge le spectateur dans un grand désarroi référentiel.
Dès le premier quart d’heure du film, Bill Baker est à Marseille. Il vient voir sa fille, qui purge depuis plusieurs années une peine à la prison des Baumettes, accusée du meurtre de sa petite amie. Matt Damon à Marseille, une jeune fille à innocenter, on peut à nouveau se croire en terrain connu. Les rouages simples du film de vengeance vont se mettre en branle, courses poursuites sous la Bonne Mère incluses : pas de panique jeune fille, ton père, c’est Jason Bourne. Mais stupeur, Bill prend ses quartiers dans une triste chambre d’hôtel avec zéro vue. Il se rend aux Baumettes en bus, et fait la queue parmi les cabas à carreaux. Il ne parle pas français, ne maîtrise pas la géographie de la ville, ne sait pas quels vêtements acheter à sa fille – bref, force est de constater qu’il n’est pas chez lui.
Stillwater commence ainsi par défaire, leurre après leurre, tout un système de références au cinéma américain, de la fresque sociale au film d’espionnage en passant par le thriller, pour élaborer un lieu inconfortable d’abord pour le spectateur, mais qui, par la finesse de l’écriture et de la mise en scène, finit par devenir hospitalier. De fait, il est transnational, fruit d’une collaboration entre un cinéaste américain, Tom McCarthy, et trois autres scénaristes parmi lesquels deux français, Thomas Bidegain et Noé Debré, connus pour avoir travaillé sur les films de Jacques Audiard, notamment Dheepan, qui avait reçu en 2015 la Palme d’or au festival de Cannes. De cette bigarrure franco-américaine résulte un film formidable, dont la singularité dialogue sans cesse avec les genres.
Il faut dire que Matt Damon incarne presque à lui seule une forme, celle du film d’action, tant il est pour le spectateur indissociable d’un personnage, le fameux Jason Bourne, agent secret ultra-performant héros d’une série de films sortis entre 2002 et 2016. On y songe d’autant plus qu’au gré de ses diverses missions, Bourne circule dans le monde entier, et dans bon nombre de villes européennes, parmi lesquelles Athènes, dont la géographie méditerranéenne n’est pas sans rappeler Marseille. On y songe encore plus lorsque Bill Baker se coiffe d’une casquette à rebords courbés, geste typique de Bourne, leitmotiv caractérisant d’un espion en permanente quête d’anonymat.
Cette casquette finira dans Stillwater par mordre la poussière, un soir où Bill s’aventure dans une cité des quartiers Nord à la recherche d’un jeune homme impliqué dans l’affaire de sa fille. Le corps de Matt Damon n’est pas – n’est plus – celui de Jason Bourne, il encaisse lourdement quelques coups, en rend maladroitement, et finit par s’écrouler sous les moqueries des minots du coin.
En s’insérant dans les mécanismes du naturalisme, le personnage modifie ses automatismes, et inversement, le naturalisme à la française façonne le protagoniste et lui donne une épaisseur singulière.
Matt Damon n’est pas chez lui, car ses assaillants n’appartiennent pas au même monde cinématographique. Avec leurs gueules et leur accent, ils sont aussi des types de cinéma. L’un deux – Idir Azougli – a d’ailleurs joué dans Bac Nord, l’autre film « marseillais » de cette rentrée, qui continue de rassembler, semaine après semaines, des milliers de spectateurs en salle. Bac Nord, film de truands fasciné par le cinéma américain, joue, lui, la manière contre le milieu. Son outrance impose de force sur une réalité sociale sensible – celle des quartiers marseillais régis par le trafic de drogue, une forme brutale et expéditive, dès les premières images de course-poursuite. Le titre s’affiche en gras, et voici qu’en contre-plongée un François Civil sous stéroïdes balade sur fonds de hip-hop la domination écrasante de la fiction hollywoodienne sur les quartiers Nord.
Stillwater propose finalement l’inverse : Bill, le biais américain, aborde Marseille et tout le réalisme social français avec respect, et dans la fusion qui s’opère, et qui tient parfois franchement du miracle, tient toute la tension du film. En s’insérant dans les mécanismes du naturalisme, le personnage modifie ses automatismes, et inversement, le naturalisme à la française façonne le protagoniste et lui donne une épaisseur singulière. Lorsque Bill et sa fille s’interrogent à plusieurs reprises sur leur tendance à reproduire leurs erreurs, sur le caractère héréditaire de leurs réflexes, on peut craindre le cliché du genre. Et pourtant, si le cycle bien connu tourne, il tourne singulièrement.
Une manière d’adroitement contourner le cliché en imposant pragmatiquement la singularité des expériences humaines
Cette réussite est aussi celle d’un couple déroutant d’abord mais qui s’avère passionnant, celui que Bill Baker forme avec une Française interprétée par l’actrice Camille Cottin, rencontrée à l’hôtel, qui va rapidement l’aider dans son enquête en lui servant d’interprète auprès de ses interlocuteurs marseillais. Virginie a une quarantaine d’années, et elle est comédienne. Elle essaie d’expliquer à un Bill qui n’a jamais mis les pieds au théâtre que son metteur en scène pratique l’écriture « au plateau », un travail qui requiert d’improviser, d’imaginer des situations sur scène pour créer les personnages et établir l’intrigue. Le récit s’échafaude en commun, et in situ. D’un certaine manière le film fait mine de reproduire la technique : on va prendre une équipe franco-américaine, on va mettre Matt Damon et Camille Cottin dans une maison à Marseille, et on va voir : qu’est-ce qui peut bien se passer entre ces deux personnages, le redneck taiseux et la bobo marseillaise ?
Les écueils sont grands, que le film ne se prive pas de thématiser dans des scènes qui pourraient être catastrophiques de démonstration, mais qui se frayent acrobatiquement un juste chemin. Lorsque Virginie invite pour la première fois Bill chez elle pour l’aider dans ses recherches, elle est accompagnée d’une amie. Agacée par la méfiance qu’elle montre face aux réflexes bourrus de Bill, elle la provoque : « Vas-y, pose la question ! » L’amie se lance en anglais : « Did you vote for Donald Trump? ». Bill se fige en un temps de pause. « Non », dit-il finalement. « J’ai fait de la prison, et je n’ai pas le droit de voter. » Dans cet évitement se lit toute la délicatesse de l’écriture, une manière d’adroitement contourner le cliché en imposant pragmatiquement la singularité des expériences humaines. Nous avions tort de croire en la représentativité des personnages. Bill, comme Virginie, ne représentent qu’eux-mêmes.
À mesure que la relation entre Camille-Virginie et Matt-Bill progresse, et qu’ils font famille à leur manière, étrange, bancale et chaleureuse, s’aménage une place pour le spectateur, invité à reconsidérer dans un étonnement fertile ses propres réflexes, ses références, son rapport au cinéma français naturaliste, si souvent décevant dans sa prévisibilité, et au bulldozer américain, formaté et bien-pensant. Quand, dans une dernière image poignante, Bill constate qu’après tout ce qui lui est arrivé il ne « reconnaît rien » – « I don’t recognize anything » –, on peut le remercier de, nous aussi, nous avoir permis de ne rien reconnaître.
Stillwater de Thomas McCarthy, sortie le 22 septembre 2021.
