Pour une réécriture de l’état d’urgence
La loi du 10 novembre 2021 a prolongé jusqu’au 31 juillet prochain le régime « provisoire » dit de « sortie d’état d’urgence sanitaire ». C’est la cinquième fois en un peu moins de deux ans que les parlementaires entérinent la décision du gouvernement, avec la caution du Conseil constitutionnel. Celui-ci a retoqué quelques rares mesures – celle, par exemple, permettant aux directeurs d’établissements scolaires d’avoir accès aux informations médicales des élèves et de les « traiter » sans devoir obtenir préalablement leur consentement[1] – mais il n’a jamais remis en cause le principe même du recours à un régime d’exception, ni la possibilité de le proroger indéfiniment.
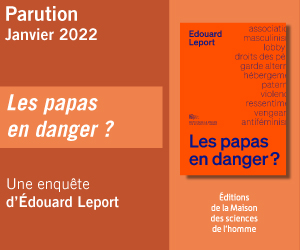
Les noms donnés aux textes ne doivent pas nous leurrer. Qu’il s’agisse de lois « prorogeant » l’état d’urgence ou de celles « organisant » sa « sortie », le régime et ses modalités d’application demeurent inchangés. Nous vivons en état d’urgence sanitaire permanent depuis le 23 mars 2020, de même que nous avons vécu en état d’urgence sécuritaire – dont de nombreuses mesures ont finalement été intégrées au droit commun – entre 2015 et 2017. Et puisqu’il n’existe aucun garde-fou institutionnel, rien n’indique que nous en sortirons en juillet 2022, à moins que la majorité issue des prochaines élections générales ne le décide. Mais dans un contexte de regain de l’épidémie et de pré-campagne électorale focalisée sur les questions d’identité et de sécurité, rien n’est moins sûr.
La crise que nous traversons doit nous faire réfléchir à la manière dont l’exécutif fait et défait le droit dans l’urgence, en quelques jours à peine. Certains diront que cela est nécessaire, d’autres que cela est même salutaire au nom du droit à la santé – que le Conseil constitutionnel a érigé en objectif à valeur constitutionnelle[2]. Mais tout cela est dangereux pour l’État de droit, dont l’érosion s’est accélérée à une vitesse inouïe ces vingt dernières années. Pour réfréner le phénomène, quoi de mieux que de réformer. Mais réformer en prenant le temps du débat, de la réflexion, de la contradiction, en prenant la mesure de ce que chaque modification implique. Réformer, en somme, après avoir réellement discuté.
Plutôt que de bricoler à la hâte des régimes d’exception en laissant entièrement en suspens la question de leur utilisation future, prenons le temps de repenser notre Constitution.
Cette réforme passerait par une révision de l’actuelle Constitution. Deux articles seraient supprimés en plus de l’abrogation des deux états d’urgence existants : les articles 16 et 36. Le premier prévoit l’octroi, « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est interrompu », des pleins pouvoirs au Président de la République. Le second – qui n’a jamais été appliqué – permet de décréter en Conseil des ministres « l’état de siège » sur une partie du territoire. La dangerosité de ces deux dispositions est dénoncée depuis longtemps et leur pertinence n’a jamais convaincu. On voit en effet bien mal un exécutif s’y risquer avec toutes les conséquences politiques qui s’y attachent.
Mais leur suppression ne va pas sans la rédaction d’une disposition introduisant un nouvel état d’urgence. Que les choses soient claires : l’idée n’est pas de constitutionnaliser ce qui existe déjà (l’état d’urgence sécuritaire, antiterroriste et l’état d’urgence sanitaire) mais bien de créer de toutes pièces un nouveau régime d’exception. Cela offre plusieurs avantages.
Sur le strict plan du débat public, le projet de révision permettrait d’abord que l’état d’urgence soit enfin discuté, qu’il soit collectivement discuté – il l’est toujours mais après avoir été adopté, c’est-à-dire lorsqu’il est déjà trop tard. Universitaires, magistrats, avocats et praticiens du droit seraient associés à la rédaction de la nouvelle disposition et avertiraient des dangers inhérents à telle ou telle mesure. Pour la première fois, le processus d’élaboration échapperait à l’urgence et à l’accelerando du temps politique. Il ne suffirait pas qu’une majorité simple se fasse dans les deux assemblées pour que le texte soit adopté – on sait d’expérience qu’hors période de cohabitation, elle est toujours acquise à l’exécutif sous la Ve République. Ce serait alors aux citoyens, par la voie du référendum, ou au Parlement réuni en Congrès de décider.
Sur le plan du contrôle juridictionnel, le nouvel état d’urgence serait placé sous le contrôle du juge judiciaire. Ce serait une manière de lui redonner voix alors que sa compétence en matière de libertés publiques n’a cessé de se réduire. L’article 66 de la Constitution assure qu’il est « gardien de la liberté individuelle ». C’est lui qui, normalement, décide de limiter la liberté d’un individu ou de l’en priver. Mais la décision n’est prise qu’après une discussion où les intérêts en présence sont débattus – c’est le principe du contradictoire ! À l’inverse, lorsque ce pouvoir est transféré à l’autorité administrative (aux préfets, aux ministères), le bien-fondé de la mesure n’est pas discuté. Il peut certes l’être mais a posteriori, c’est-à-dire après que la mesure a déjà commencé à produire des effets.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi en 2015 du problème posé par les assignations à résidence de personnes suspectées de terrorisme. L’état d’urgence avait opéré un transfert de compétence : ces mesures n’étaient plus prononcées par un juge mais par l’administration. Le Conseil constitutionnel avait trouvé la ruse pour ne pas désavouer le gouvernement. Il distinguait les mesures privatives de liberté qui continuaient de ne relever que de la seule compétence du juge judiciaire des mesures restrictives de libertés qui, elles, pouvaient être prononcées préventivement par l’administration et ensuite être contestées devant le juge administratif[3]. Or, en deçà de douze-heures par jour, une assignation à résidence ne serait « que » restrictive – et non privative – de liberté[4]…
Pour être complet, il faut encore dire que les états d’urgence existants sont placés sous le contrôle d’un juge administratif un peu particulier : le juge des référés. Ses compétences ne sont pas les mêmes que celles du juge administratif ordinaire. Il est un juge de l’urgence et donc un juge du provisoire. Il ne statue pas au fond.
Cette problématique était au cœur de la décision « J.M.B. et autres c. France » rendue par la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 2020. Le contexte n’était certes pas le même. Il était question de conditions de vie en prison et non d’état d’urgence. Les requérants (des détenus) saisissaient la Cour européenne d’un double problème : les conditions de vie déplorables en prison et l’absence de contrôle juridictionnel sur celles-ci, c’est-à-dire l’impossibilité pour le juge – judiciaire ou administratif – de se prononcer sur le fond du problème et de leur donner satisfaction : une remise en liberté ou l’amélioration des conditions d’incarcération.
C’est le second point qui posait réellement problème. Le premier n’était pas discuté. Le juge des référés du Conseil d’État avait plusieurs fois reconnu que les conditions de vie dans certaines prisons françaises étaient telles – « vétusté », « promiscuité », « présence de rats et d’insectes nuisibles » – qu’elles exposaient les détenus, non seulement à un traitement inhumain et dégradant mais également au risque « caractérisé et imminent » de perdre la vie[5]. Mais il n’apportait aucune solution pérenne.
Il se contentait – et encore dans certaines affaires seulement – d’ordonner à l’administration de désinsectiser et de dératiser l’établissement. Pour le reste, il se défaussait sur les pouvoirs publics. Sa compétence se limiterait aux seules mesures provisoires. Or, la réalisation de « travaux lourds » au sein des prisons et l’allocation « aux services judiciaires et pénitentiaires de moyens humains, matériels et financiers supplémentaires » relèveraient de « mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique[6] ».
La situation était ubuesque : le juge des référés du Conseil d’État admettait l’existence d’un problème structurel grave mais estimait ne pas pouvoir y remédier, faut de compétence. Mais comment, alors, expliquer l’exception qu’il avait lui-même introduite ? Il rappelait en effet que « ces mesures [celles relevant de sa compétence] doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte[7] ».
On a là un exemple-type des problèmes d’effectivité et de justiciabilité des droits fondamentaux. C’est précisément ce que contestaient les requérants dans l’affaire « J.M.B. et autres c. France ». Sans surprise, la Cour leur donnait raison. Elle estimait que le juge des référés ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’il ne permettait pas « de faire cesser ou d’améliorer » la situation des requérants[8]. C’est pourtant ce même juge des référés qui est chargé de contrôler les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire…
Dans ce contexte-là, le juge des référés a d’ailleurs montré combien il était réticent à désavouer le gouvernement. Les occasions n’ont pourtant pas manqué. Entre mars 2020 et avril 2021, le juge des référés du Conseil d’État a examiné quelques 647 recours sur des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire[9]. Il n’a prononcé leur suspension que dans 50 affaires, soit à peine plus de 7,5 % des cas[10]. Il y a bien des éléments d’explication. Au début de la crise, le juge administratif n’a sans doute pas voulu ajouter à la confusion à un moment où les informations et les données scientifiques d’un jour étaient desdites le lendemain.
Que dire, ensuite, du Conseil constitutionnel, qui a validé l’immense majorité des mesures voulues par le gouvernement parmi lesquelles la création d’un passeport vaccinal donnant accès à tous les lieux non essentiels accueillant du public. Dans toutes ces affaires, le Conseil constitutionnel s’est réfugié derrière les mêmes arguments : (i) il ne disposerait pas d’un pouvoir d’appréciation semblable à celui de législateur ; (ii) le législateur aurait « assuré une conciliation équilibrée » – sans que cela soit toujours réellement vérifié – entre « l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé » et les différents droits et libertés : liberté d’aller à venir, liberté de se réunir et droit d’expression collective des idées et des opinions, droit au respect de la vie privée et familiale etc.[11] On se trouve donc une situation où la marge de manœuvre du gouvernement est la plus grande et où le contrôle juridictionnel exercé sur lui est le plus faible.
Sur un plan procédural enfin, la constitutionnalisation d’un nouvel état d’urgence passerait par la création de freins, de contrepoids. Il ne pourrait être prorogé que par une majorité renforcée. Plusieurs constitutions dites « transitionnelles » comprennent ce type de mécanismes. C’est par exemple le cas de la Constitution sud-africaine post-apartheid de 1996. Les §§ 1 et 2 de l’article 37 autorisent le Parlement à déclarer l’état d’urgence par le simple vote d’une loi (« an Act of Parliament ») dans des cas limitativement énumérés et pour une durée maximum trois mois. Au-delà, il faut une majorité d’au moins soixante pour cent des parlementaires.
Pourquoi ne pas importer ce type de mécanisme en France ? Proroger un régime d’exception, soit, mais à la seule condition qu’un consensus politique se fasse et que la prorogation soit entérinée par une majorité renforcée croissante – ou une « supermajorité[12] », pour reprendre l’expression de Bruce Ackerman, célèbre professeur de droit et de science politique à la Yale Law School : soixante pour cent, soixante-dix pour cent et, pourquoi pas, quatre-vingt pour cent.
La « constitutionnalisation » de l’état d’urgence a bien sûr sa part de risque. De nombreux constitutionnalistes la craignent, s’y opposent. Elle serait la porte ouverte à toutes les dérives. La critique est entièrement légitime. Mais comment ne pas s’inquiéter du vide laissé par la Constitution de la Ve République ? Elle est une brèche dans laquelle s’engouffrent l’exécutif et sa majorité à l’Assemblée nationale dès qu’ils doivent faire face à une crise. Le Conseil constitutionnel le leur permet, en rappelant chaque fois qu’il en a l’occasion que l’article 34 « n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence[13] ».
Ailleurs en Europe, c’est un autre drame qui se joue mais selon un schéma proche du nôtre. En Hongrie, c’est par un vote du Parlement que Vitkor Orban s’est octroyé les pleins pouvoirs et a mis en place un état d’urgence qu’il peut prolonger indéfiniment.
Il y a peu de chance, on en conviendra, pour que le même scénario se réalise en France. Mais il n’en demeure pas moins que la Constitution est le seul rempart face à de telles dérives. La garantie n’est pas totale. De toute évidence, elle ne le sera jamais. Mais plutôt que de bricoler à la hâte des régimes d’exception en laissant entièrement en suspens la question de leur utilisation future (et de leur éventuel dévoiement), prenons le temps de repenser notre Constitution. La crise du Covid-19 n’est sans doute pas la dernière. Tout laisse à penser que nous allons au-devant de nouvelles crises sécuritaires, sanitaires et environnementales. Anticipons donc et n’attendons pas la prochaine.
