Se sentir plus vivant – sur Vide Sanitaire de François Durif
François Durif est-il artiste, croque-mort, écrivain ? Son récit Vide sanitaire, publié par les Éditions Verticales, nous renvoie à chacune de ces occupations en racontant les promenades-performances littéraires qu’il réalise dans les cimetières, emmenant un petit groupe d’inconnu·es au fil des mots et des pas entre les tombes. Il arpente un terrain qu’il connaît bien, en ancien professionnel des pompes funèbres. Le temps de sa promenade dans le cimetière, il revêt cet habit de croque-mort, si bien qu’il s’agit également pour lui d’une balade dans le temps, dans ses années passées au métier.
Mais s’il est artiste, pourquoi un tel besoin de littérature pour ré-endosser ce costume de « maître de cérémonie » ? Peut-être parce que ce passé dans les pompes funèbres avait quelque chose d’une inscription, comme celles qui ornent les tombes. Plus significativement, une inscription dans la société – et qui est autant une façon de se remémorer et d’être remémoré.
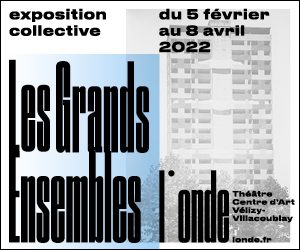
L’art est plus invivable que la mort…
À cette place de croque-mort, finalement, il y aura également des choses laissées derrière soi comme le fait un artiste, des choses plus terre-à-terre (voire six pieds sous terre). Mais ces choses auront compté, de façon franche et nécessaire, pour ces gens croisés au moment charnière d’un deuil, d’un passage sous la terre ou dans le feu de la crémation. Pour le personnage délicat que dessine le récit, habité par un doute et une forme de risque permanent – risque accru à l’endroit de l’art – que tout s’effondre, que tout s’enlise, que tout dysfonctionne, l’habit du croque-mort est à la fois une grande responsabilité et un grand soulagement.
C’est un souffle possible : après la mort des gens, il y a comme une occasion de se sentir plus vivant. C’est une question de place. Non qu’on se trouve trop serré et trop en concurrence dans nos relations humaines – bien que le texte fasse état de ce qui serait l’équivalent d’une tension immobilière pour les mort·es, la réduction des espaces de mise en terre et leur prix croissant à Paris, la répartition sociale des lieux , des temps et de la qualité des espaces qui leur sont consacrés évoluant en conséquence – mais parce que l’artiste en mal de création trouve sa propre place, dans la société, à cet endroit étrange de la mort. À cet endroit justement, il s’ouvre une brèche où les gens quittent la société. « Est-ce que vous savez s’il reste de la place dans la sépulture pour accueillir un nouveau corps ? »
Dans cette brèche, le croque-mort trouve sa place. Personnage sobre et discret, il échoue s’il en fait trop, on l’attend moins dans le blanc ou le noir que le gris discret de son costume anthracite et de ses gestes. Il ouvre la voie au passage du cercueil, ouvre la voix aux hommages des proches en les encourageant. Il œuvre là avec elleux, dans ce moment étroit entre la mort et la terre ou les cendres, un moment parfois trop bref pour qu’une personne encore choquée par le chagrin puisse s’en emparer tout à fait. Un temps circonscrit. Entre le jour du décès et celui des obsèques, tu disposais de six jours pour l’organisation du convoi ? Un cadre à respecter. […] Tu avais alors le sentiment d’avoir accompli ta mission. »
Mission plutôt qu’œuvre, et promenade plutôt que performance. Car pour obtenir l’autorisation de déambuler en groupe dans le cimetière, l’artiste substitue la promenade à la performance ; c’est plus acceptable – et moins effrayant parce que justement moins artiste : « promenade littéraire – derrière ce nouvel intitulé, je fais ce que je veux. »
Ce qu’il veut ou désire, c’est proposer des balades publiques dans les cimetières comme un guide. Mais c’est un guide qui ne connaît pas bien son chemin, un guide dans l’errance : qui promène l’attention sur les choses, l’air, le vent, la pluie, la lumière particulière et glisse des mots inscrits sur les tombes à ceux qui sont inscrits dans sa tête, glisse de la forme des pierres, des arbres, des lieux, aux formes des œuvres qui accompagnent son imaginaire. De la pierre tombale au cube de Giacometti. À moins que ce ne soit à l’inverse encore une fois, dans un même glissement doux : croque-mort plutôt qu’artiste, promenade plutôt que performance, la vie plutôt que l’art.
Au fond, les performances passées que raconte François Durif allaient en ce sens : « Invité en 2001 à intervenir dans l’appartement d’un jeune couple, dans le cadre d’une exposition collective, j’ai endossé l’habit d’homme d’intérieur, en y faisant le ménage à fond pendant six heures d’affilée ». Le nettoyage d’un appartement de fond en comble en guise de performance, ou encore occuper la place d’un gardien de lieu d’exposition, rentrer dans la vie non-artiste, le quotidien : ranger et se ranger en quelque sorte. Glissement de la forme vers l’informe, ou plutôt de la forme artistique vers les formalités de la vie – dont les formalités de la mort font partie.
Le geste du peintre demeure dans celui du « plâtrier-peintre » que François Durif devient pour une autre performance en 2002 ; Giacometti reste dans l’horizon de la pierre tombale. L’art ne disparaît pas, mais il s’ancre mieux ainsi, de façon plus vivante, ou plus vivable. Il se donne dans les quelques mots de poésies qui accompagnent le recueillement des proches ; dans les formes qu’on donne aux tombes, les symboles, les images, les chansons qu’on rassemble à ces moments qu’on doit justement vivre, c’est-à-dire traverser avec les vivant·es.
Ainsi Vide sanitaire parle bien d’art, mais toujours par le détour, comme si une approche frontale de ce mastodonte (en termes de statut social, de marché, d’implications théoriques et esthétiques, mais aussi sur le plan des émotions et de l’histoire personnelle du narrateur) était impossible, invivable – combat inégal. Il est même plus vivable de parler de la mort : telle qu’elle a été le domaine professionnel de François Durif, qui glisse de son habit d’artiste à celui de croque-mort, à la suite d’une période de chômage et d’une réorientation professionnelle opérée par Pôle emploi, la mort est une nouvelle vie.
Artiste, c’est mort
Au dos du livre, une courte biographie indique : « François Durif vit et travaille et meurt et renaît à Paris ». Les dates ne sont pas précisées, ce qui laisse le loisir de s’intéresser à cette mort antérieure. Si la vie nouvelle est sa mission dans les pompes funèbres, peut-être est-ce la mort de l’artiste qui a précédé et laissé place au croque-mort. Peut-être est-ce plus précisément la vie d’artiste qui l’a laissé pour mort, ainsi que le suggère la réponse à la question que lui pose la conseillère de Pôle Emploi : « Vous voulez travailler avant ou après la mort ? »
Après donc, puisque croque-mort. Mais « après la mort » de qui ? De qui fallait-il attendre la mort, ou qui fallait-il faire mourir pour trouver à travailler de nouveau ? Au fil du texte, divers fantasmes de mort – et de faire mourir – sont évoqués. La mort du père est évoquée dans l’étrange et douloureuse image d’une voiture, proche de l’accident : « Tant que le fils prend la place du mort, le père tient encore le volant ». En fin de récit, c’est Houellebecq que l’auteur assassine en rêve. Si dans le scénario de son rêve il n’est pas le vrai meurtrier, le simple fait de rêver – rêver, imaginer, écrire – le rend coupable. Il a pourtant un alibi : il travaillait, ainsi que c’était véritablement le cas de François Durif, à sa sortie des Beaux-Arts de Paris, en tant qu’assistant dans l’atelier de Thomas Hirschhorn.
Mais – est-ce parce qu’il ne travaillait pas à l’une de ses propres œuvres, et que ce travail ne justifie donc pas nécessairement de sa présence ? – son alibi tient mal. Hirschhorn lui vient en aide, mais il est depuis le début du récit une figure ambiguë. Possiblement objet du fantasme de meurtre, le H de Hirschhorn redoublé par deux fois en écho avec celui de Houellebecq (« plus besoin de tuer le Père, qu’il ait la gueule de Houellebecq ou celle de Hirschhorn »), il est aussi le potentiel meurtrier de l’affaire : celui qui signe au final les œuvres et les crimes. La description des années dans son atelier va progressivement dans ce sens : cinq ans en tout, cinq ans dans « l’antre de Thomas », cinq ans dans le trou, cinq ans suffisent pour tuer quelque chose à l’intérieur du jeune artiste tout juste sorti des Beaux-Arts.
Le passage le plus saisissant est ainsi introduit par une seule phrase de Hirschhorn qui, à la recherche d’un ouvrage de Derrida, se trompe de titre et demande au narrateur de lui trouver Als ob ich tot wäre – « Comme si j’étais mort ». C’est une erreur étrange, non seulement par la fiction d’un ouvrage qui n’existe pas, mais par le décalage qui rend Hirschhorn auteur de cette phrase, que Durif aurait pu, aurait dû formuler lui-même, puisque c’était bien « la petite phrase qui [le] taraudait de l’intérieur ».
Assistant d’un artiste plutôt qu’artiste, œuvrant à l’œuvre d’un autre, « comme si j’étais mort, comme si, dedans moi, c’était mort, comme si je trimballais un mort, comme si mon désir, depuis longtemps, il était mort, comme si, en tant qu’artiste, c’était mort, comme si, socialement, j’étais déjà mort […] est-ce pour cela que je m’étais jeté dans la gueule du loup, est-ce pour cela que je m’étais vendu à un plus fort que moi, j’arrivais à faire pour lui ce que je n’arrivais pas à faire pour moi, j’avais laissé entrer le loup dans la bergerie, il avait fini par le grignoter la tête, comme s’il était chez lui chez moi, il venait s’y ébrouer, quand bon lui semblait, tandis que mon espace intérieur s’étiolait à vue d’œil. »
La vie d’artiste pèse et met en terre ; des années après son désir chôme encore. À Pôle Emploi, la question permet de rebondir sur cette mort : « François Durif – artiste » passe sous terre, et pour quelques années exerce le métier de « croque-mort », une vie nouvelle. Il travaille donc « après la mort », celle des gens dont il organise les devis obsèques, cérémonies, crémations, inhumations… et la mort de son propre désir qui l’a mené au chômage, après un tarissement progressif, d’une performance à l’autre.
L’évocation des lieux de drague gays parisiens va dans ce sens : autant dans l’expérience du narrateur qui raconte comment l’acte érotique devient trop facilement une façon de se vider, que dans l’expérience de la ville qui se vide peu à peu de ses lieux de drague publics « tous ces lieux ont été ratissés, réhabilités, mis aux normes – le temps des lucioles est écoulé, les années sida ont décimé, les témoins et survivants ont modifié leurs trajets : trop de fantômes, leurs voix sont devenues inaudibles. Que reste-t-il de ces vies qui s’étiolent, de ceux qui sont morts ? »
La promenade sur les lieux (des) mort·es fait émerger cet autre désir : celui de donner place, parler pour ou à, propos à leur propos – ou en prosopopée, cette figure de style qui permet entre autres de faire parler les mort·es. François Durif est « maître de cérémonie » : dans son habit de croque-mort, il est rare qu’il prononce ses propres mots. Il fait parler les poètes, les artistes, lit des textes d’auteurices, certain·es sont mort·es.
Mais le plus important est la prosopopée inversée qui lui permet de faire parler les vivant·es, les proches, celleux qui sont là. Comme cette femme, veuve, qui n’entend pas grand-chose aux « choses trop compliquées » qu’il lui donne à lire mais qui lui délivre son propre texte, l’un des plus poignants du collage de voix restitué par François Durif :
« faut tout prendre sur soi
faut tout faire seule
on était jour et nuit dehors
[…]
on ne peut pas laisser une journée sans travail
personne à qui parler
le manque c’est quand même la présence
je dors toujours du même côté
[…]
le lit est froid, le lit est très froid
j’ai toujours su qu’il m’aimait, mais
j’ai souvent trouvé qu’il m’aimait mal
l’autre est toujours autre
(ce qui me manque)
[…]
je fais couple avec un mort
l’homme que j’aime est mort
[…]
il m’arrive aujourd’hui de dormir de son côté »
Celleux qui remettent l’art à sa place et sa place au temps
À l’évidence, le geste de l’artiste seul prend trop de place pour en donner. Que faire alors de ce désir qui se promène dans les mots parce qu’il a besoin de se perdre dans mille questions préalables et rebrousser les chemins de mille articulations théoriques indémêlables, mais qui se promène trop pour rester tout à fait dans la littérature ?
François Durif trouve sa place, qui n’est pas celle de son temps d’artiste révolu, de son temps de croque-mort révolu. C’est celle de son temps contemporain, puisque le temps est à cette porosité douce qui permet de se promener d’une voix à l’autre, d’une pratique à l’autre, et d’une mémoire à l’autre.
Dans Vide Sanitaire, un écho doux se propage au fil du livre. « [Hirschhorn] est le mieux placé pour prendre ma défense et confirmer mon emploi du temps le jour du meurtre » à propos du meurtre de Houellebecq, figure tutélaire de la littérature contemporaine ; « Finalement, cet emploi du temps te convenait », à propos du métier de croque-mort. Et à propos de Marcel Duchamp, figure du désir et de son travail, s’il en est, cette phrase d’Henri-Pierre Roché : « Sa plus belle œuvre est l’emploi de son temps. »
À quoi passer son temps, au quotidien, à quoi passer sa vie, jusqu’à la mort ? La lecture de cette phrase m’a retournée, ou s’est plutôt retournée dans ma tête : à propos de Duchamp, mais aussi Durif et de bien d’autres noms encore, auxquels porter notre attention. Toujours à propos d’une figure du désir : « sa plus belle œuvre est l’emploi de son temps » : c’est-à-dire qu’il s’emploie à son, à mon, à notre temps contemporain.
François Durif, Vide sanitaire, Éditions Gallimard/Verticales, 2021, 312 pages.
