Hallucinations collectives ? – à propos de certains engouements unanimes récents de la critique cinéma
Je suis un critique de cinéma vétéran qui va moins souvent aux projections de presse et rattrape certains films dans des conditions « normales », soit après leur sortie et leur accueil critique, en salle, au milieu du public non professionnel. Ainsi ces dernières semaines suis-je allé voir Annette, Licorice Pizza et The Souvenir en étant particulièrement motivé par une réception critique dithyrambique et un bouche-à-oreille favorable.
Pour Annette, le désir allait de soi pour moi puisque j’admire Leos Carax depuis ses débuts et que je n’oublierai jamais l’exclusif et fantastique entretien qu’il avait accordé aux Inrocks au moment des Amants du Pont-Neuf. Pour Licorice Pizza, c’était moins évident : je suis généralement peu réceptif au cinéma de Paul Thomas Anderson mais j’étais très attiré par ce que ce nouveau film promettait de légèreté, d’esprit pop-rock, de renouvellement de la part de son auteur, de découverte de jeunes acteurs et de regard sur Los Angeles, une ville où j’ai vécu durant la moitié des années 80. Enfin, concernant The Souvenir et Joanna Hogg, je n’avais jamais entendu parler de cette cinéaste anglaise mais son film portait la promesse de la découverte d’une œuvre et d’une artiste, promesse toujours aussi désirable pour le spectateur que je suis après cinquante années de cinéphilie dont trente-cinq de critique et de journalisme.
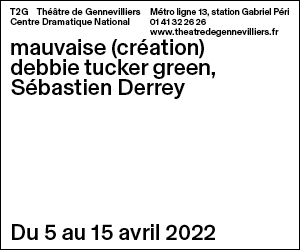
Il se trouve que j’ai été extrêmement déçu par ces trois films, douche aussi froide que fut brûlante l’unanimité louangeuse les accueillant. (J’aurais pu ajouter Un Autre monde de Stéphane Brizé à cette petite liste de déception, mais les journaux les plus sérieux en matière de critique cinéma avaient déjà exprimé leurs réserves au milieu d’un concert médiatique majoritairement élogieux).
Que l’on comprenne bien le propos que j’entends développer : les désaccords entre critiques (et spectateurs) sont chose courante (et même souhaitable) mais il ne s’agit pas exactement de cela ici. Ce qui m’a étonné, qui s’est répété trois fois, et qui suscite ce texte, c’est l’écart entre ce que je pensais de ces films et la haute intensité quasi-unanime des louanges dont ils avaient bénéficié. Je me suis interrogé. Étais-je le seul à éprouver des réserves sur ces films ? Suis-je désormais déconnecté des goûts actuels, ringard, largué, touché par une forme d’incompétence critique, bon pour la retraite et l’EHPAD ? Ou bien seraient-ce les critiques qui, sans se concerter, ont été sujets à une forme d’hallucination collective, mêlant phénomène inconscient de panurgisme et puissant désir d’aimer et de célébrer le cinéma après les interruptions dues au Covid ? Tentative d’élucidation en trois mouvements.
1) Annette, Licorice Pizza, The Souvenir : une réception critique qui a ressemblé à un blitzkrieg promotionnel
Pour mesurer l’impact critique autour de ces films, il suffit de consulter le site Allociné. Annette recueille ainsi douze cotes de 5 étoiles (dont Le Monde, Télérama, Cahiers du cinéma, La Septième obsession, Transfuge…) et dix cotes de 4 étoiles (dont Libé, Les Inrocks, Positif, L’Obs, Rolling Stone…). Seuls bémols, Le Figaro (mais c’était attendu, Éric Neuhoff n’aime ni Carax ni le cinéma moderne) et le site Critikat.com. Derrière les étoiles, les superlatifs pleuvent : « œuvre démesurée, d’un lyrisme absolu… Grisant, magique, captivant… chef d’œuvre… opéra rock flamboyant… geste artistique incontestable… exultation de cinéma d’une audace et d’une invention ébouriffante… ». Dans ce tsunami de louanges, seul Critikat.com détonne en évoquant « un grand film malade préfabriqué ».
Pour Licorice Pizza, l’accueil est digne de la Pravda : dix-huit cotes 5 étoiles, dix-sept cotes 4 étoiles, et… rien en-dessous. Des Cahiers à Positif, de Libé au Parisien, des Inrocks à Voici, et même du Figaro à Critikat.com, tout le monde adore ce film, réunissant dans l’admiration des rédactions et des critiques qui ont rarement les mêmes goûts. Là encore, c’est la farandole des extases : « état de sidération douce… extraordinaire teen movie… long métrage virevoltant… le plus aérien, le plus charmeur, le plus trivial de tous les films de PTA… pur plaisir… pur joyau… ruisselle de nostalgie luisante… la fougue et l’innocence d’un premier film… ». Seule fausse note dans cette symphonie du sublime, celle de Jean-Marc Lalanne au Masque et la plume, qui a évoqué la virtuosité frimeuse et vaine de PTA.
The Souvenir a collectionné lui aussi les médailles critiques. Quatorze cotes de 5 étoiles (dont Les Inrocks, Positif, Transfuge, Télérama…), sept cotes de 4 étoiles (dont les Cahiers, La Septième obsession, Première…). Là encore, le mercure critique a explosé le thermomètre : « puissant récit d’amour et de deuil… ce n’est pas un film, c’est une apparition… une combustion permanente… une caresse gantée… quatre heures de pure intelligence et de délicatesse… une des révélations majeures de Cannes… oscille avec grâce entre épure et onirisme… geste cinématographique saisissant… ». Parmi la critique sérieuse, seule Sandra Onana dans Libé a exprimé des bémols marqués : « Le résultat n’offre pas la révélation annoncée, et on le rangerait plutôt sur l’étagère des œuvres oubliées sitôt vues… ».
2) Quelques bémols : ce que je pense de ces films
Évidemment, ces films ne sont pas plus des navets à mes yeux qu’ils ne sont les chefs-d’œuvre (presque) partout proclamés. Il ne s’agit pas ici de prendre le contrepied absolu de ce qui a été publié, mais d’apporter un peu de nuance, de faire un peu de travail critique justement, plutôt que d’entonner le refrain unanime de la célébration.
Repensant à Annette, je reprendrais la vieille formule truffaldienne déjà utilisée par Critikat.com de « grand film malade ». Tout le talent de Carax ne s’est pas évanoui et Annette comporte des fulgurances, malheureusement noyées dans un ensemble boursoufflé, grandiloquent et d’une noirceur trop absolue et trop assénée. Le film démarre splendidement par sa propre mise en abyme signée Carax (y compris avec sa présence à l’écran et au son), mais passée cette jubilatoire ouverture, Annette ne cesse ensuite de donner des coups au spectateur, de le saouler d’assombrissement agressif, oscillant entre éclats de beauté et pompiérisme. Annette nous soulève, puis nous assomme, nous enfonce, semble ployer puis crouler sous les lourdeurs de sa production.
Le film souffre aussi d’un déséquilibre patent entre le personnage masculin (un mâle toxique), et le personnage féminin (une victime). Il est clair que l’énergie créatrice de Carax est entièrement vampirisée par Adam Driver, laissant à Marion Cotillard les miettes d’un rôle frisant l’insignifiance. Il est d’ailleurs étonnant que la jeune garde critique férue de female gaze n’ait pas pointé cet aspect du film, fruit d’un réalisateur entièrement fasciné par son acteur et son protagoniste masculin, fût-il toxique.
Autre facette discutable du film, le parallélisme qu’il suggère entre l’œuvre et la vie privée. Adam Driver joue un époux maléfique qui est aussi un stand-up comic agressif, malaisant et pas vraiment drôle, alors que Marion Cotillard joue une victime de féminicide après avoir incarné toute sa carrière des héroïnes d’opéra qui finissent par mourir. Fusionner à ce point les êtres et leurs œuvres, c’est gênant pour qui a toujours tenu pour principe cardinal de les séparer (comme on sépare la réalité et le fantasme).
Signalons enfin que la BO des Sparks n’est pas franchement inspirée, ne proposant aucun thème mémorable (hormis So may we start, la chanson d’ouverture), ce qui est évidemment gênant pour une tragédie musicale. Après le feu d’artifice créatif de Holy Motors, Annette descend de plusieurs étages. Le précédent film de Carax était fait avec peu de moyens et des tonnes d’idées, Annette, c’est le contraire : énormément de moyens et moins d’idées.
Côté Licorice Pizza, le film est tellement inégal que l’enthousiasme unanime qu’il a suscité laisse pantois. Construit en une série de séquences conçues presque comme des sketches, des coups de forces autonomes, le film zigzague entre réussites et flops. Prenons la séquence du salon des inventions estudiantines : le réalisateur n’en fait rien. Voyons la séquence Sean Penn-Tom Waits : tellement ratée qu’elle en est embarrassante. Le moment Bradley Cooper : drôle au début, puis lourdingue et tombant à plat à force d’insistance dans le registre comique-agressif. La scène du restaurateur qui imite l’accent chinois de sa maîtresse : gênant comme du Michel Leeb.
Même quand elles sont réussies, ces séquences-sketches résument parfaitement le style frimeur et volontariste de PTA, comme si à chaque instant de son film, il ne pouvait s’empêcher de hurler « regardez, je suis aussi bon et virtuose que mes maîtres Martin Scorsese, Stanley Kubrick et Robert Altman !!! » Non seulement ce n’est pas si virtuose que ça, mais c’est surtout bien vain. Et puis ce n’est pas toujours très crédible de voir des ados de 15 ans monter des business (waterbeds, salle de jeux…) comme on claque des doigts : on se pince et on s’interroge, ces gamins n’ont donc jamais lycée ?!
Alors bien sûr, Licorice Pizza peut séduire par endroits : Los Angeles reste toujours une ville cinégénique, la BO est d’enfer et parfaitement coulée dans les images proposées, quoique sans surprise (les classiques et trésors cachés du rock californien de l’époque). Mais le plus bel atout du film, ce sont ses jeunes acteurs, Alana Haim et Cooper Hoffman (fils de feu Philip Seymour) : ils ne cochent pas les canons de beauté habituels mais ils ont du chien, sont cinégéniques, émouvants. Deux acteurs neufs, c’est beau, mais ça ne suffit pas à faire un film convaincant et ça ne justifie en aucun cas le concert d’éloges unanimes qui l’a accueilli. Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino était un meilleur film sur les années 70 à Los Angeles, et pourtant, il a été discuté, lui.
Troisième mystère critique, The Souvenir. Quoique très différent de Licorice Pizza, il présente quelques points communs avec le PTA : une première grande histoire d’amour, un ancrage géographique, historique et culturel (le Londres des années 80 remplaçant le LA des 70s), une BO pop-rock à l’avenant de cet ancrage. Mais si on comprend que les deux protagonistes de Licorice soient attirés l’un vers l’autre, si on vibre pour eux, ce n’est pas du tout le cas des amants de Joanna Hogg. Pourquoi donc cette fille délicieuse est-elle amoureuse de ce type imbuvable se demande-t-on tout au long du film ? Car le gars a tout pour déplaire (à la fille, mais aussi au spectateur) : il est snob, condescendant, menteur, froid, une caricature d’Anglais « stiff upper lip », et bien que venant d’une classe sociale élevée, il tape régulièrement de l’argent à sa copine (pour se droguer en cachette d’elle). Le malotru parfait.
Joanna Hogg montre là clairement une relation amoureuse toxique, asymétrique. Pourquoi pas ? Mais cette histoire est toxique dès le début, ce qui rend cette relation amoureuse (et le désir de la fille) incompréhensibles, et franchement malaisants. La mise en scène d’Hogg n’aide en rien, même si sa tonalité ouatée amortit les angles : fondée sur des ellipses constantes, un montage cut et décalé (la plupart des scènes commencent trop tard ou sont coupées trop tôt, à dessein), une image cotonneuse manifestement inspirée par la peinture anglaise (et par Fragonard, lourdement cité), et un ton volontiers flegmatique, arrondissant toutes les âpretés, c’est une esthétique faussement moderne, très chichiteuse et dont les soi-disant audaces ressemblent surtout à des tics systématiques.
Il faut dire que la réalisatrice est passablement embrouillée dans ses références cinéphiles : son personnage est cinéaste débutante (le film est évidemment autobiographique) et une de ses collègues étudiantes en cinéma cite dans la même foulée Godard, Rivette et… Beineix ! J’ai failli tomber de mon fauteuil en entendant pareille association. Comme si tout réalisateur français relevait d’un même lignage esthétique et moderniste, juste parce qu’il est français. Comme chez PTA, on retient de ce film sa jeune actrice, Honor Swinton Byrne, fille de Tilda et prometteuse comédienne. Au final, malgré leurs différences de style, de nationalité et de tempérament, Hogg et PTA partagent finalement le même goût pour un affichage formel aussi ostentatoire que vain. On pourrait adresser le même reproche au Carax d’Annette, sauf que lui a largement fait la preuve de son génie dans ses films précédents.
3) Que s’est-il passé ?
On ne peut ici que se borner à formuler des hypothèses, sans aucune certitude. Bien sûr, certains des critiques cités ont sincèrement aimé ces films et on ne veut pas ici leur faire le procès de leur goût. C’est surtout l’unanimité des éloges qui nous questionne.
La reprise des sorties cinéma et la réouverture des salles après plusieurs mois de confinement ont certainement joué leur rôle. C’est particulièrement vrai dans le cas d’Annette qui fut la première grosse sortie post-confinement et l’ouverture du festival de Cannes. Scandé par le tube de sa séquence d’ouverture, So may we start ? (Alors, on peut (re)démarrer ?), le film de Carax portait en lui une dimension de renaissance, de libération, qui dépassait sa propre valeur intrinsèque. Pour paraphraser le grand philosophe Johnny Hallyday, les critiques avaient envie d’avoir envie d’Annette, envie de rallumer le feu, parce que c’était Carax, parce que c’était Cannes, parce que c’était le film-signal du retour à la vie du cinéma et du grand ralliement cinéphile. Le Covid a vraiment menacé de mort le cinéma, du moins une certaine idée du cinéma liée à la salle et à la diversité de production et d’inspiration des films. Annette, c’était le film du grand soulagement, de la mort évitée, du phénix qui renait.
Tout cela a peut-être aveuglé les critiques sur la lourdeur et la noirceur excessives du film. Ou plutôt, les critiques ont perçu ces défauts mais n’ont pas souhaité en parler ou en faire grand cas, préférant célébrer la joie du reset de tout le cinéma. On peut comprendre tout cela. Notons quand même que le public n’a pas vraiment suivi cet élan. Malgré son imposant tapis rouge critique, médiatique et promotionnel, Annette n’a pas vraiment obtenu le succès escompté et la cote des spectateurs dans Allociné est inférieure à la cote critique.
Dans le cas de Licorice Pizza, il n’est pas exclu que le contexte du « monde d’après » joue aussi. L’écosystème du cinéma en salle ayant subi des altérations durables à la suite du Covid (et au déplacement des pratiques du public vers les plateformes et le cocooning domestique), le film de PTA s’inscrivait lui aussi dans ce mouvement où chaque gros film d’auteur est couvé comme le représentant d’une espèce en possible voie de disparition. Phénomène renforcé par la raréfaction des grands films d’auteurs américains. La fastueuse période du Nouvel Hollywood et de ses suites (l’ère longue et glorieuse des Coppola, Scorsese, Spielberg, Lucas… puis ensuite des Lynch, Fincher, Mann, Tarantino, Coen…) est révolue. Le cinéma hollywoodien conçu pour les salles est désormais majoritairement constitué d’adaptations de Marvel comics, avec ses superhéros planétaires (Batman, Superman, Spiderman, Ironman, etc.) et ses franchises de films à multiples répliques, reboots, sequels, ou autre prequels…
Parallèlement, les grands auteurs américains à forte signature, ou ce qu’il en reste, ont migré vers les plateformes (voire vers les séries, l’art contemporain, l’écriture de romans ou de pièces de théâtre…). Si bien que quand l’un d’entre eux sort un nouveau film en salle, cela apparaît comme une denrée aussi rare que la modération ou le sourire chez Vladimir Poutine.
Licorice Pizza a peut-être bénéficié de ce contexte plus ou moins conscient où le moindre film estampillé « auteur américain » est devenu tellement précieux par sa rareté qu’il est accueilli comme le messie. Pour PTA comme pour Carax, il me semble aussi qu’on a vu là deux exemples de la fameuse « politique des auteurs », concept forgé par les critiques des Cahiers du cinéma dans les années cinquante (l’éternelle génération référence des Truffaut, Rohmer, Rivette and Co). Selon cette « politique des auteurs », tout film d’un auteur précis est à prendre en considération et à louanger car même le plus raté de ces films contient au moins une scène, une séquence, un détail qui porte la marque indiscutable de son auteur. Pour résumer, selon ces critiques historiques des Cahiers, un film raté de Jacques Becker ou de Jean Renoir valait toujours mieux qu’un film réussi de Julien Duvivier ou de René Clément.
Dans les années 90, j’avais adopté une inflexion à cette théorie en faisant mienne (avec certes moins d’écho) « la politique des films » : un grand cinéaste peut parfois rater un film et un moins bon cinéaste peut parfois réussir un film. Bref, un film raté reste un film raté et un bon film reste un bon film, quel que soit leur auteur et ce que cet auteur a réalisé par ailleurs. À bien y réfléchir, le présent texte peut être lu comme une réponse de la « politique des films » à la « politique des auteurs » qui transparait dans l’engouement autour d’Annette et de Licorice Pizza.
Dans le cas de The Souvenir, la « politique des auteurs » est inopérante puisque la France découvre Joanna Hogg. Précisément, la réception critique élogieuse me semble liée ici à cette émotion particulière de la découverte. Quand un critique repère un cinéaste vierge ou qui avait jusque-là échappé aux radars, cela induit toujours un bonus de la nouveauté : que l’on aime le film un peu ou beaucoup, on monte le grade d’appréciation de quelques degrés, parce que c’est neuf. Dans notre présent post-MeToo, ce phénomène est encore plus susceptible d’être accentué quand le cinéaste neuf est une cinéaste – Joanna Hogg en l’occurrence. Voilà qui donne crédit à l’idée que les femmes cinéastes ont souvent été les oubliées de l’histoire du cinéma.
Tout cela est également compréhensible, mais à un moment vient le temps d’analyser et d’évaluer les films pour ce qu’ils sont et non en fonction de l’identité de leur auteur ou du contexte macro-économique ou historico-culturel dans lequel ils surgissent. Certes, ces contextes existent et on ne peut pas les éliminer dans le cadre d’un travail journalistique qui relèverait de l’enquête ou du portrait. Mais dans un cadre critique, le plus important c’est le film, et ses procédures esthétiques. Et à la fin des fins, ce qui compte avant tout pour un critique (et un spectateur de cinéma), c’est ce qui se passe sur l’écran, et entre l’écran et lui.
