Pour une politique de l’Université
Alors que la campagne présidentielle s’achève, et que se décideront, dans les prochaines semaines, les orientations du pays pour les dix ou quinze ans qui viennent, la question de l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), et de l’université en particulier, ne suscite aucun véritable débat. Cette situation a de quoi alarmer quand on sait leur importance dans la vitalité matérielle et symbolique d’une société.
Le récent rapport du Conseil d’analyse économique[1] pointe en effet tous les bénéfices individuels et collectifs qu’il y a à retirer d’un investissement massif dans l’ESR en matière, par exemple, de santé et d’espérance de vie, d’innovation, d’amélioration des conditions d’existence, et de recettes fiscales par l’effet mécanique d’élévation des niveaux de salaire des détenteurs de diplômes du supérieur. De quoi conclure que les dépenses publiques en matière d’éducation sont de celles qui ont le plus haut rendement socio-économique, et que l’investissement dans l’ESR fait partie des « meilleurs choix possibles »[2].
Ce meilleur choix possible ne semble pourtant pas la priorité des politiques publiques actuelles comme en attestent trois constats majeurs.
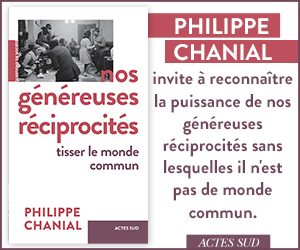
L’Université, grande oubliée des politiques publiques
Le premier est le sous-financement chronique de la recherche publique, qui, en France, avec 2,2% du PIB en 2021 reste très en deçà de l’objectif des 3% fixé par l’Union européenne dans le cadre de la « stratégie Europe 2020 », et en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE (2,5% du PIB), quand par comparaison la Corée du Sud y consacre 4,5% de sa richesse nationale, le Japon et la Suède 3,3%, l’Allemagne 3,1%, les États-Unis et la Finlande 2,8%[3]. Pire, la part consentie par les administrations publiques au financement de la recherche (hors entreprise donc) est en diminution constante depuis les années 1990. Elle s’établissait à 0,76% du PIB en 2018 contre 0,85% en 1992[4].
Le second concerne la multiplication, depuis une vingtaine d’années, des réformes affectant l’organisation et le fonctionnement de l’ESR[5] dans une triple optique de renforcement du pilotage politique de la recherche, de concentration des moyens, et de mise en concurrence des établissements et chercheurs. L’enchaînement rapide de ces réformes, leur nombre comme leur esprit ont d’abord eu pour conséquence de fragiliser la recherche en conduisant celles et ceux qui la font à se consacrer à un toujours plus grand nombre de tâches annexes.
La généralisation du financement de la recherche sur projets a mécaniquement réduit la part de temps que les chercheurs et enseignants-chercheurs peuvent dédier à la recherche proprement dite en augmentant celle employée au montage de dossiers, au traitement d’appels à projets et aux démarches administratives et comptables. Ce mouvement a été d’autant plus brutal que les enseignants-chercheurs des universités ont dû, dans le même temps, faire face à une augmentation très rapide des effectifs étudiants dans un contexte de désengagement budgétaire de l’État. Entre 2010 et 2019, le nombre d’étudiants progressait deux fois plus vite (+ 20%, soit + 400 000 étudiants) que le budget de l’enseignement supérieur (+ 10%)[6]. La dépense annuelle moyenne par étudiant qui, en 2010, s’élevait à 12 440 euros n’est plus que de 11 110 euros en 2019[7]. Le nombre d’enseignants-chercheurs recruté est passé de 2 101 à 1 070 (contre 2417 en 2000)[8], celui des chercheurs du CNRS de 412 à 240[9].
Le troisième constat concerne l’Université stricto sensu. Alors qu’elle est la plaque tournante de la production scientifique et de la formation de la jeunesse, l’Université est la grande oubliée des politiques publiques. C’est en effet d’abord et avant tout à l’Université que le désengagement budgétaire de l’État frappe de plein fouet. Il se traduit en premier lieu par une chute des taux d’encadrement. Sur la période 2010-19, le nombre d’enseignants titulaires à l’université ne progresse que de 1% pour 24% d’étudiants en plus[10]. À défaut de pouvoir recruter suffisamment d’enseignants-chercheurs[11], les facultés recourent massivement aux vacataires, aux contrats précaires et mal rémunérés malgré leur haut niveau de qualification. Dans certains départements, ces derniers dispensent jusqu’à 40% ou 50% des cours.
Enfin, si l’on retire du calcul du « coût » moyen des formations la part de financement dévolue aux activités de recherche (qui est généralement injustement inclue dans ces calculs)[12], celui-ci n’est plus que de 5 250 euros en moyenne par an et par étudiant à l’Université (contre plus de 11 000 euros pour les écoles d’ingénieurs et 15 000 euros pour les classes préparatoires)[13]. Si les universités fonctionnent, comme nombre de services publics aujourd’hui, grâce au dévouement de leur personnel et grâce au recrutement massif de non-titulaires, le désengagement de l’État se paie au prix fort : accompagnement plus difficile des étudiants[14], détérioration des conditions de travail des personnels, augmentation de la souffrance au travail, renouvellement de plus en plus difficile des générations de chercheurs, dégradation de la place scientifique de la France dans les classements mondiaux[15].
Ce que la société doit à l’Université
Il faut pourtant rappeler les nombreux apports, trop souvent inaperçus, des universités à la société française.
Elles sont d’abord le principal contributeur à l’effort d’élévation du niveau des qualifications en France. Alors que les études dans l’enseignement supérieur ont fini par s’imposer comme un prolongement quasi obligatoire de la scolarité (avec des bacheliers qui pèsent désormais pour 80% d’une classe d’âge), ce sont bien les universités qui portent l’essentiel des promesses de formation des nouvelles générations dans le supérieur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre 2010 et 2019, les effectifs étudiants à l’Université ont augmenté de + 209 000, quand ceux de Sciences et techniques (STS) plafonnent à + 20 000 et à + 5000 pour les classes préparatoires (CPGE) et les IUT[16]. Aujourd’hui, 6 jeunes sur 10 (soit 63%) inscrits dans l’enseignement supérieur le sont à l’Université quand les STS accueillent 1 jeune sur 10 et les CPGE 3% (0,3 pour 10).
En formant plus d’un million d’étudiants inscrits en licence, pratiquement 600 000 étudiants en master, les universités contribuent de manière unique à la formation des générations montantes, à l’élévation générale des connaissances et à l’inscription de la jeunesse dans l’emploi. Car cette réalité a des effets incomparables et concrets. D’une part, toutes les études le montrent, ces diplômes sont pour leur détenteur une protection décisive vis-à-vis du chômage et des situations de galère[17]. D’autre part, et c’est essentiel, ces diplômes universitaires offrent à leur porteur d’excellents taux d’insertion dans l’emploi. 18 mois seulement après leur sortie de l’université, 90% des détenteurs d’un master sont en phase d’insertion professionnelle ; et 80% sont en emploi stable après 30 mois[18].
Enfin, et contrairement aux discours entendus sur la baisse de rendement des diplômes (par l’effet de leur généralisation), le lien entre niveau de salaire, position et niveau de formation s’est largement maintenu. En moyenne, les licenciés gagnent 30% de plus que les bacheliers des voies générales, 50% pour les masters. C’est dire si l’élargissement de l’accès aux différents diplômes du supérieur, très largement permis par les universités, a aussi « coïncidé avec une amélioration très sensible de la situation salariale de ceux qui ont bénéficié du surcroît de formation par rapport aux diplômés des grandes écoles. »[19] Et c’est encore sans compter ici avec les plus-values symboliques que ces diplômes offrent à leur détenteur[20].
Alors que ces derniers mois se sont multipliés les discours sur la panne de l’ascenseur social et les nécessaires mesures d’ouverture sociale des grandes écoles[21], c’est bien l’Université, encore elle, qui porte les espoirs du pacte républicain, l’ouverture de quelques places supplémentaires pour les enfants d’origine populaire dans les écoles ne changeant évidemment aucunement la donne. 28 % d’étudiants d’ouvriers et d’employés sont dans les universités[22], mais on ne trouve que 1% d’enfants d’ouvriers à l’X, 4% à l’ENA ou l’ENS, 7 % dans les classes préparatoires. Or, il faut souligner, une fois de plus, les bénéfices bien plus larges que le seul accès au diplôme (qui est déjà beaucoup) de cet accueil offert par l’Université aux enfants d’origine populaire : infléchissement d’une destinée probable, rehaussement des aspirations, acquisition d’un esprit critique, expérience de la mixité sociale, transformations des pratiques culturelles[23].
Enfin, last but not least, c’est à l’Université que se fabrique l’essentiel de la science française. Les 74 universités françaises hébergent pas moins de 3 000 laboratoires de recherche, 57 000 enseignants-chercheurs, 265 écoles doctorales, 82 prix Nobel et 12 médailles Fields, 700 bibliothèques universitaires. Les 74 000 doctorants qui y sont inscrits montrent encore que les universités forment le gros des troupes des nouveaux chercheurs, et attestent de l’excellence des formations qui y sont dispensées.
Est-il, dans ces conditions, acceptable que l’écart entre le coût moyen annuel de certaines licences et les CPGE puisse varier de 1 à 4, allant de 3 700 euros pour certaines licences de sciences humaines à 13 400 euros pour les secondes[24] ? Doit-on se satisfaire du fait que la croissance actuelle du nombre d’étudiants se solde, compte tenu des moyens mis en œuvre par l’État, par la création de l’équivalent d’une université supplémentaire chaque année sans moyen supplémentaire[25] ?
Alors que, sous l’effet des politiques publiques successives, 80% d’une classe d’âge est désormais bachelière, et aspire logiquement à poursuivre sa formation dans le supérieur, peut-on continuer à cautionner un système d’enseignement supérieur structurellement inégalitaire avec, d’un côté, des universités massifiées, mais appauvries, et de l’autre des CPGE et grandes écoles surinvesties par la dépense publique,[26] bien que réservées à un petit nombre d’élus ? Les procès qui sont faits à l’université française ratent l’essentiel tant qu’ils restent aveugles aux segmentations de notre système d’enseignement supérieur.
Prises en étau entre les formations professionnelles et techniques courtes et les classes préparatoires, les universités doivent, en plus de leur rôle historique de formation à la recherche, satisfaire les exigences de « professionnalisation » d’un côté, et de production d’une élite, de l’autre, sans avoir les moyens ni des unes ni des autres. Si les STS ont elles aussi connu une croissance forte de leurs effectifs, elles délivrent néanmoins des formations professionnelles courtes à des effectifs réduits, dans le cadre protégé des classes de lycée, encadrés par des enseignants du 2nd degré. Mais elles n’ont vocation à produire ni science ni docteurs. Les CPGE et grandes écoles, quant à elles, forment une petite élite triée sur le volet et à l’avenir tout tracé. Prestigieuses et hautement sélectives, elles sont à la fois sur-encadrées et dispensées de l’injonction à la professionnalisation. Cette inégalité, historiquement structurante, mais chaque décennie plus flagrante, vicie le système de l’ESR à sa base.
Redonner du temps à la recherche
Afin de ne pas obérer l’avenir, nous serions bien inspirés d’œuvrer collectivement à redonner du temps à la recherche et à celles et ceux qui la font. Cela passe nécessairement par l’augmentation de ses capacités et la création de postes d’enseignants-chercheurs dont le plus grand nombre augmentera d’autant les taux d’encadrement au sein des universités. Mais cet effort devrait être accompagné d’un retour à des financements pérennes de la recherche, et par conséquent de la diminution de la part des financements sur projets dont la montée en puissance augmente le temps administratif.
De ce point de vue aussi, il faudrait revenir sur les politiques dites d’excellence visant à promouvoir, par la concentration des financements, un petit nombre d’universités de recherche au détriment du plus grand nombre, peu ou prou progressivement réduites au rôle de collèges universitaires. Car le rôle de formation à la recherche joué par les universités, de même que leur contribution à la production scientifique, ne seront pris en charge ni par quelques universités d’excellence ni par les seules grandes écoles, du moins pas au niveau qui permettrait à la France de rester l’un des principaux acteurs mondiaux de la recherche fondamentale.
De même, dans le contexte de généralisation du baccalauréat et des études supérieures, rien ne justifie que les universités ne soient dotées des moyens équivalents à ceux consentis aux élèves des CPGE et grandes écoles. Mieux, c’est le dualisme entre les universités et les CPGE qui devraient être remis en cause tant il crée l’illusion, contestée par toutes les études, que la promotion d’une petite élite tirerait vers le haut l’ensemble du système, et perpétue le maintien d’une reproduction sociale au profit du petit nombre. Les CPGE gagneraient à être ainsi regroupées avec les premiers cycles universitaires, et les grandes écoles intégrées au sein des universités.
Enfin, il faut créer les conditions permettant aux étudiants de se consacrer entièrement à leurs études. Un trop grand nombre d’entre eux sont, à défaut de pouvoir bénéficier d’un soutien familial, contraints au travail salarié dans des proportions qui entravent leur réussite[27], et se retrouvent parfois dans des situations de grande précarité[28]. Comme on omet de le préciser trop souvent, la dépense publique pour l’Université doit être double : elle doit abonder sa bonne marche en même temps qu’elle doit soutenir le temps d’étude en dégageant les étudiants des contraintes économiques du travail.
