Cannes 2022 : une édition réussie, un palmarès manqué
La première et essentielle vertu du Festival de Cannes est d’être un condensé d’éléments et de comportements d’ordinaire considérés comme hétérogènes, voire antinomiques. Dans ce creuset éphémère s’entremêlent, plus que nulle part ailleurs, ambition artistique, agendas politiques, marchandages et recherche du profit, frissons glamour, fétichismes de toutes sortes, manœuvres médiatiques, débats sur les règles et les techniques, etc.
Cannes sert à ça, et « ça » sert la vie du cinéma, toute l’année, partout. Mais même en étant conscient et réjoui de cette impureté fondamentale et nécessaire, il faut pourtant prendre acte d’une coupure ouverte qui traversé la 75e édition, celle qui s’est tenue du 17 au 28 mai 2022.
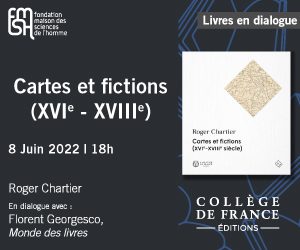
Une édition stratégique
Cette édition revêtait une importance particulière, à un moment où le cinéma se trouve confronté à divers problèmes de natures différentes, mais qui se combinent. La pandémie a fait fermer les salles un peu partout dans le monde, et dissuadé une partie du public de s’y rendre même quand elles étaient ouvertes.
La montée en puissance des plateformes en ligne modifie les formes de circulation des productions audiovisuelles, y compris des films. La puissance d’attraction des séries interfère avec la place qu’occupait le cinéma dans les loisirs populaires aussi bien que dans l’imaginaire et dans la réflexion sur les représentations.
Ces phénomènes appellent des réponses, suscitent des inquiétudes qu’enveniment à l’envi des discours catastrophistes complaisamment relayés par des médias plus pressés de surfer sur une très improbable mais accrocheuse mort du cinéma que d’analyser les situations et d’imaginer les évolutions évidemment nécessaires.
À quoi s’ajoute, notamment en France, un déficit criant de politique publique mobilisée par une approche culturelle, remplacée au mieux par un saupoudrage financier lorsque les plaintes se font trop fortes, sur fond de réformes « gestionnaires » délétères.
Beaucoup des lamentations récemment entendues, et amplifiées par la caisse de résonance cannoise, porte sur la baisse significative des entrées. Mais c’est en se fondant sur une comparaison avec les chiffres de 2019, année particulièrement faste, au sommet d’une courbe ascendante depuis près de 30 ans.
La situation associe plusieurs éléments de fragilisation du dispositif antérieur et des évolutions qui méritent, comme toujours, des adaptations, elle n’appelle ni De profundis ni autodafé de ce qui fut naguère adoré, mais du travail et du désir. Il n’est pas surprenant, mais quand même affligeant, que la nomination en plein festival d’une nouvelle ministre de la Culture n’ait suscité qu’un intérêt distrait.
Dans un tel contexte, Cannes, qui reste et de loin la manifestation la plus visible du cinéma mondial, avait un rôle stratégique à jouer, en terme de désir précisément, et comme incitation à se remettre au travail. L’affluence sur la Croisette, le plaisir de se retrouver manifesté par beaucoup de festivaliers, la beauté de nombreux films présentés, toutes sections confondues, et leur diversité, ont sans aucun doute permis que soit accompli l’essentiel de la mission.
D’une manière générale, ce 75e Festival a été une édition réussie, qui a permis de découvrir un nombre significatif d’œuvres mémorables et de faire bien des rencontres riches de sens et d’avenir.
Mais cela ne saurait faire oublier combien l’ensemble des sélections, et plus particulièrement la compétition officielle ont mis en valeur deux idées de ce que peut être et de ce que peut faire un film, avant que le palmarès ne vienne très explicitement consacrer l’une de ces idées et disqualifier l’autre.
Dix aventures singulières
Les 21 longs métrages en lice pour la Palme d’or ont cristallisé ces deux tendances qui, dans les autres sélections cannoises, se retrouvaient aussi présentes sous diverses formes. Dix des films en compétition relèvent de ce qu’on pourrait appeler un pari sur les puissances du cinéma. C’est à dire un pari sur sa capacité à donner, à percevoir et à comprendre davantage que ce qui est dit et montré. Et donc, aussi, sur l’intelligence de ses spectateurs.
Il s’agit (par ordre d’apparition dans le programme du festival) de Eo de Jerzy Skolimowski, Frère et sœur d’Arnaud Desplechin, Armagaddon Time de James Gray, R.M.N. de Cristian Mungiu, Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, Tori et Lokita des frères Dardenne, Leila et ses frères de Saeed Roustaee, Stars at Noon de Claire Denis, Pacifiction d’Albert Serra, Showing Up de Kelly Reichardt. Soit des films extrêmement différents entre eux, par leur sujet, leur rapport aux acteurs, à l’imaginaire, leurs partis pris esthétiques, etc.
Rien ici qui ressemblerait à une uniformisation des styles, mais autant d’affirmations singulières, n’ayant en partage que la confiance en les fécondités émotionnelles et de compréhension associées à ce que toute œuvre – de cinéma entre autres – se doit d’avoir de mystère, d’ouverture, d’espace susceptible d’être investi par chacune et chacun à partir de ses propres affects et de ses propres attentes.
L’odyssée aventureuse et picaresque d’un âne à travers l’Europe actuelle (Eo), les rapports de haine paroxystiques entre une sœur et son frère chez Desplechin, l’évocation rêveuse et sensible d’un passage à l’adolescence dans le Queens des années 80 par James Gray, le concentré de conflits entre individus, hommes et femmes, groupes ethniques dans une bourgade de Transylvanie (R.M.N.), l’évocation des relations passionnelles entre les élèves d’une école de théâtre par Valeria Bruni Tedeschi, le sort d’enfants africains dans une capitale européenne conté par les Dardenne, les conflits au sein d’une famille sous la pression de la misère et des obligations claniques traditionnelles (Leila et ses frères), les tribulations torrides d’une jeune américaine dans une dictature d’Amérique latine dans le sillage d’un roman halluciné de Denis Johnson (Stars at Noon), Albert Serra explorant les méandres du pouvoir et de l’impuissance dans un décors polynésien faussement paradisiaque, le quotidien tendu et banal d’une femme artiste dans une ville de province américaine (Showing Up) : le moins qu’on puisse dire est que ces films n’ont pas grand chose de commun sur le plan des thèmes.
Mais pas en ce qui concerne les choix stylistiques. Les film studies américaines ont forgé la catégorie très contestable de slow movie, supposément devenu l’archétype du « cinéma d’auteur », autre catégorie instable et servant volontiers à stigmatiser. Or aucun de ces films ne peut être réputé «lent».
Mais aucun ne suit les canons d’une dramaturgie formatée, qui a défini – à partir des modèles du blockbuster et de la fiction télé – une dramaturgie fixe, conforme, qui repose à la fois sur les enchainements explicatifs (untel fait ceci parce qu’il a vécu ça dans son enfance, ou parce que sa copine a agi d’une certaine façon ou parce que la police connaît telle information…) et émotionnels, enchainements très précisément cartographiés par les manuels d’écriture et les script doctors. Il était par exemple instructif de lire le commentaire consacré par le plus important journal professionnel de l’industrie américaine de l’entertainment, Variety, au film de Desplechin.
Son rédacteur expliquait très courtoisement comment le réalisateur aurait dû définir ses personnages, organiser son récit, expliquer les motivations. Quand l’intense trouble, vibrant de vie et d’énergie, que suscite Frère et sœur, et qu’animent magnifiquement Marion Cotillard et Melville Poupaud, tient précisément au refus de toutes ces facilités confortables qui défont les complexités des sentiments et des rapports humains.
À écouter les détracteurs sur la Croisette de ce film, on se disait que, présenté à Cannes aujourd’hui, tout grand film d’Ingmar Bergman y serait non pas conspué – les festivaliers ne conspuent plus les films, ce qui était encore une façon d’être dans une relation intense avec eux – mais renvoyés à une indifférence hostile et méprisante.
Tendu, nerveux, traversé d’embardées, le film de Desplechin n’est assurément pas slow. Il est juste en harmonie avec les opacités des relations, individuelles et collectives. Sans pratiquement rien de comparable pour ce qui est des situations, du ton, des choix de réalisation, il en va pourtant de même de la formidable traversée des apparences qu’invente avec une liberté totale le vétéran polonais Skolimowski, ou de l’énergie incarnée, fulgurante de colère et d’affection à l’égard de ses personnages, du jeune Iranien Roustaee.
Impossible ici d’entrer dans le détail de ce qui fait la beauté et la force de chacun de ces dix films, aussi différents soient-ils. Mais, du côté d’une épure émotionnelle qui permet de mettre en évidence le côté implacable des mécanismes d’oppression chez les Dardenne, ou dans l’apparente banalité quotidienne des multiples conflits qu’affronte l’artiste céramiste interprétée par Michelle Williams et autour de qui se développe Showing Up, ce sont tout autant les éléments hors-champ, implicites, les manières d’« en soustraire » (par le cadre, par le rythme, par les dialogues, par la gestuelle) au lieu d’« en rajouter », qui font la force de ces films.
Un des aspects impressionnants à leur propos est, à chaque fois même si chaque fois différemment, l’intensité des présences qui saturent l’écran. Alors que tant de films, y compris mille fois plus spectaculaires, semblent réduire l’écran à une mince pellicule où évoluent des formes plates, les œuvres porteuses d’un souffle de cinéma vibrent d’une physicalité où la distinction entre matériel et spirituel n’a aucun sens, et qui invitent à une expérience autonome pour chacune et chacun : quand la singularité de chaque film est en phase avec la singularité de chaque spectateur⸱trice, à l’opposé de la notion, dans ce cas entièrement modélisée par le marché, de « public ».
Un horizon queer
Cette singularité ouverte définit également deux autres œuvres qui auront connu le sort singulier, pas forcément bénéfique pour elles, d’être présentées le même jour : le film de Claire Denis et celui d’Albert Serra. Que dans les deux un homme en complet blanc joue un rôle central relève du clin d’œil mais aide à un rapprochement qui, de manière un peu plus consistante, passe également par le fait de se situer dans des contextes « exotiques », le Nicaragua pour le premier, Tahiti pour le second.
L’emploi du mot « exotique » a ici toute sa légitimité, tant chacun des deux films est travaillé en profondeur par les multiples formes de décalages, désamarrages, désassignations auxquelles sont confrontés des personnages qui se croient acteurs de leur histoire et sont agis par des forces qu’ils n’entrevoient que par intermittence.
Entre somnambulisme et cauchemar, codage dramatique ou ironique par les schémas du thriller politique, du film fantastique ou de la romance, se déploient comme des plantes fascinantes et proliférantes une multiplicité d’ébauches de liens entre les êtres, et entre eux et les situations, liens que tout menace sans cesse de détruire.
La présence d’elfe érotique déboussolé de Margaret Qualley chez Claire Denis comme celle de raminagrobis dépassé par la géopolitique et les intrigues de Benoit Magimel chez Albert Serra activent selon des multiples registres une déstabilisation générale des repères qui font de l’un et l’autre film un poème queer, plutôt au sens dynamique de Donna Haraway qu’en liaison avec les seuls enjeux LGBT+.
La prime au cinéma extractiviste et dominateur
À l’exception d’un demi-prix pour Eo et d’un autre pour Stars at Noon[1], l’ensemble des choix du jury aura affirmé son penchant pour une idée antagoniste. La Palme d’or à Sans Filtre du réalisateur suédois Ruben Östlund, caricature du film boursouflé, hyper déclaratif, manipulateur, simpliste – et d’une laideur renversante – en est l’affirmation la plus explicite.
L’idée qu’un tel film ait le moindre effet contre les hyper-riches dont il se moque de manière convenue est tout simplement risible. Cette affirmation est confirmée notamment par le prix de la mise en scène à Park Chan-wook pour Decision to Leave, polar artificiel où il multiplie à l’infini les twists scénaristiques et les effets d’esbroufe gratuits.
Elle l’est aussi par le prix d’interprétation féminine à Zar Amir Ebrahimi, l’actrice de Holy Spider d’Ali Abassi qui capitalise sur la souffrance des femmes exhibée complaisamment sous prétexte de la dénoncer. Dans le même sens va aussi le prix d’interprétation masculine à Song Kang-ho, un des acteurs des Bonnes Etoiles de Hirokazu Kore-eda, film qui mêle les ruses de scénario, qui sont des actes de pouvoir autoritaire du réalisateur sur ses personnages comme sur ses spectateurs, à un sentimentalisme pesant au service d’une idéologie rétrograde de la famille.
D’autres titres de la compétition relèvent du même type d’approche, y compris de façon qui peut sembler paradoxale. Ainsi l’exercice de virtuosité formelle La Femme de Tchaïkovski de Kiril Serebrennikov, si préoccupé d’en mettre plein la vue avec ses savants mouvements de caméra et ses nuances chromatiques qu’il délaisse entièrement ceux à qui ils s’adressent comme ceux dont il raconte l’histoire.
Ou, à nouveau, le besoin de surcharger de twists et d’effets dramatiques une histoire qui ne demandait qu’à prendre vie dans son environnement, en l’occurrence Naples que connaît si bien Mario Martone, dont on n’a pas oublié les pourtant désormais anciens Mort d’un mathématicien napolitain ou Teatro di guerra.
À force de vouloir ajouter les grandes orgues de la tragédie antique, il plombe son film, comme le fait aussi Tarik Saleh avec Boy from Heaven (Prix du scénario), où le fait d’être situé dans l’université d’Al-Azhar est pourtant autrement intéressant que les intrigues policières qu’il y instille, et surtout la façon dont il les filme.
Avoir mentionné le rapport à l’environnement n’a ici rien de fortuit. Ce qui sépare ces deux idées du cinéma, séparation nettement marquée dans la compétition et qu’ont accentués les choix du jury, n’est pas seulement une différence d’opinion, de ces goûts et couleurs dont il n’y aurait pas à discuter – et pourquoi ? Il s’agit bel et bien de deux rapports au monde, aux êtres humains, au vivant, aux choses, et aussi aux êtres de fiction qui, à leur manière, existent eux aussi, peuplent notre monde.
Ce qu’a récompensé l’essentiel du palmarès relève de la surenchère, du toujours plus, de la communication spectaculaire. C’est l’équivalent cinématographique de l’extractivisme et de la domination dans tous les domaines – celle des humains sur le reste des êtres autant que celle de certains humains sur tous les autres.
Et c’est aussi, de manière qui n’a rien de fortuite, une forme de démagogie qui répute élitiste ce qui fait confiance à la sensibilité et à l’esprit de découverte au lieu d’asséner des discours et de ressasser les représentations et les formats convenus.
Étrangement, cette faille entre deux idées du cinéma traversait le film le plus attendu de la compétition officielle, et qui aura payé cher à la fois cette attente et ses propres faiblesses. Crimes of the Future de David Cronenberg est en effet un objet hybride, qui joue sur les codes convenus du fantastique et de l’horreur mais s’élance par moments – par moments seulement – sur des voies inédites, inventives, intrigantes.
Un peu trop bizarre pour qui n’était disposé à voir que « du Cronenberg » figé par une légende réductrice. Parcimonieux dans les propositions les plus originales et les plus émouvantes, surtout celles portées par ses deux actrices, Léa Seydoux et Kristen Stewart, le film aura en outre été victime d’un ironique retour de flamme, où l’intense promotion qui avait précédé sa présentation a joué contre lui.
Hors de la compétition, deux films essentiels
Si ce qui s’est produit dans et autour de la compétition officielle raconte l’essentiel des enjeux activés par cette édition du Festival, il ne saurait être question d’évoquer celle-ci sans mentionner au moins deux autres films, présentés dans d’autres sections.
Impossible ici d’expliciter tout le bien qu’on voudrait dire de L’Envol de Pietro Marcelo, du Barrage d’Ali Cherri, des Harkis de Philippe Faucon, d’Un beau matin de Mia Hansen-Løve, des Années super-8 d’Annie et David Ernaux (tous les cinq à la Quinzaine des Réalisateurs) comme de Goutte d’or de Clément Cogitore (Semaine de la critique), de Magdala de Damien Manivel et de Yamabuki de Juichiro Yamasaki (dans la sélection ACID).
Mais il est exclu de passer sous silence les deux films peut-être les plus marquants et singuliers et hors-norme de tous ceux montrés à Cannes cette année. Présenté dans la section officielle non compétitive Cannes Première, Esterno notte de Marco Bellocchio est assurément une série sur le plan technique et réglementaire, et incontestablement un immense film de cinéma, dès lors qu’on le regarde.
Cette évocation fleuve et sous de multiples angles de l’affaire Aldo Moro et de ses conséquences est une proposition d’une ampleur et d’une finesse rares. Il faut espérer pouvoir, aussi, découvrir un jour en salle ses 5h30, même si les conditions de financement font qu’aujourd’hui une œuvre d’une telle ambition ne se trouvent que dans les télévisions (RAI et Arte en l’occurrence).
Enfin, à nouveau à la Quinzaine, De Humani Corporis Fabrica de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, proposition de cinéma d’une fulgurante inventivité. Les deux anthropologues du Sensory Ethnography Lab de Harvard ont filmé durant des années dans plusieurs hôpitaux parisiens, ils ont fait fabriquer une caméra spéciale pour tourner en salles d’opération, ils ont connecté leurs images à celles enregistrées à l’intérieur des corps par les appareils d’imagerie médicale.
De manière aussi décisive que leur Leviathan il y a dix ans, mais selon des approches toutes autres, le résultat est une aventure du regard et de l’esprit, où le corps humain, mais aussi ce corps matériel et social qu’est l’hôpital, sont perçus dans leurs complexités, leurs continuités et leurs disruptions.
Une ressource essentielle pour la mise en œuvre de ce qui est du même mouvement une œuvre et une recherche qui tient à la beauté des images, à leurs relations multiples et significatives avec les sons, et aux troubles de multiples natures qu’inspire la vision d’un film qui, littéralement et à tous les sens de l’expression, déplace les regards. Ce que, irrévocablement, on continuera d’espérer du cinéma.
