Les veilleurs – sur « Les Sentinelles » à l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing
À l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing, l’exposition “Les Sentinelles” présente quelques ardents foyers de la création contemporaine dans le monde arabe. Ses commissaires, Pascale Cassagnau, responsable de la collection des œuvres photographiques, cinématographiques et vidéo du Centre national des Arts plastiques (CNAP), et Camille Leprince, chercheuse et curatrice, dont le travail explore notamment les images documentaires des conflits et soulèvements du monde arabe depuis 2011, délivrent une vision moins consensuelle que celle habituellement promue par la structure mère parisienne de l’IMA. Initiée avec l’ancienne directrice de l’IMA Tourcoing, Françoise Cohen (qui a depuis pris les commandes de la Fondation Giacometti), celle-ci bénéficie d’une indépendance garantie par son financement public, comme en témoigne le choix pour l’affiche d’une œuvre de l’artiste Abdessamad El Montassir.
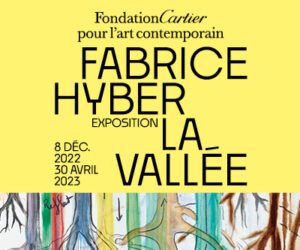
« À Paris » signifie en l’occurrence à l’Institut du Monde Arabe, maison mère de l’IMA de Tourcoing où se tient, donc, l’exposition « Les Sentinelles ». Initiée avec l’ancienne directrice du lieu, Françoise Cohen (qui a depuis pris les commandes de la Fondation Giacometti), celle-ci bénéficie d’une indépendance garantie par son financement public, comme en témoigne le choix pour l’affiche d’une œuvre d’un artiste originaire du Sahara occidental, Abdessamad El Montassir, que le régime marocain n’aurait jamais laissé installer en si belle position s’il avait eu son mot à dire.
Cette image est en effet extraite d’une œuvre vidéo, Achayef, tournée dans un paysage désertique jamais nommé, où les métamorphoses des végétaux pour survivre à la violence du climat racontent par métaphore les stratégies de résistance du peuple sahraoui. Le daghmous, une plante qui a perdu ses feuilles pour se parer d’épines, prend valeur d’emblème politique dans un paysage meurtri, où « les montagnes sont devenues aveugles et la terre est devenue cendre ».
Cette botanique de l’histoire, c’est l’une des pistes qu’emprunte « Les Sentinelles » pour tresser autrement les récits et les images des mondes arabes contemporains, non selon une géopolitique des conflits, mais à travers autant de contre-espaces au spectacle de la violence, hors-champs où le temps médiatique semble s’abolir.
Déserts et mers, étendues d’éternité et d’oubli, composent les paysages privilégiés de ces récits muets, entre chien et loup, sur une plage de Casablanca dans une fable animalière d’Ilias El Faris (Aïn Diab), entre documentaire et fiction, avec la version installée du magnifique film de l’Algérien Hassen Ferhani, 143 rue du désert qui ouvre la première salle de l’exposition, ou encore entre mythologies et actualités, avec l’impossible écriture d’une lettre d’amour au Liban dans le conte philosophique de la vidéaste palestinienne Basma Alsharif The Story of Milk and Honey.
Ces contre-espaces, les commissaires les appellent des foyers. Ils forment autant des refuges pour échapper à la guerre que des étincelles pour ranimer les feux de la révolte. Cinq foyers abritent ainsi une trentaine d’œuvres – photographies, films, vidéos – sélectionnées par Camille Leprince parmi les 32 000 photographies et 1 600 œuvres audiovisuelles de la collection du CNAP. Disons d’emblée que ce que l’exposition met en lumière est magnifique, que l’on considère une par une les œuvres retenues ou que l’on se soucie de l’ensemble ainsi agencé, et de ce qu’il compose. Cet ensemble s’ouvre avec un fragment d’un poème de Mahmoud Darwich écrit durant le siège de Ramallah voilà vingt ans :
« Ô veilleurs ! N’êtes-vous pas lassés
De guetter la lumière dans notre sel
Et de l’incandescence de la rose dans notre blessure
N’êtes-vous pas lassés ô veilleurs ? »
Et de fait l’exposition aurait sans doute à meilleur droit pu s’appeler « Les Veilleurs », tant les artistes et les œuvres sont plus les témoins et les gardiens de la mémoire que les défenseurs de quelque citadelle que ce soit. D’une gigantesque épave de cargo en Mauritanie, monument malgré lui de tant de naufrages migratoires, à cinq brèves et foudroyantes vidéos du collectif Abou Nadara qui, semaine après semaine pendant plus de cinq ans conçut des formes visuelles pour dire la révolte du peuple syrien contre la dictature el-Assad, la traversée de l’exposition fait écho aux multiples tragédies qui meurtrissent le monde arabe.
Mais elle s’inscrit cependant à contretemps de la logique événementielle des médias, en s’attachant à des propositions artistiques qui ne cessent d’interroger les impensés de l’image et les impuissances du langage. En arabe comme en français, observe la plasticienne franco-marocaine Yto Barrada, le mot « détroit » se construit sur les racines d’étroi-tesse (dayq) et détresse (mutadayeq). Dans sa série photographique, Le détroit, notes sur un pays inutile, elle explore cette géographie du langage, cet espace transfrontalier où se conjugue l’espérance et la perte.
Seule image journalistique, La Madone de Benthala (Hocine Zaourar, 1997) mobilise le souvenir de la « décennie noire » en Algérie, mais aussi la manière dont cette photographie a joué un rôle central dans la discussion, et parfois les polémiques violentes, sur les modèles iconiques susceptibles d’être mobilisés et diffusés, aussi bien que sur la nature des événements auxquels renvoie la photo[1]. De même, la série Miradors du photographe gazaoui Taysir Batniji s’inspire des images de châteaux d’eau de Berndt et Hilla Becher pour documenter l’architecture d’occupation et de surveillance mise en œuvre par l’armée israélienne, les tours et miradors composant autant d’éléments stratégiques d’un dispositif d’enfermement et d’oppression des Palestiniens.
Dans les profondeurs se révèlent sous la couche d’algues et de sable, les vestiges d’une guerre dont on ne sait plus si elle est un souvenir ou un éternel présent.
Dans l’accumulation ironiquement superficielle de ces architectures coercitives, qui peut renvoyer à un catalogue de constructions d’abris de jardin, on retrouve aussi l’écho d’un passage célèbre du commentaire de Jean Cayrol et Chris Marker dans Nuit et brouillard dressant la typologie des différents types de miradors découverts dans les camps allemands (« Pas de style imposé. C’est laissé à l’imagination. Style alpin, style garage, style japonais, sans style… »).
C’est l’une des grandes vertus de la proposition spatiale, visuelle et sonore agencée par Pascale Cassagnau et Camille Leprince que de ne cesser d’éveiller ainsi des échos multiples, entre des œuvres pourtant crées dans des lieux et des circonstances éloignés, mais aussi avec un très riche imaginaire politique et visuel, bien au-delà de ce qu’on peut effectivement voir sur les murs de l’ancienne école de natation de Tourcoing transformée en musée.
La réussite de l’exposition comme ensemble tient à cette cohérence qui sait éviter de tenir quelque discours généralisant ou didactique que ce soit. Ainsi des grands tirages issus de la Série blanche du Tunisien Jellel Gastelli : leur splendeur muette, et peut-être plus encore la calligraphie blanc sur blanc qui fait signe sans faire discours, apaise le regard et l’esprit sans rien céder à la dureté des réalités évoquées.
Ainsi de l’importance du hors-champ dans nombre de ces œuvres, les photographies du palestinien Raed Bawayah, de retour dans son village natal en Cisjordanie, cherchant dans le présent à recomposer ses souvenirs d’enfance, ou bien la dérive solitaire d’Ismaïl Bahri dans les rues de Tunis, un gobelet d’encre à la main cadré en plan serré dans lequel le reflet du ciel et de la rue redouble l’image et inscrit subtilement sans jamais le nommer tout un pan invisible de la réalité. Orientations, et sa lentille bricolée à partir d’un dispositif minimal, témoigne de ce que l’on peut s’armer de moyens dérisoires pour produire d’autres expériences du monde, que le geste du filmeur est moins une manière de saisir des images que de les laisser advenir, même quand celles-ci demeurent invisibles. D’une certaine manière, il faudrait pouvoir « dessaisir » les images pour mieux les voir.
L’écart entre l’image et son dehors travaille encore, mais différemment, les films de Dania Reymond ou de Randa Maroufi. Avec Le Park, cette dernière remet en scène, dans le décor d’un parc d’attractions abandonné à Casablanca, les codes du jeu vidéo ou des images postées sur les réseaux sociaux avec une bande d’adolescents, éprouvant dans l’iconographie perturbante de ces poses la violence symbolique des mémoires qu’elles convoquent. La Tempête, de la cinéaste franco-algérienne Dania Reymond, rejoue une séance de projection de films de propagande coloniale française dans les villages d’Algérie à l’époque de la lutte pour l’indépendance, comme une prémonition de possibles autres usages de la caméra et du grand écran.
À sa manière, la très belle installation sur deux écrans des Libanais Joana Hadjithomas et Khalil Joreige Se souvenir de la lumière offre une métonymie de l’ensemble de l’exposition. Tourné dans les eaux au large de Beyrouth, Jounieh et Tabbarjah, ce diptyque vidéo nous plonge dans l’espace sans coordonnées de la mer, dans un sentiment qui oscille entre l’effroi de la noyade et l’apaisement d’un monde sans gravité.
Dans les profondeurs se révèlent sous la couche d’algues et de sable, les vestiges d’une guerre dont on ne sait plus si elle est un souvenir ou un éternel présent. Au prisme de cette immensité bleue, la lumière décomposée éclaire tout à la fois l’histoire des violences qui endeuillent la région, l’exil et les vies englouties, mais aussi l’espoir qu’incarne le mouvement gracieux d’une étoffe colorée portée par les flots. Rien n’est oublié, rien n’est occulté, mais la terreur n’impose plus son irrépressible forclusion.
« Les Sentinelles », œuvres de la collection du CNAP à l’Institut du Monde Arabe-Tourcoing. Jusqu’au 12 février 2023
