L’iboga était beau gosse – sur Djinns de Seynabou Sonko
Comment sait-on qu’un livre est impeccable, fluide, réussi selon une recette rangée ? C’est qu’on sent monter en soi, à la lecture de l’ouvrage, la force obscure de l’antique « commentaire composé » des classes littéraires : pris de folie rétrograde, on va pouvoir entomologiser le lexique comme une collection de papillons morts (« poukave », « hess », « depuis blindé », « sorcelé », etc.), mettre le roman en coupe hégélienne selon le supposé « mouvement de l’esprit » dont Gérard Genette s’amuse dans Figures II.
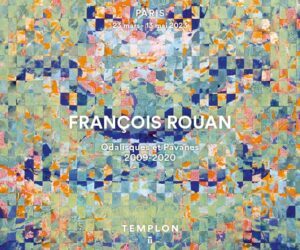
Où l’on pose que tout texte se résume assez aisément : c’est la dialectique d’un esprit qui se révèle à lui-même et d’une poétique qui assume son taf, comme par exemple dans « Attendre. Un verbe si tendre ne m’avait jamais paru aussi cruel. »
À nous les échos inaperçus remontant des abysses de l’interprétation et la preuve que tout se tient, comme quand la narratrice de Djinns retrouve au fond d’une forêt un arbuste que son aïeule y a planté des années auparavant – ah, racines, quand vous nous tenez. Le commentateur va pouvoir user son huile de coude à traquer l’isotopie, telle cette description d’un rire libérateur qui apparaît trois fois, belle comme une calavera mexicaine : « kakakaka, tête vers l’arrière toutes les dents dehors. » Il s’ébaubira aussi de tel décrochage référentiel dans l’univers fictif, quand la narratrice se met à énumérer, l’air de rien, la typologie des mouches cosmétiques au XVIIIe siècle : « La discrète sous la lèvre, la majestueuse sous le front, la tendre sur le lobe de l’oreille, l’enjouée sur la pommette, l’effrontée sur le bout du nez et la baiseuse au coin de la bouche. »
Ne manquons pas de relever tout ce qui relève du métatexte poétique et de la langue qui coulisse à vue : « J’avais l’impression d’être bilingue au sein même du français » (p. 14), « aujourd’hui tout le monde dit wesh, alors il faut créer de nouveaux codes, dépoussiérer les anciens mots, en inventer d’autres, parce que la langue à elle seule est devenue une start-up. » (pp. 63-64). On débusquera le métatexte qui ne parle pas directement du texte (piège) avec Memento de Christopher Nolan (2000), film cité deux fois qui traite d’amnésie et qui est monté dans l’ordre antéchronologique : une image parfaite de l’anamnèse que vit le personnage de Jimmy dans Djinns. D’ailleurs le prénom Jimmy ne serait-il pas une référence cryptée à un autre film, celui d’Arnaud Desplechin, Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des Plaines, 2013), dont le héros fournit à Georges Devereux l’occasion d’inventer l’ethnopsychiatrie ?
En effet, dès la quatrième page, le problème apparent de Djinns est posé : « Mami a dit, tu sais Penda, les psys c’est pour les Blancs, allons sortir Jimmy de là. » Penda, la narratrice, est skateuse et ex-caissière de supérette, sa grand-mère d’origine sénégalaise (mais gabonaise de cœur à cause d’un certain Tonino) s’appelle Mami Pirate (c’est son prénom, sans « e ») et Jimmy est un jeune voisin laissé en vrac par sa mère, blanche alcoolique : le père, Sénégalais, est resté à Dakar. Suite à une castagne entre dealers, Jimmy se retrouve en HP labellisé « schizophrène ». Mais selon Mami Pirate, il est surtout victime d’un djinn, d’un esprit, « pas content, pas content du tout ».
Tapons dans les internets « djinns schizophrénie » : on découvre que leur ressemblance est une question récurrente. « Dans les hôpitaux psychiatriques, lit-on sur un forum marocain à la date du 14 août 2006, les ethnopsys qui prennent en compte la dimension ethnique et culturelle chez leurs patients sont très rares. J’ai une amie musulmane qui travaille en psychiatrie, elle ne se verrait évidemment jamais dire à ses collègues “oh mais nous avons là tous les signes d’une possession par un djinn…” mais il paraît que certains ethnopsys envoient chez le talb, ou chikh, ou le marabout, ou le guérisseur certains de leurs patients. »
Apparemment, il y a de la symptomatologie qui se bouscule au portillon. « Les djinns, j’y croyais parce qu’ils étaient réels, dit Penda, mais cela ne voulait pas dire qu’ils existaient. » Cette philosophie stricte n’est pas faite pour étonner, puisqu’en Europe, les magnétiseurs calment les angoisses et les brûlures de radiothérapie. Pour soigner Jimmy, Mami Pirate préconise l’ingestion d’iboga, un hallucinogène susceptible de vous remettre les idées en place. Elle en a semé dans la forêt de Fontainebleau, ce sera l’objet de la quête de Penda et de son amoureux d’enfance Chico, garçon taiseux non dénué d’ « yeux en amande ».
Par son « bilinguisme » culturel annoncé, le roman déborde le sens traditionnel du djinn islamique pour en faire un concept plastique, de même qu’il déborde la schizophrénie du colonisé ou du capitaliste : dans le cas de Penda, son « djinn » est plutôt un idéal du Moi. Mami Pirate (elle tient son patronyme de la publicité pour des conserves pseudo-bretonnes) a repéré que le djinn de sa petite-fille était « blanc, du genre blanc de chez blanc », au point que sa « partie blanche […] ne voit pas les couleurs » et « pense être le centre du monde ». L’analyse est parfaite, se dit le lecteur blanc qui s’est rendu compte récemment de son propre privilège blanc : il se vivait antiraciste parce qu’il traitait tous ses amis racisés comme s’ils ne l’étaient pas. Erreur, c’est juste qu’il était aveugle.
Pour un antiraciste Blanc un peu ancien, le monde entier est blanc, ses amis africains ou asiatiques sont blancs, il ne voit aucune différence ; il croit sincèrement, en les repeignant de son amour, qu’ils partagent son privilège. Il faut du temps pour se défaire de cette berlue-poutre-dans-l’œil. Il comprend que cela peut également arriver à des racisés. Albert Memmi n’a-t-il pas écrit de Frantz Fanon qu’il se vivait « français et blanc » à ses débuts ? De même le djinn de Penda est-il « dans le déni ». Et celui de sa sœur aînée, Shango, semble tout autant dans la gênance : « Le djinn de Shango, j’peux pas le supporter, il a une tête à s’appeler Guillaume, à porter des vêtements trop grands pour lui et à prendre soin de laisser dépasser de sa poche le titre du bouquin qu’il lit. »
Si vous avez manqué le début : les tiraillements de l’idéal du Moi et du Moi idéal constituent l’essentiel de ce qu’il y a à retenir de Djinns.
L’antiraciste Blanc légèrement gâteux est un peu plus embêté quand il arrive à cette description du personnage de Léa, professeure de français et « gentille Blanche de gauche qui écrit des articles dans des magazines où elle se fait porte-parole de la cause noire, elle, pourtant complètement déconnectée de ses écrits. » C’est lui, il se reconnaît. Un devenir Clémentine Célarié l’attend-il ? Heureusement, le lecteur aigri a remarqué que la narratrice n’était pas non plus parfaite car, si Djinns intersectionne un couple de lesbiennes mixte (mais entâché par la bourgeoisie de l’une), un « djinn transgenre qui s’injecte régulièrement de la testostérone » et l’idée que Penda pourrait être « queer », las, celle-ci se vautre dans un validisme éhonté en traitant les malades de l’hôpital psychiatrique de « légumes ».
Si vous avez manqué le début : les tiraillements de l’idéal du Moi et du Moi idéal constituent l’essentiel de ce qu’il y a à retenir de Djinns. Il y a certes le racisme des Blancs de la supérette et de la caissière en chef, qui se moque de l’accent d’une employée. Mais aussi l’inadéquation de Penda et son djinn blanc quand elle débarque au Sénégal : « on s’est fait repérer direct. En même temps, avec la dégaine que j’avais, j’aurais dû m’y attendre. » Aurait-elle parlé wolof, note-t-elle, que cela n’aurait pas suffi pour « appartenir » : « on voulait savoir si j’étais plutôt Noire des vallées, Noire des îles, Noire du désert ou Noire des côtes. » Si bien qu’elle en arrive à cette conclusion désespérément ironique : « dans le lot des choses que je n’avais pas choisies, être une femme était parfois un problème de second ordre. »
Dans cet ordre, ce n’est pas non plus formidable, car des relations avec les hommes, la jeune femme déduit que le fétichisme règne : « les Rebeus sont négrophobes, les Renois coloristes, et les Blancs négrophiles ». Au-delà du colorisme, le père de Jimmy « comme beaucoup de Sénégalais » avait même eu comme « désir le plus ardent […] de prendre pour femme une Blanche. » Bref tous ces êtres humains sont bien fatigants, tout comme est fatigant de « devoir justifier de son existence, que ce soit d’un côté ou de l’autre de la Méditerranée. Mon ambition était ailleurs, dans un lieu où les choses auraient plus d’importance que les êtres, où l’invisible servirait à imaginer un nouveau monde, digne d’être rendu visible. » Le réel plutôt que l’existence ?
Comme ce roman est fort bien construit, ce sera le dernier mouvement de Djinns que d’amener au réel ce qui n’existe pas et vice-versa, en trois chapitres perdus dans les bois et auprès d’une « mare aux fées ». C’est ce côté « conte » qui charme dès l’incipit : « Le téléphone a sonné dans le salon. J’ai répondu, parce que ma grand-mère, Mami Pirate, disait que si je voulais être une bonne guérisseuse, il fallait commencer par répondre au tél pour prendre les rendez-vous ». Un mélange de merveilleux et de trivial, typique de l’enfance et narré dans une syntaxe faussement innocente – on peut penser à Quand j’avais cinq ans je m’ai tué (1981) d’Howard Buten ou Gros-Câlin (1974) d’Emile Ajar, deux histoires de défaillance affective comme en connaissent les personnages de Djinns : « Une femme rouge, un homme noir, ils auraient pu faire plus subtil que de mettre au monde un gamin schizo, franchement. Et pour les pères, faut inventer une couleur spéciale, celle de l’absence. » Boris Vian marcherait aussi.
Une des meilleures séquences de l’ouvrage est celle où Mami Pirate montre à la narratrice une photo du mystérieux iboga : « on pouvait voir Tonino tout sourire, en pleine forêt gabonaise, derrière un arbuste fleuri pas plus haut qu’un gosse de 5 ans. Le photographe lui-même devait certainement être un gosse du village compte tenu de la hauteur du cadrage. C’était peut-être sa toute première photo. Clic. » Fidèle à sa vieille méthode pour faire rentrer les textes en eux-mêmes, le critique trouvera que cette hauteur d’enfant est une métaphore assez opératoire de la poétique à l’œuvre ici, et puisque ce premier roman se clôt sur la phrase « il faut aller vers soi, rester pirate », il ajoutera qu’on fréquente avec délices cette île aux trésors.
Seynabou Sonko, Djinns, Grasset, janvier 2023.
