Pour une anthropologie publique
La question de « l’intellectuel » n’est devenue un sujet pour les chercheurs qu’assez récemment, alors que depuis l’affaire Dreyfus, romanciers et journalistes, ou penseurs se tenant par principe à l’écart des institutions, ont incarné cette parole publique considérée plus « vraie » que d’autres parce que à la fois libre et décentrée [1]. Jean-Paul Sartre a lui-même incarné et théorisé cette figure de l’intellectuel universaliste en le définissant comme « quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas » et qui prend le risque de s’engager au-delà de soi, voire contre soi, sortir de sa condition pour pouvoir s’ouvrir aux autres (les « opprimés ») et au monde.
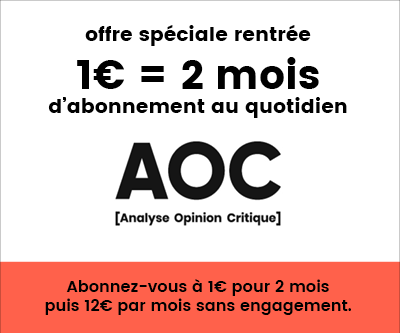
Poussée bien plus tard jusqu’à la caricature par certains « intellectuels médiatiques » (« BHL », etc.), cet engagement s’est lui-même déconsidéré par sa méconnaissance des causes célébrées, allant jusqu’à brandir l’universalisme comme outil de domination. Face à lui, la figure de l’intellectuel spécifique portée par Michel Foucault a consisté à dire en substance « je ne me mêle que de ce qui me regarde » c’est-à-dire « de ce que je connais ». Cet engagement-là, bien plus que le précédent, a pu intéresser les chercheurs en sciences sociales parce qu’il les confortait dans la légitimité scientifique de leur éventuelle parole publique, tout en les éloignant à la fois d’une vocation supposée de « savant dans sa tour d’ivoire » ou, à l’inverse, d’un usage détourné de leur légitimité pour opiner sur tout et rien.
C’est de là, de la proximité immédiate que tout chercheur voulant « s’engager » peut ressentir avec la proposition foucaldienne de l’intellectuel spécifique, qu’il est possible d’inverser le raisonnement et de s’interroger sur la parole publique des chercheurs en repartant de leur savoir.
Une intelligence du monde
Et c’est à partir de là aussi qu’il est utile de nous interroger sur la tâche singulière des anthropologues. Car, si l’intellectuel est celui qui pense au-delà de sa propre condition, qui sort de soi et se relie à l’universel de l’humain, alors tout anthropologue devrait se considérer un intellectuel au sens premier, universaliste, comme première raison de son engagement. En outre, l’anthropologie a pour principe fondateur d’observer en tous lieux la diversité et l’unité de la condition humaine. Très vaste programme, évidemment, mais qui fait de l’anthropologie autre chose et bien plus qu’un métier ou qu’une matière à enseigner, même si le travail du chercheur – l’ethnographie, l’analyse, la compréhension, l’écriture – requiert de la méthode, de l’astuce, et de la réflexivité, comme l’ont montré nombre d’ouvrages sur le métier d’anthropologue.
Une perspective plus large est possible. L’anthropologie est aussi et surtout une proposition d’intelligence du monde à la disposition de tout un chacun, selon une approche à la fois universaliste dans son cadre intellectuel (détaché de soi pour comprendre tout autre humain quel qu’il ou elle soit) et bien « ancrée » sur le terrain (grounded) par le regard et l’implication personnelle du chercheur.
En tant qu’intellectuels – c’est-à-dire des travailleurs intellectuels intervenant dans la sphère publique –, les anthropologues pourront donc se prévaloir d’être par définition des intellectuels organiques de l’humanité. La formule peut paraître présomptueuse mais c’est tout le contraire. Elle a été utilisée, une seule fois et de manière quelque peu provocatrice, par Pierre Bourdieu pour définir son engagement en se distinguant de la figure gramscienne de « l’intellectuel organique » d’une classe et d’un parti, et cela dans une réflexion sur sa première expérience de terrain, algérienne et anthropologique, au début des années 1960 [2]. Et si elle peut faire sens aujourd’hui, c’est parce qu’il incombe à l’anthropologie une tâche particulière, considérable même. Comprendre et faire quelque chose face aux incertitudes sur ce que nous autres « terriens » sommes capables de partager dans un même monde, face aux politiques de repli identitaire, aux rhétoriques du refus de l’autre, du « laisser mourir », de la remise en cause du principe général et universel des droits humains, face à toutes ces crises et polémiques qui répètent la dénégation d’une projection commune et de la solidarité planétaire. Parce que cette crise, c’est en quelque sorte la spécialité de l’anthropologie. C’est l’objet de son engagement « spécifique » et « universaliste » à la fois.
L’anthropologie publique naît dans la société et y revient
De là naît la réflexion sur le besoin d’une anthropologie publique. Celle-ci se situe dans un espace sécant entre plusieurs orientations déjà bien établies et débattues depuis quelques décennies dans les sciences sociales, tout en s’en différenciant : ce sont les positions du chercheur expert, militant ou académique.
On les retrouve dans certaines « figures ». Il y a celle de l’anthropologue dit « militant » dont la version « avocate » (advocacy) auprès des communautés indigènes défendues par l’ethnologue est la plus connue, mais il en va à peu près de même des anthropologues qui consacrent leurs travaux et leurs interventions à défendre telle cause ou tel mouvement social, au risque de l’autocensure et du privilège de la partie sur le tout. Il y a l’« expert » de l’anthropologie dite « appliquée » qui répond à des commandes des institutions publiques (services ministériels, organismes municipaux ou régionaux), des agences internationales ou des organisations privées non gouvernementales (organisations humanitaires ou agences de développement), sans avoir de prise sur les problématiques qui fondent ces commandes ni, toujours, sur leurs conséquences politiques. Et il y a l’idéal encore présent même s’il a été mis en cause, de l’anthropologue qui prétend développer sa recherche à l’écart des questions de société pour que sa recherche ne soit pas polluée par les polémiques, croyant ainsi à la vertu d’une pureté académique comme dans les sciences physiques ou biologiques.
Entre toutes ces limites, il y a place aujourd’hui pour une anthropologie publique qui associe les différents acteurs de la société sur lesquels et avec lesquels elle mène son projet. Non pour produire une connaissance « de laboratoire », qui se prétendrait pure, normative et vraie par essence, mais pour faire naître une connaissance à partir de son implication dans la vie sociale et à travers les relations de l’enquête. La phase de recherche est elle-même participative voire « collaborative » − ce qui représente une critique de la définition d’une anthropologie strictement « académique », qui serait séparée de ses contextes de production et valorisation.
La plupart des chercheurs se préoccupent aujourd’hui de l’audience et de l’impact de leurs travaux, et il convient donc de sortir de l’auditoire habituel des essais et monographies – le public restreint des professeurs, chercheurs et étudiants −, pour être entendus (et donc audibles) « en dehors de la tour d’ivoire ». Dans cette démarche de valorisation et de recherche d’impact, le fait de rendre l’anthropologie publique présente quelques risques qu’il convient d’assumer, en particulier lorsque les critiques ou, plus précisément, les « déconstructions » de la recherche se confrontent aux censures, réécritures, manipulations ou incompréhensions des lecteurs et auditeurs, des personnes directement concernées ou des journalistes. Réciproquement, il est bien clair maintenant que la recherche dans sa caricature « académiciste » devient souvent obscure, illisible et inutile pour les sociétés. C’est en ayant acquis l’expérience et la conscience de ces difficultés que la proposition d’une revue d’anthropologie publique est née, comme un projet collectif, comme une proposition, parmi d’autres, d’engagement concernant aussi bien l’objet des recherches, l’écriture choisie et le public visé.
L’anthropologie française est restée étonnamment discrète sur la question de ses engagements dans le monde qu’elle étudie. Pourtant, entrer en dialogue avec des publics concernés, restituer des savoirs en les rendant appropriables en pratique, travailler à la connaissance des situations autant qu’à leur transformation, mettre en œuvre des formes de coproduction des savoirs en faisant des enquêtés des co-enquêteurs : tout cela fait désormais partie du bagage de l’anthropologie et des sciences sociales de terrain. Que l’on parle d’anthropologie impliquée ou engagée, d’ethnographie coopérative ou de science citoyenne, une série de réflexions a vu le jour en France, aux États-Unis et dans le reste du monde. Critiquant les perspectives issues de la colonisation, cette démarche explore les modes de dialogue et de collaboration entre enquêteurs et enquêtés, elle remodèle les genres d’écriture et les cadres d’interprétation, elle fait évoluer les objets et méthodes « classiques » de l’anthropologie à l’épreuve de ses ancrages dans les mondes qu’elle observe et de la réception de ses textes.
L’anthropologie trouve sa pertinence dans sa capacité à rendre le chaos du monde un peu plus intelligible. Trop peu visible dans le monde médiatique (où elle reste contingentée, malgré ses évolutions diverses, à l’étude des « sociétés exotiques » voire « primitives »), elle se doit d’être davantage publique. Ni savoir « militant » au service d’une cause, ni savoir « expert » au service d’un pouvoir, l’anthropologie publique vise à rompre cette distance artificiellement entretenue. Elle naît dans la société et y revient. Elle en est partie prenante, et elle la réfléchit. Elle en est un ouvroir autant qu’un miroir.
Née du constat d’un déficit d’engagement des anthropologues dans et auprès de leurs publics, d’un désinvestissement d’une partie de l’anthropologie pour les enjeux contemporains de la société au profit de la production de tableaux culturels exagérément « autres », ou encore d’une forme d’abandon du terrain pour des abstractions invérifiables, le projet Monde commun entend fournir un espace de réflexion et d’intervention nouveau pour l’anthropologie et pour ses publics. L’engagement dans la cité peut se faire sans rien céder à la rigueur scientifique.
Les trois premiers volumes de Monde commun s’interrogeront sur la violence en prenant au sérieux le mot d’ordre des banlieues françaises « Violence partout, justice nulle part ! » et en le relisant au regard de plusieurs expériences comparables dans le monde (n° 1, coordination Chowra Makaremi, Michel Naepels, Perrine Poupin). Sur les fake news mises en relation avec les multiples mensonges, manipulations et inventions observables partout, comme avec la « vérité du terrain » dont les anthropologues peuvent se prévaloir au prix d’une analyse critique de leur terrain (n° 2, coordination Martin Lamotte, Léonore Le Caisne, Stefan Le Courant). Ou encore sur la multitude migrante à la rencontre de l’ordinaire et de l’utilité des immigrés et autres « étrangers » pour faire exister le monde (coordination Michel Agier, Carolina Kobelinsky, David Picherit).
Il ne s’agit pas de parler au nom et à la place des « autres » mais de porter publiquement un savoir spécifique, et ainsi faire sa part de la nécessaire compréhension du monde contemporain de ses crises. Dans un monde fait de multiples tensions, dont l’horizon est troublé et où des questions fondamentales suscitent toujours plus d’inquiétude, ce projet veut faire la preuve que les savoirs de l’anthropologue sont utiles. Nous croyons que les citoyens demandent à partager et à discuter les savoirs qui les concernent, et à y participer, Monde commun se veut l’outil d’une mobilisation intellectuelle, partagée entre les chercheurs et leurs publics.
Le premier numéro de Monde Commun sortira aux PUF le 12 septembre prochain.
