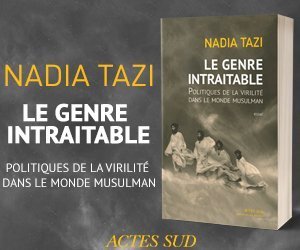Pour attirer les étudiants étrangers, le gouvernement veut… les faire fuir
À les entendre, nous pourrions penser que le président de la République et son Premier ministre, qui se piquent d’être des gens de lettres, ont, récemment, décidé d’apprendre aux Françaises et aux Français à maîtriser toutes les subtilités de la rhétorique. Après le pseudo mea-culpa du premier dans lequel il nous expliquait qu’il n’avait « pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants », nous donnant ainsi une magnifique illustration de l’« euphémisme » (ainsi que le notait Cécile Alduy sur Twitter).
C’est en effet le Premier ministre qui, lundi, semblait vouloir nous faire goûter toutes les subtilités de l’« antilogie », cette figure de style qui mobilise dans une même phrase ou un même texte, une contradiction ou incompatibilité entre deux idées ou deux opinions. N’affirmait-il pas vouloir : « accroître l’attractivité de l’enseignement supérieur à l’international »… « en faisant payer davantage les étudiants étrangers » ? Quelle maîtrise de l’ironie ! Quel art de la rhétorique ! D’autant plus savoureux qu’il présentait cela sous le slogan « la stratégie #BienvenueEnFrance » !
Sauf que ce n’est pas une blague. C’est très sérieux. Et pas drôle du tout.
C’est notre pays tout entier qu’Emmanuel Macron et Édouard Philippe affaiblissent et notre avenir qu’ils assombrissent.
En effet, même accompagnée comme il le propose également par un accroissement des bourses et des exonérations, une telle mesure, consistant à multiplier par dix les frais d’inscription des étudiants étrangers extra-communautaires, en les portant à 2 770 euros en licence et 3 770 euros en Master et Doctorat, aura comme conséquences logiques : une baisse de l’attractivité de l’enseignement supérieur, une perte de dynamisme de la recherche et, au-delà, une perte d’attractivité de notre pays et de son rayonnement dans le monde, tant culturel qu’économique. Partant, c’est donc notre pays tout entier qu’ils affaiblissent et notre avenir qu’ils assombrissent.
Cris d’orfraie d’id