Le manifeste anti-Macron des « stratèges » de l’Élysée
Il faut prendre au sérieux l’ouvrage des « stratèges de Macron », ainsi que l’éditeur présente sur le bandeau Le progrès ne tombe pas du ciel, co-écrit par M. David Amiel, ex-conseiller économie du président de la République du 8 mai 2017 au 25 mars 2019, et M. Ismaël Emelien, ex-conseiller spécial du président de la République pendant la même période – et précédemment conseillers au cabinet du ministre de l’Économie Emmanuel Macron de 2014 à 2016.
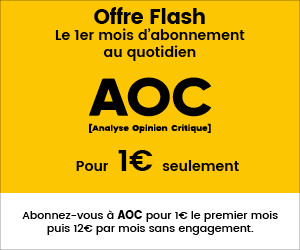
C’est que, avant leur publication, les 147 pages de texte « utile » de cet ouvrage à la typographie très aérée ont été inspirées, approuvées, lues, relues et corrigées par tout ce qui compte dans le groupuscule de ceux qui nous gouvernent, ainsi qu’en témoignent les trois pages de remerciements (p. 169-171). Et l’ambition de l’ouvrage n’est pas mince : il s’agit rien moins que de définir les principes, les méthodes, les objectifs de ce que les auteurs appellent « progressisme », qui selon eux est incarné par la doctrine et les actions de l’actuel président de la République (voir la quatrième de couverture : « Il y a aussi les progressistes, dont l’élection d’Emmanuel Macron est la plus belle victoire ») et auxquels ils croient habiles de conférer l’exclusivité[1].
Cet ouvrage étant rédigé par deux jeunes hommes ayant pour qualité de ne pas être issus de l’un des grands corps de l’État ni même d’avoir été élèves de l’ENA, d’avoir œuvré pendant au moins quatre années – deux années ou presque à l’Élysée, deux années au ministère de l’Économie sous le quinquennat précédent – au cœur du pouvoir qu’ils viennent de quitter pour – à les entendre – user d’une plus grande liberté de parole, on pouvait espérer un vent de fraîcheur intellectuelle, en contraste avec le parfum des années 1980 désormais mêlé à l’odeur affreusement irritante des gaz lacrymogènes que véhicule le premier tiers du quinquennat Macron.
Alléché par ces perspectives, tout lecteur curieux ayant déboursé 15 euros pour pouvoir enfin découvrir la pensée de deux personnes médiatiquement discrètes que la presse unanime a présenté depuis deux ans maintenant comme des « cerveaux » de la « macronie » est légitimement en droit de s’attendre à l’excellence sur les plans philosophique, politique, doctrinal, pratique, stylistique. Gageons que, s’il y en a, beaucoup de lecteurs seront à cet égard rapidement déçus.
Le progrès ne tombe pas du ciel est une contrepublicité pour le « macronisme » et le « progressisme » – ce qui est un comble pour ce professionnel de la communication que M. Emelien est censé être.
En effet, l’ouvrage dresse, en creux, un très violent constat d’échec du « macronisme », dont par ailleurs il illustre les travers à deux égards : en ce que le discours des auteurs ne correspond pas aux réalisations qu’ils ont initiées ou validées depuis Bercy ou l’Élysée ; et en ce que le « progressisme » professé n’est qu’un copié/collé, sous une autre appellation faussement moderne, du libéralisme économique né et déjà mis en œuvre (notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis) au cours du millénaire précédent.
Le constat de l’échec de la start-up Nation
Les deux auteurs décrivent une France en piteux état, sans perspective d’amélioration à court ou moyen termes.
Rien ne trouve grâce à leurs yeux : ni les institutions et la concentration du pouvoir central à Paris, ni les méthodes d’enseignement, ni l’action gouvernementale, ni la société en général. Voici un florilège non exhaustif de l’état des lieux absolument apocalyptique décrit quasiment sur chaque page par les deux « stratèges » : « notre société est une société de la frustration » (p. 48) ; « malgré quarante années de combat en son nom, l’égalité des chances a reculé » (p. 60) ; « il faut encore davantage de moyens. Pour l’école et l’université, bien sûr. Mais aussi pour la formation continue » (p. 61) ; « l’on voit proliférer de plus en plus des classes fantômes, où les professeurs font semblant d’enseigner à des élèves qui font semblant d’écouter » (p. 65) ; « l’éducation ne suffit pas à obtenir un travail qui réponde aux exigences progressistes de justice, d’accomplissement, d’utilité sociale, de reconnaissance. Car les structures principales de l’économie sont orientées vers bien d’autres choses que le progrès. Elles servent une minorité de plus en plus étroite, qui capture la quasi-totalité des bénéfices produits par les gains technologiques » (p. 69) ; « en France, tous les pouvoirs – symboliques, économiques, politiques, culturels – sont concentrés à Paris. Ce monopole n’a rien de naturel et devrait donc être démantelé » (p. 92) ; « nous n’avons plus les institutions, à tous les niveaux, qui nous permettraient de reprendre la main face aux transformations en cours » (p. 90) ; « des régions entières où il faisait bon vivre sont devenues comme inhospitalières » (ibid.) ; « nous avons l’impression que les élections et les lois ont de moins en moins de capacité à changer nos vies » (p. 119-120) ; « aujourd’hui, l’État régule tellement de domaines qu’il réplique souvent les contradictions de la société au lieu de les résoudre » (p. 122) ; « notre système éducatif est un des plus mauvais de tous les pays développés, dans le sens où il reproduit les inégalités sociales » (p. 138) ; « les gouvernements semblent aussi peu dignes de confiance (aux citoyens) que la première rumeur venue » (p. 139).
Cela ferait donc près de deux ans que le « progressisme » serait au pouvoir en France, contrôlant l’exécutif, le Parlement, une partie de la justice pénale, et pourtant les deux ex-conseillers s’affligent : « l’immobilité géographique pour la majorité, la rente immobilière pour quelques-uns. Voilà le futur qui nous attend si rien ne change » (p. 40). Quant au présent, il est dramatique à en croire l’ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb qui a considéré le 31 mars 2019 sur LCI, en référence à ces « gilets jaunes » dont – on y revient immédiatement – les deux « stratèges » ont délibérément choisi d’ignorer l’existence : « On voit que le mouvement continue. Cela montre la profondeur sans doute du malaise (…). On ne peut nier qu’il y ait une véritable crise dans le pays ».
Ces cataclysmes ravageurs sont rendus plus harassants encore par leur accumulation ; il faut au surplus y ajouter la morgue et l’incompétence de nos gouvernants que les deux ex-conseillers ministériels et élyséens n’évoquent pas – et pour cause. Ces derniers en sont nécessairement co-auteurs – « complices » pour reprendre le mot totalitaire employé par le ministre de l’Intérieur et le président de la République à l’encontre des « gilets jaunes » et de leurs soutiens –, et le « progressisme » qu’ils ont eu l’occasion concrète de mettre en œuvre nécessairement l’une des origines sinon l’origine principale.
Après avoir ainsi égrené ces plaies du quotidien infligées par les pouvoirs publics nationaux aux administrés et aux citoyens, on ne peut que donner raison aux auteurs lorsqu’ils écrivent que « il y a bien de quoi se révolter » (p. 49) ! Au surplus, les auteurs soulignent plus loin qu’il y a « le feu » à « tous les étages de la société », de sorte que « demain, des franges des catégories supérieures basculeront aussi dans la révolte » (p. 144). Cette prévision risque hélas de se révéler exacte, si elle ne s’est pas déjà réalisée, avant même la fin du quinquennat Macron…
Cependant, les auteurs ne tirent pour le moment présent aucun enseignement de cette légitime, nécessaire, inéluctable et croissante indignation. Il semble même que depuis leur forteresse élyséenne les deux Candide n’ont jamais entendu parler des manifestations hebdomadaires des « gilets jaunes » sur une majeure partie du territoire national, puisqu’elles ne sont guère évoquées dans l’ouvrage ; il aurait pourtant été indispensable de passer de la théorie à la pratique, c’est-à-dire de confronter dans l’ouvrage lui-même les revendications et la situation de certains des « gilets jaunes » aux promesses d’émancipation individuelle et collective du « progressisme ». Une telle omission est d’autant plus éloquente qu’elle émane d’un communicant élyséen, sans doute désireux de masquer le deuxième (après l’affaire Benalla) moment de bascule du quinquennat : « chacun vit de plus en plus recroquevillé dans son bastion, observant le monde par une étroite lucarne », écrivent les auteurs dans une formule qui, à supposer qu’elle soit généralisable, est en tout point applicable aux deux ex-conseillers ministériels et élyséens.…
On croit pouvoir déduire de ce silence signifiant que le « progressisme » version Amiel/Emelien/Macron possède dans son ADN un chromosome incompatible avec l’engagement politique : l’organisation de son irresponsabilité publique absolue – les « gilets jaunes » me gênent, je les fais disparaître de mon champ de réflexion ; le quinquennat se passe mal, je quitte l’Élysée tout en vantant le progressisme du président de la République et donc ma propre action de conseiller de la présidence ; je quitte ma fonction de porte-parole du gouvernement pour redevenir député et me lancer en cette qualité dans la campagne des municipales à Paris –, comme lorsque les forces de l’ordre et le parquet sont entièrement mobilisés pour empêcher qu’une partie du peuple aille effectivement chercher celui qui a imprudemment provoqué sa colère.
Les auteurs prônent la « formation tout au long de la vie » comme marqueur du « progressisme » ; ils devraient si ce n’est fait s’interroger sur la nécessité d’y recourir pour eux-mêmes au regard des vingt premiers mois d’un quinquennat au bilan duquel ils ont pris une part majeure. À moins que les conseils qu’ils prodiguent ne vaillent que pour les autres…
Le diagnostic est précis, quoiqu’il faille y ajouter le « moment gilets jaunes » ; tel n’est pas le cas de l’ordonnance.
La contradiction entre le discours et les faits
À la page 61, les auteurs écrivent qu’ils se sont sentis la nécessité de « soulever le capot de la voiture pour mettre les mains dans le moteur » afin de proposer des « solutions concrètes » donnant corps au « progressisme » dont ils font la réclame. Cette affirmation suscite la perplexité : n’est-ce pas en qualité de conseiller spécial ou conseiller économique du président de la République que l’on a « les mains dans le moteur », plutôt que lorsqu’on rédige un opuscule théorique et prospectif ?
Plus largement, tout l’ouvrage est fondé sur l’occultation de leur propre action de décideurs publics et la discordance entre les préconisations et les réalisations, ce qui ruine la crédibilité de la démonstration mais se situe dans l’exact prolongement de la manière dont le quinquennat Macron se vend à l’opinion publique.
Ainsi, en quatrième de couverture, M. David Amiel, « 26 ans », se présente comme « ancien élève de l’École Normale Supérieure » qui a effectué « un séjour de recherches à l’université de Princeton aux États-Unis ». Dans l’ouvrage, les auteurs n’ont pas de mots assez durs contre le « fétichisme du diplôme » (p. 65 et 66).
Il y a p. 135-140 des développements (évidemment) critiques sur les « fake politics » et les « fake news », qui ne peuvent être pris au sérieux lorsque l’on a à l’esprit les révélations du Monde faites fin mars 2019 selon lesquelles Ismaël Emelien aurait, dans la nuit du 19 juillet 2018, afin de protéger Alexandre Benalla, manipulé des vidéos avant de les faire diffuser sur un compte twitter anonyme géré par un adhérent de La République en marche.
Se présentant dans la 4ème de couverture comme l’un des fondateurs d’En Marche !, désormais parti politique de type soviétique jusque dans son appellation même, M Emelien prône, en totale contradiction avec sa propre réalisation, l’avènement de mouvements politiques où l’adhérent serait « roi » (p. 125) : pourquoi n’est ce pas le cas, bien au contraire, dans le parti La République en marche ? Les auteurs critiquent « les inspirateurs des dérives autoritaires qui frappent de nombreux pays, s’appuyant sur un redoutable culte de la personnalité » (p. 127), mais ont été à l’origine de la décision de donner au parti qu’ils ont créé les initiales du patronyme du président de la République, ont participé depuis l’Élysée à la vente de goodies à l’effigie du président de la République, de son épouse et de leur chien, ont mis en scène de manière héroïsée le président de la République descendant les Champs-Élysées sur un véhicule militaire ou portant une tenue militaire…
Les deux « stratèges » ont gravité au plus près de l’astre ex-jupitérien pendant deux ans. Cette proximité – et partant la caution qu’ils ont donnée à l’exercice d’un pouvoir solitaire, autiste et narcissique – ne les empêche pas de déplorer que « le sommet de la pyramide croit pouvoir s’occuper de tout : il perd de vue le ‘sens’ (c’est-à-dire son rôle irremplaçable pour fixer le cap général) sans rien gagner en ‘efficacité’ (c’est-à-dire en capacité à changer le réel) » (p. 118). Il est stupéfiant de lire, sous la plume de personnes qui il y a moins de dix jours conseillaient encore officiellement l’actuel président de la République, la critique d’une pratique du pouvoir que M. Macron a exacerbée – contrairement à ses engagements de campagne. À quoi donc ces conseillers ont-ils servis pendant près de deux ans ? Ont-ils dit au président de la République que l’hyper-concentration du pouvoir à l’Élysée était contraire à la doctrine même du « progressisme » ?
La promotion qu’ils font des corps intermédiaires « transformés en associations intermédiaires » (p. 128 tant qu’à vouloir faire chic, pourquoi pas « organisations » ou « structures » ou « cercles » intermédiaires ?) et leur alerte à l’égard des dangers de l’autoritarisme institutionnel (« en détruisant les autres pouvoirs, c’est la liberté que l’on veut restreindre et la démocratie que l’on veut affaiblir », p. 127-128) est inintelligible au regard du premier tiers du quinquennat Macron, avec ses critiques systématiques de la presse indépendante, des oppositions parlementaires, des organisations syndicales, des protestations populaires… Au demeurant, cette promotion est factice, puisqu’ils encouragent ces corps intermédiaires à « cesser de concentrer leurs efforts sur la meilleure manière de convaincre l’État de prendre ou non telle ou telle décision » (p. 128), de sorte que leur « progressisme » n’est en définitive qu’un masque légitimant l’autoritarisme institutionnel : à l’État (l’exécutif) de décider de tout sans entraves « quitte à se rendre temporairement impopulaire » (p. 101, à propos de l’Europe), pendant que les corps intermédiaires cocoonent le tiers-état en accomplissant à son profit des tâches du quotidien totalement dépolitisées (p. 125 : « aides aux devoirs, aux formalités administratives, accompagnement des séniors, (…) création d’un potager urbain partagé »…).
Alors que le président de la République et le Premier ministre se sont déclarés circonspects sinon opposés à un référendum national d’initiative citoyenne, leurs deux ex-conseillers font l’éloge d’un référendum local d’initiative citoyenne (p. 130).
Alors que le 15 mars 2019 l’Assemblée nationale a repoussé de 2022 à 2025 l’interdiction de produire sur le sol français des pesticides destinés à l’exportation, les deux ex-conseillers en appellent à l’Union européenne, dont la vocation très étrange serait de devenir la « caisse de défaisance carbonique de ses 27 États membres » (p. 101), pour poser « l’interdiction à l’échelle du continent des technologies et des composants qui présentent un danger pour la santé sur le long terme » (p. 131).
Pour lutter contre le réchauffement climatique, les auteurs assurent qu’il « y a urgence à ce que les pouvoirs publics conçoivent, grâce aux outils numériques, une plate-forme qui permette à chacun de savoir quelle est l’action à la fois la plus efficace et la plus adaptée à sa situation personnelle pour participer à cette lutte collective » (p. 133). Pourquoi n’ont-ils pas incité le président de la République à agir en faveur de cette « urgence » ? Pourquoi prônent-ils seulement au jour où ils n’exercent plus de fonctions publiques officielles de « convertir 100% de la flotte de véhicules utilitaires en électrique » (p. 134) là où l’on n’a pas eu connaissance de la moindre politique publique nationale contraignante en ce sens entre le 8 mai 2017 et le 25 mars 2019 ?
Au fond, par sa méthode même, l’ouvrage des deux « stratèges », purement théorique, abstrait, détaché des réalités du quotidien et des politiques publiques mises en œuvre depuis mai 2017, ne pourra convaincre de sa pertinence que celles et ceux qui le sont déjà et par principe. Pour que deux décideurs publics nationaux parviennent utilement à « vendre » l’idéologie qu’ils promeuvent, quel que soit son nom, il aurait été indispensable de la fonder sur le résultat de leur propre action. Or, il n’est jamais ne serait-ce qu’évoqué. Et pour cause : ainsi qu’il a été dit précédemment, ce bilan est de leur aveu même catastrophique, et partant c’est cet adjectif qui est irrémédiablement attaché à l’étiquette « progressiste » dont les deux « cerveaux » se sont donnés pour mission – impossible – de faire la promotion.
Il est alors temps d’en venir à l’identification de ce qu’ils appellent « progressisme ».
Le maquillage du libéralisme économique sous l’appellation « progressisme »
Depuis mai 2017, on n’a vu sur la scène politique nationale que prééminence du chef, relégation des corps intermédiaires, dévitalisation du Parlement et insultes dirigées contre un Sénat qui pour une fois a effectivement contrôlé le gouvernement et évalué les politiques publique dans l’affaire Benalla, caporalisation de la justice, libéralisme économique, accentuation des inégalités fiscales, renforcement des élites technocratico-politiques, accélération des désastres environnementaux, réduction des libertés collectives, dans un contexte de colères et revendications sociales exprimées hebdomadairement à compter du 17 novembre 2018 par des « gilets jaunes » sans structure, sans moyens financiers et sans relais politique.
Les deux « stratèges » glissent opportunément sous le tapis ces désastres de toute nature. Partant d’une page blanche comme s’ils n’étaient pas comptables voire seulement informés des réalités de l’exercice du pouvoir, ils prônent donc l’institution du « progressisme » comme doctrine d’action, par opposition au populisme. Pour en identifier la teneur, ils proposent un plan à la science-po en trois parties thèse-antithèse-synthèse qui constituent trois des six chapitres de l’ouvrage, lequel doit en réalité être analysé comme une longue dissertation de type science-po dont le sujet-bateau posé par un enseignant en mal d’inspiration serait « quelles sont, selon vous, les caractéristiques du progressisme ? » :
I – À la « maximisation des possibles individuels » (p. 53-85)…
II – … doit se superposer une « maximisation des possibles collectifs » (p. 87-115)…
III – … qui reposent toutes deux sur l’exigence de « commencer par le bas » (p. 117-140).
En résumé et sous couvert de « progressisme » comme d’emploi d’expression volontairement consensuelles (qui peut être contre la « maximisation des possibles » et donner aux individus les moyens de « choisir leurs vies » ?) conformément à la technique de communication précédemment décrite, les deux stratèges se bornent à recycler une version idéalisée et contemporaine (référence à l’humain augmenté, à l’intelligence artificielle aux monopoles de fait des GAFAM…) du libéralisme économique à la Adam Smith.
La première partie ne fait que réitérer la confiance en les initiatives individuelles, rendues vertueuses par « l’éducation complète de chacun » (p. 61) qui permet « d’offrir à chacun un chemin qui lui soit propre » (p. 55), la « possibilité de choisir soi-même sa vie ». De tels lieux communs purement abstraits et imaginaires ne paraissent pas devoir ou même pouvoir faire l’objet d’un commentaire particulier, si ce n’est pour dire que le titre de l’ouvrage aurait mieux reflété son contenu s’il avait été « Aide-toi, le ciel t’aidera ». L’on signalera que, dans la logique de ce primat individualiste, les auteurs entendent reléguer aux oubliettes la pratique rendue juridiquement contraignante par les pouvoir public des discriminations positives au profit d’un outil purement informel qui, selon eux, serait « progressiste » : « faire honte » (p. 81) aux entreprises qui pratiqueraient la discrimination à travers la pratique du name and shame, laquelle suffirait par la seule menace en termes « de réputation, de perte de clientèle, de mise à l’index (public) » (p. 82) à faire disparaître toute forme de discrimination. Sur ce point, faute d’appareil scientifique recensé dans l’ouvrage, le lecteur est contraint de faire confiance – ou pas – à l’expertise des auteurs.
La deuxième assise du « progressisme » est censée venir conforter la première. On passe alors du niveau individuel à celui de la collectivité. En dépit de leur expérience professionnelle, les deux « stratèges » semblent découvrir qu’il peut y avoir une action des pouvoirs publics ayant des effets sur les destins individuels : ainsi qu’ils le reconnaissent p. 88, cette deuxième partie enfonce largement des portes ouvertes à la fois sur le plan des « idées » et dans la manière verbeuse de les formuler (p. 89 : « on a longtemps (sic) cru que l’on ne pouvait plus agir et que l’on ne pouvait plus vivre que séparément »). Toutefois, cette action publique « progressiste » a une finalité bien déterminée : « élargir les opportunités » individuelles. En parfaite conformité avec la doxa économique libérale telle qu’exprimée par le père du néolibéralisme Friedrich von Hayek dont le premier Ministre s’est déclaré être un admirateur à l’occasion d’un discours prononcé devant l’Autorité de la concurrence le 5 mars 2019[2], dans le monde des « progressistes », les pouvoirs publics se voient dont assigner un rôle précis et limitatif : chacune de leurs actions doit avoir pour objectif de lever les obstacles à la réalisation des aspirations individuelles, et donc de favoriser l’autonomie individuelle ; l’État doit promouvoir la fluidité des marchés et partant de la société.
On ne voit pas bien en quoi, par exemple, la diminution des APL, la suppression de l’ISF, la baisse du budget de l’hébergement d’urgence, la barémisation des indemnisations prud’homales en cas de licenciement ou encore les ignobles privatisations en cours ou à venir de biens communs hyper-rentables (Aéroports de Paris, Française des jeux, barrages hydrauliques…) contribuent ne serait-ce qu’à la marge à la réalisation de la prospérité de tous – mais on l’a dit les auteurs ne tirent aucun enseignement de leur pratique du pouvoir pour alimenter leurs réflexions. On ne voit pas non plus, tout au contraire, comment la main invisible du marché permettrait de répondre aux considérables défis du moment que sont les urgences environnementales, fiscales et sociales.
Quant au troisième pilier du « progressisme », on ne perçoit ni son utilité, ni sa ligne directrice, ni sa pertinence. Sur le terrain administrativo-politique, il est souhaité que le « haut fonctionnaire soit au service de l’agent de terrain, et pas l’inverse » (p. 120) ou que soient nommés « non plus des ministres-chefs d’administration, mais des ministres-chefs de projets, selon les priorités publiques du moment : un ministre en charge de la baisse du chômage, un ministre en charge de l’immigration et de l’intégration (…) Il y aurait aussi un responsable de la transition de la flotte automobile vers des véhicules moins polluants » (p. 122-123). À cette aune, le gouvernement pourrait comporter plusieurs centaines de ministres, dont l’un aurait pour responsabilité de former le gouvernement — on pourrait même l’appeler premier Ministre. Sur le terrain militant, les auteurs appellent de leurs vœux ce qu’ils ont échoué à construire, à savoir la création de partis politiques où l’adhérent aurait la main. Ils prônent l’avènement d’associations intermédiaires qui ne viendraient pas entraver l’action nécessairement positive de l’exécutif, mais qui auraient pour missions d’accompagner « le bas » (p. 128) au quotidien, de manière dépolitisée et aseptisée.
*
Le livre de Amiel et Emelien évoque, en parfait miroir de ce qu’est pour l’heure le quinquennat Macron, les travaux des publicistes – ceux dont le métier est de commenter l’actualité politique et sociale – que Balzac appelle les « rienologues » : « La page a l’air pleine, elle a l’air de contenir des idées ; mais, quand l’homme instruit y met le nez, il sent l’odeur des caves vides. C’est profond, et il n’y a rien : l’intelligence s’y éteint comme une chandelle dans un caveau sans air ».
Il vient renforcer deux convictions, qui vont à contresens des espérances et conclusions des auteurs.
La première, c’est que contrairement à la manière dont les deux auteurs le présentent formellement, le président de la République Emmanuel Macron n’est en rien « progressiste » au sens qu’ils donnent à ce mot. Partant, à suivre leur classement binaire du monde (les élites/le peuple, le haut/le bas, les progressistes/les populistes, Macron/le chaos…), le président Macron, à l’instar des Trump et autres Bolsonaro, est substantiellement un populiste – un dirigeant public qui conjugue l’autoritarisme institutionnel au dénigrement des corps intermédiaires et au libéralisme économique. Lui aussi, comme les populistes que les auteurs décrivent et dénigrent, tire sa force de ce qu’il « se nourrit du désastre des alternatives » (p. 151). Et comment ne pas penser à l’actuel président de la République française lorsque les auteurs assurent que les populistes « s’abîment dans une dérive autoritaire : ils désignent à la vindicte populaire de nouveaux ennemis pour justifier leur impuissance à transformer la vie des gens. Ils s’en prennent progressivement à tous les contre-pouvoirs qui se dressent sur leur chemin (des tribunaux indépendants à la presse libre en passant par les banques centrales), ultime tentatives de dissimuler leur crainte de devoir, eux aussi, rendre de comptes » (p. 152-153) ?
La seconde est qu’à rebours des promesses de la campagne présidentielle de 2017 de changement des pratiques et doctrines politiques, nous sommes gouvernés aujourd’hui au moins autant qu’hier par des amateurs sans mémoire et sans éthique de responsabilité, qui en tant que tels sont dangereux car ils préparent inéluctablement le terrain à pire encore.
À la fin de l’introduction (p. 20) de leur livre, les deux auteurs écrivent « notre espoir secret, c’est qu’il vous incitera, vous aussi, à participer à ce grand combat qu’est redevenue la politique ». Sur ce terrain, ils peuvent être partiellement satisfaits : lecture faite, l’auteur de ce billet aspire plus encore qu’hier à soutenir (sinon à participer à) tous – tous – les combats politiques, pourvus toutefois qu’ils soient dirigés contre ceux qui se réclament du « progressisme » version Amiel-Emelien.
