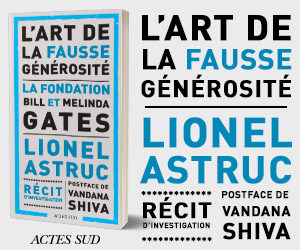Pour une éthique du professeur
La première vertu éthique du professeur est sans aucun doute la vertu de justice parce qu’elle est reconnaissance des droits et des mérites. Il faut envisager la justice selon deux perspectives distinctes car le professeur peut se rapporter à l’élève de deux manières différentes. Tout d’abord, il se rapporte à l’élève en tant qu’il est un sujet de droits. Il y a des droits de l’enfant, il y a maintenant des droits de l’élève. Or, en tant qu’il se rapporte à des sujets de droits, le maître juste respecte les textes, il n’est pas au-dessus du droit.
Ce n’est pas du formalisme mais l’assurance donnée que tous les élèves seront traités de la même manière, dans le respect de leurs prérogatives, même quand ils seront sanctionnés. Car il arrive parfois que les élèves fassent des bêtises. Être juste, c’est déjà respecter la légalité. Or, l’enseignant ne s’adresse pas seulement à des élèves-sujets de droits qui, saisis sous cet angle, se ressemblent les uns les autres. Nous ne saurions en effet distinguer un sujet de droits d’un autre sujet de droits.
Il s’adresse aussi à des sujets apprenants qui, appréhendés cette fois sous le prisme de leurs capacités, apparaissent très différents les uns des autres. Sujets qui n’ont pas les mêmes motivations, les mêmes désirs et envies de réussir, sujets qui n’ont pas eu les mêmes chances et les mêmes soutiens. Cette différence – qui est celle du rapport social et épistémique au savoir – l’école ne saurait y être indifférente. En tant qu’il s’adresse à des élèves qui sont des sujets apprenants très différents les uns des autres, le maître juste sait aussi faire vivre la dialectique de l’égalité et de l’inégalité. Égalité dans les attentes et les visées car tous les élèves sont conviés à réussir. Inégalité dans les moyens mis en œuvre, les soutiens, les appuis, les étayages ; inégalité dans l’accompagnement au nom de difficultés d’apprentissage, certes contingentes, mais bien réelles.
La justice ne se manifeste donc pas dans le