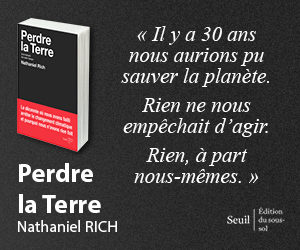Vincent Lambert et le (trop grand) prix du passage
Depuis plusieurs jours, la situation de Vincent Lambert a envahi l’espace médiatique. Cela tient au fait que des militants issus de la droite réactionnaire chrétienne se sont mobilisés jusque devant le parvis du CHU de Reims où Vincent Lambert se trouve pris en charge pour contester l’arrêt de son alimentation et de son hydratation. Sa situation n’a pourtant rien d’inédit ni d’unique en France, mais dans cette affaire la légalité d’une décision entraînant le décès a été mis en doute de 2014 à 2019 devant la justice. L’arrêt des soins a été décidé dès 2013 par l’équipe médicale, en concertation avec son épouse. Ensuite seulement, cette décision a été constamment mise en cause par la saisie de juridictions nationales, européenne et internationale, par les avocats des parents et de deux de ses frères et sœurs.
Si cette affaire laisse, spontanément, la plupart d’entre nous dans une incertitude politique et morale, c’est, d’une part, parce que nous ne voyons pas pourquoi une décision médicale ne devrait pas être contrôlée et faire l’objet de débats à l’encontre de médecins. C’est, d’autre part, parce que l’état végétatif dans lequel se trouve Vincent Lambert ne permet pas de trancher immédiatement sur la conduite qu’il convient d’adopter à son égard. Il trouble nos conceptions usuelles d’une personne humaine autonome. C’est, enfin, parce que la souffrance d’une famille face à la mort d’un proche nous laisse rarement indifférents. Néanmoins, pour l’ensemble de ces raisons, un regard plus distancié s’impose sur cette affaire.
Un individu ne peut être désigné comme mort que lorsque sa communauté s’accorde à lui attribuer ce statut et entreprend des rites funéraires.
L’anthropologie des « rites de passage » (en référence à la notion forgée par Arnold Van Gennep) a depuis longtemps étudié ces franchissements d’un état à un autre. Il s’agit d’une expérience collective au travers de laquelle les pratiques adoptées envers un individu et son statut social viennent à être transformés. Passer une frontière a donc toujours un prix. Ce passage consiste d’abord en l’évaluation de l’état d’une relation sociale puis en sa transformation réelle. Cela vaut également pour la frontière vie/mort. Dans de nombreuses sociétés humaines, un individu ne peut être désigné comme mort que lorsque sa communauté s’accorde à lui attribuer ce statut et entreprend des rites funéraires à son égard. Il arrive régulièrement que des désaccords éclatent puisque le rite est une cérémonie publique dans laquelle les membres de la communauté peuvent être pris à partie. Se constituer en gardien de la vie et de la mort d’un individu est une responsabilité donnée à certain. e. s que d’autres peuvent venir contester.
En France, jusqu’à récemment, c’est aux médecins que revenait cette responsabilité jusqu’à ce que la gestion médicalisée de la fin de la vie ait été dénoncée comme insuffisamment publique et insuffisamment partagée entre différents types d’acteurs, notamment avec les familles. Dans les années 1970, l’historien Philippe Ariès regrettait que les proches et les Églises aient été dépossédés de la gestion de la mort alors que celle-ci constituait un « spectacle public » dans lequel ils jouaient un rôle majeur avant le XIXe siècle. Son constat précède les critiques qui émergent dans les années 1980 à l’encontre de l’autorité médicale au motif qu’elle décide seule de la mort des patients et procède à ce qui est qualifié d’acharnement thérapeutique.
Ce fut ensuite au tour de Norbert Elias de s’indigner, quant à lui, de la « solitude des mourants » dans l’espace de travail de la médecine. Pour ce sociologue et cet historien, les familles n’entourent pas suffisamment leurs proches au moment de leur décès en raison de la relégation de la mort dans les hôpitaux et du peu d’éducation que les individus reçoivent pour surmonter celui-ci dès l’enfance. Norbert Elias s’indigne du fait que les mourants sont traités avec peu d’affection dans le contexte institutionnel de la médecine et invite à ce que les proches soient davantage initiés à la gestion d’un tel événement, ce qui permettrait qu’ils y prennent part plus spontanément, sans contraindre leurs émotions.
C’est à la suite de ces débats que les familles ont acquis une place plus importante dans la gestion des décès hospitaliers. Elles ont finalement obtenu le droit d’être davantage présentes au côté du patient, en particulier dans les services de réanimation, de soins palliatifs et dans les chambres mortuaires hospitalières. Depuis 2005, le patient a la possibilité de rédiger des directives anticipées et de choisir une personne de confiance susceptible de se faire l’écho de sa volonté dans l’engagement de décisions médicales lorsqu’il n’est plus en capacité de s’exprimer.
Grâce à cette conquête historique, la délégation médicale de la mort n’est pas complètement aveugle. Elle tend au contraire à être davantage contrôlée et discutée par tous ceux qui entourent le patient au moment de son décès. Elle a également conduit à une plus grande collégialité dans la prise de décisions irréversibles à l’intérieur des services médicaux, notamment dans l’obligation faite aux équipes de soins, depuis 2016, de consulter la personne de confiance choisie par le patient et d’avertir les proches de l’application de gestes entraînant la mort.
Vincent Lambert n’est plus pris dans une controverse technique et médicale. Il se trouve pris dans une épreuve en justice et dans une épreuve publique.
Le cas « Vincent Lambert » survient à la suite de ces évolutions. Alors que dans les années 1980, c’est la toute-puissance de la médecine qui se trouve ébranlée, c’est au contraire le désaccord entre proches qui suscite aujourd’hui une affaire publique pour décider de la vie ou de la mort individuelle du patient. Une partie de la famille conteste la décision médicale et la dénonce comme une atteinte à la possibilité de vivre de Vincent Lambert, tandis qu’une autre partie de la famille et l’équipe médicale établissent le refus d’arrêter les traitements comme une forme d’acharnement thérapeutique et d’obstination déraisonnable. Ce refus s’appliquerait contre la volonté du patient de ne pas vivre irréversiblement dans cet état.
Une telle affaire n’aurait pu survenir avant ces transformations. À l’heure actuelle, Vincent Lambert n’est plus pris dans une controverse technique et médicale. Il se trouve pris dans une épreuve en justice et dans une épreuve publique. Si les réactions sont si vives et si elles atteignent un si haut degré de publicité, c’est aussi parce que le « public » est désormais sommé de se positionner. À ce dernier niveau d’épreuve, on est en droit de se demander comment ses parents, deux de ses frères et sœurs et quelques militants ont réussi à imposer un cadrage de la situation comme le résultat d’un abus de la médecine et d’un scandale humain.
Il devient nécessaire de relever l’ambiguïté qui s’immisce maintenant dans les débats. Ce qui est en train de se jouer est-il la défense du droit de la personne ou la promotion d’un projet politique prônant la subordination de l’individu à la famille ? La vie de Vincent Lambert a été constituée en un problème autonome, en partie déconnecté des expertises techniques et médicales qui servaient à l’évaluer et de l’enquête menée sur sa propre volonté.
Ce coup de force tient, d’abord, à la réussite de la conversion d’une épreuve médicale en une épreuve en justice puis en une épreuve publique, qui entraîne la mise en équivalence de différents types de jugements — médicaux, techniques, relationnels, familiaux et religieux — dans les médias. Ainsi, la mobilisation d’une partie de ses proches et de militants de la droite chrétienne réactionnaire est parvenue à interpeller l’opinion publique jusqu’au chef de l’État lui-même. Ces derniers ont proposé une lecture de la situation de Vincent Lambert comme le résultat d’une erreur médicale et du non-respect de la volonté du patient à « continuer de vivre » quand bien même la décision d’arrêt des traitements a été réévaluée et légalisée à quatre reprises.
Dans le combat que livrent les parents de Vincent Lambert, le fait qu’ils se soient appuyés sur des militants réactionnaires et ultra-catholiques peut laisser penser que ce qui est en jeu à travers leur lutte, c’est une volonté de subordonner la vie individuelle de Vincent Lambert au pouvoir des familles et des communautés spirituelles au motif que ces vies individuelles en feraient partie. Cela se voit notamment au fait que les parents excluent d’emblée que Vincent Lambert, concernant sa propre mort, ait pu vouloir autre chose qu’eux et qu’il ait pu penser à ce sujet autrement qu’eux. Sur ce point, les vidéos diffusées sur le site Valeurs actuelles ne constituent pas, dans l’institution judiciaire, une preuve valable d’une volonté de Vincent Lambert à vivre pour les nombreuses années à venir, à même de contrebalancer celles apportées par des médecins, son épouse et toute une autre partie de sa famille depuis plus de cinq ans.
Il ne faut donc pas se méprendre : le but de la participation des familles au processus de définition du traitement du patient dans l’hôpital vise à servir la défense du droit de la personne et non pas à remplacer l’emprise du médecin par celle de la famille (ou de quiconque) sur les patients. Il ne s’agit pas de remplacer l’ancienne toute-puissance des médecins par une nouvelle subordination de la personne à son environnement familial ou religieux.
En d’autres termes, le droit des proches à participer à la gestion de la mort à l’hôpital ne vise pas le rejet de la délégation médicale en tant que telle, ce qui reviendrait à dénier toute compétence professionnelle et déontologique au corps médical. La participation des proches à la gestion de la mort dans l’hôpital est un mouvement pour aller plus loin dans le projet d’une médecine plus démocratique, c’est-à-dire plus contrôlée et plus discutée, et non pour refuser de déléguer. Cela constituerait bien davantage un recul sur les progrès démocratiques acquis que confier le sort des patients entre les seules mains de leurs proches et d’une communauté religieuse.
Il est donc souhaitable que la mort des patients soit politisée, puisqu’elle n’appartient pas seulement aux médecins, mais cette politisation ne doit pas conduire à l’oubli du droit de la personne en tant que valeur centrale. C’est le droit des patients qui peut nous servir à juger de cette affaire. En repartant de cette valeur cardinale, on sort d’un cadrage du cas Vincent Lambert comme celui d’un « scandale humain » ou d’une « hégémonie de l’expertise médicale » pour le considérer à l’aune de tous les autres cas : comme une situation dans laquelle Vincent Lambert devrait être traité en personne en application de ses droits.
L’État en charge de contrôler la médecine comme l’action des familles faillit s’il n’empêche pas ces deux formes possibles de subordination. Car ce que nous sommes légitimement en droit de lui demander, c’est de garantir nos libertés individuelles (nos droits en tant que personne) à l’encontre parfois du choix de nos proches et de médecins. À travers la subordination du destin de Vincent Lambert au choix de ses parents, de deux de ses frères et sœurs et d’une communauté spirituelle, c’est finalement notre propre liberté qui est remise en cause.
Cessons de subordonner la vie et la mort individuelles des patients à d’autres qu’eux, traitons-les en personnes. Traiter Vincent Lambert en personne, c’est faire valoir le fait qu’en dépit de l’incertitude irréversible qui existe désormais sur sa volonté actuelle, ce patient a des droits qui peuvent, sous contrôle de leur bonne application, lui être garantis.