Un chalutier à la biennale de Venise, la vraie histoire
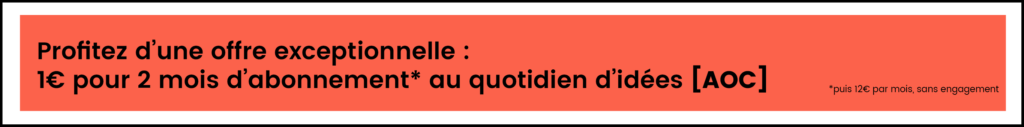
Quelle image me reste-t-il de ces deux jours passés avec le chalutier bleu, assise à la terrasse face à l’épave (quelle idée de l’avoir installée à cet endroit, très précisément, de tous les endroits possibles le long de ce quai) ?
Quelle image me reste-t-il après deux jours à observer, incrédule d’abord, épuisée ensuite, ce bateau qui depuis trois ans me mène dans les endroits les plus improbables, dans la cantine d’une base militaire de l’OTAN en Sicile, au sous-sol d’une morgue à Milan, dans un bureau de la Croix-Rouge internationale à Athènes, un autre au ministère de l’Intérieur à Rome, dans le salon d’un passeur à Agadez, le 4×4 d’une cheffe de mission de l’Union européenne à Niamey, dans le studio d’un photographe à Missirah, sous un auvent en paille dans le même village, un autre en dur quelques centaines de mètres plus loin, un troisième, puis un quatrième auvent, un cinquième, un sixième, un septième, à Kothiary, à Macacolibantang, ce bateau qui m’a amenée chez Ibrahima qui l’avait vu partir, désespéré de ne pas avoir pu monter à bord, qui m’a mise face aux parents de Mamadou Seydou, de Vieux, de Papa, de Bady, de Bourama, morts dans ce même bateau, et face aux parents de Mahamadou et d’Abou, morts dans d’autres bateaux, parce que celui-ci n’est qu’un parmi des centaines, des milliers, qui sombrent dans la Méditerranée, ce bateau-là qui pour moi est rempli d’histoires et de vie, et qui ici est vide et silencieux, sans aucun cartel ni légende, sans aucune explication, sans autre contexte que celui d’une biennale d’art contemporain, quelle image me reste-t-il donc ?
J’hésite.
Serait-ce celle des enfants d’une maternelle vénitienne en sortie scolaire, en rang deux par deux, avec de petits sacs à dos à l’effigie des héros de dessins animés, la Reine de neiges, Cars et Mickey à la queue-leu-leu, carton de l’école autour du cou, et sur la tête un bandana, rouge, orange, vert ou jaune, cortège joyeusement coloré qui déambule le long du quai, on mange quand maîtr
