Phobie de l’État et amour de l’entreprise
Derrière le conflit surmédiatisé Macron-Le Pen opposant progressisme et populisme – ou pour reprendre une formule de Nancy Fraser, « libéralisme progressiste contre populisme réactionnaire » – se joue un autre affrontement qui éclaire l’affaissement électoral de grands partis de droite et de gauche, constaté lors des élections européennes. Il a pour enjeu la relation symbolique entre deux institutions majeures, l’État et l’Entreprise. Au moment où la « phobie d’État » et du politique atteint son apogée dans l’opinion, il semble judicieux, de droite à gauche, de déclarer son « amour de l’entreprise », comme avait su le faire Manuel Valls alors Premier ministre, à l’Université d’été du MEDEF en 2014. Tout se passe comme si la critique de l’État appelait la célébration de l’Entreprise.
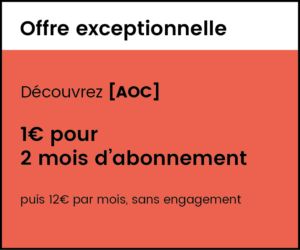
La « grande phobie de l’État », formule de Michel Foucault, a débuté vers 1750, concomitamment aux libéralismes, à la naissance de l’économie politique et à la volonté de limiter l’État absolutiste. Cette phobie a été renforcée au XIXe siècle, par les divers socialismes et anarchismes et a fini par laminer la puissance culturelle et symbolique des États-nations au XXe siècle après les deux guerres mondiales. Désormais, au-delà des visions néo-libérales ou socio-démocrates, un temps politique nouveau semble s’imposer, celui de l’hybridation « État-Entreprise » . Emmanuel Macron l’incarne : il en est une des figures symboliques à l’instar de quelques personnages politiques contemporains, comme Berlusconi qui inaugura la figure du « Président-Entrepreneur » au début des années 1990 ou le Président Trump qui a transféré sa marque de la « Trump Tower » à la Maison Blanche.
Pour dépasser le clivage droite-gauche, Emmanuel Macron combine la doctrine néo-managériale qui se prétend universelle et a-politique avec la vision moderniste de la « troisième voie et du nouveau centre ». Sa démarche politique est paradoxalement antipolitique : il s’agit d’une politique de dépolitisation, destinée à répondre à la crise majeure de la représentation politique (puisque l’opinion est majoritairement devenue « anti »-politique, autant la suivre).
Sa campagne électorale européenne (comme déjà sa campagne présidentielle) s’est inspirée du « Manifeste Blair-Schröder », texte fondateur de 1999 intitulé pour une « politique de la Troisième Voie et du Nouveau Centre ». Dans ce Manifeste européen et social-démocrate était affirmé que « Pour être efficace, la nouvelle politique doit promouvoir une mentalité dynamique et un nouvel esprit d’entreprise à tous les niveaux de la société. Cela nécessite (…) une société qui célèbre les mérites des chefs d’entreprise performants ». Or l’efficacité, la performance et le pragmatisme sont les maîtres-mot du discours d’Emmanuel Macron. Il a ainsi siphonné les courants qui célèbrent en commun l’« amour de l’entreprise ».
Cet « amour de l’entreprise » est devenu – à l’instar de « l’amour de la patrie » dans d’autres circonstances – l’enjeu d’une conflictualité « hégémonique » au sens gramscien du terme. C’est à l’articulation de la « phobie d’État » et de « l’amour de l’Entreprise » que s’est formé « le macronisme ». Désormais le contrepoint implicite de la critique de l’État-Nation est l’éloge de l’Entreprise. Le slogan macronien de la « Nation start-up » signifie que la Nation et l’État-Nation, évidés de leur dimension symbolique, sont assimilables à une Entreprise. Devant le Congrès réuni à Versailles, le Président Macron déclarait en juillet 2018, conduire « une politique pour les entreprises » et précisait, « une politique pour les entreprises… c’est une politique pour toute la nation ».
Durant la campagne électorale présidentielle, le thème de l’efficacité avait été martelé par le candidat Macron.
Emmanuel Macron a toujours circulé entre deux sphères, celle de l’État et celle de l’Entreprise. Il dit agir « au nom de l’efficacité » et du pragmatisme, conformément à la logique managériale. Il s’affirme comme chef de la Nation-Entreprise et dispose d’une « science du chef » acquise à l’ENA et à l’Inspection des Finances. Ce grand corps, une exception française, est le lieu idéal des échanges entre l’État et les entreprises, entre la haute fonction publique et les milieux d’affaires, entre privé et public, entre industrie, finances et Ministère de l’Économie.
Le modèle de la « modernité » destiné à renouveler le politique et l’État en crise serait l’Entreprise et la technologisation, soit le management + la numérisation. Cette variante de l’anti-politique en politique renvoie l’État, les partis, les idéologies, voire les élus, à « l’ancien monde » posés comme opposés au « nouveau monde » innovant des techno-entrepreneurs de la Silicon Valley, qu’il s’agisse des start-up ou des GAFAM.
Durant la campagne électorale présidentielle, le thème de l’efficacité avait été martelé par le candidat Macron. Ainsi dans un discours à Bercy, il présentait « l’efficacité » comme la finalité de la « véritable alternance ». Et dans son ouvrage programmatique Révolution, il écrit, « Si nous voulons que la politique serve de nouveau les Français, il faut s’atteler à la rendre efficace ». Il oppose même l’action efficace caractérisant « le nouveau monde » au débat public et parlementaire constitutif du « vieux monde » politique : « être efficace, résume-t-il, c’est en finir avec le bavardage législatif ».
Faut-il rappeler que l’efficacité est la valeur cardinale du management depuis la révolution taylorienne fondée sur le « gospel of efficiency » ? L’efficacité est aussi le critère du fonctionnalisme et de l’ingénierie : « ça marche » caractérise le fonctionnement d’une machine. Le discours de l’efficacité de l’action réduit le politique à la gestion et à l’expertise. Cet aplatissement du politique sur l’administration et l’action efficace est caractéristique des grands corps techniques, qui en France, sont les maîtres de l’ingénierie étatique. L’expertise techno-entrepreneuriale porterait la garantie de l’efficacité au nom de l’objectivité scientifique, au-delà de tout débat public, parlementaire et politique. Cette légitimité techno-rationnelle est incarnée par une « élite des élites ». Le leader politique trouve en l’espèce, la reconnaissance dans sa « légitimité rationnelle » (Max Weber), celle de son savoir, de ses diplômes, de ses compétences et de son savoir-faire. Il dirige un « gouvernement des meilleurs » – idée de François Guizot, reprise par Mendès-France et Rocard, deux mentors de Macron – pour définir le bien commun au nom de la techno-rationalité.
La « démocratie des meilleurs » livre une vision élitiste de la représentation que Guizot qualifie d’« aristocratie de la vérité », car le savoir devient le fondement de la représentation. L’expertise techno-rationnelle se dresse contre la dimension symbolique constitutive du politique et désarme par avance toute contestation sociale fondée sur l’éthos, voire sur l’expression populaire assimilée à l’ignorance et au populisme. La « démocratie élitaire » est une forme de l’anti-politique fondée sur un savoir technocratique capable de rendre la société la plus efficace possible, de réduire ce qui perturbe son fonctionnement et de la fluidifier pour « optimiser » sa performance. Ainsi l’idéologie gestionnaire et managériale dépolitise le politique en le technicisant au profit des « experts », des technocrates et des manageurs. Si la politique est réduite à la gestion et à l’administration des hommes, le gouvernement se fait simple « gouvernance ».
Emmanuel Macron défend « en même temps » l’État et l’Entreprise car il veut être la figure symbolique de leur fusion et de leur confusion, donc de leur réversibilité.
Comme l’avait prophétisé James Burnham dans The Managerial Revolution en 1941, le techno-managérialisme devrait s’imposer au-delà des « vieux clivages » gauche/droite, socialisme/capitalisme, public/privé, etc. Il permet au leader politique de se positionner au-delà, ou « en même temps », dans la « post-politique », comme l’a défendu Anthony Giddens, le sociologue conseiller de Tony Blair, dans un de ses ouvrages intitulé Beyond Left and Right, proposant une variante sociale-démocrate du néolibéralisme. Le premier ministre britannique la résuma ainsi lors d’un discours devant l’Assemblée nationale française en mars 1998 : « La gestion de l’économie n’est ni de gauche ni de droite. Elle est bonne ou mauvaise. Ce qui compte, c’est ce qui marche ».
À sa suite, Emmanuel Macron défend « en même temps » l’État et l’Entreprise car il veut être la figure symbolique de leur fusion et de leur confusion, donc de leur réversibilité. « Ce qui marche » (dans l’Entreprise) est « en marche » (dans l’État) … En 2017, il lance à VivaTech à Paris, « Entrepreneur is the new France », à l’Hôtel de Ville de Paris, il appelle à « créer de la valeur », puis dans son discours à Cayenne en octobre, il demande aux préfets : « J’attends de vous que vous soyez des entrepreneurs de l’État ».
Emmanuel Macron emprunte le vocabulaire, les codes et les normes du management pour occuper l’espace du politique rabattu sur la gestion et apparaître comme un « homme nouveau », antipolitique en politique, un « libéral révolutionnaire ». Au discours « horizontal » sur l’action et la gestion efficaces, il superpose toutefois une image de verticalité qualifiée de « jupitérienne » à prétention symbolique, car le management ne peut suffire sans associer aux « bonnes pratiques » des « valeurs » ou des « principes » censés les inspirer.
Trois couples de notions structurent le récit et l’imaginaire macroniens : immobilité/mobilité (de la société), défiance/confiance (dans les chefs), et inefficacité/efficacité (des institutions). On peut les résumer dans l’équation suivante qui définit la « marque Macron » : mobilité (« en marche ») = modernité = mondialisation = dynamique = aventure = risque = jeunesse = innovation = start up = entreprise = management = efficacité (« ça marche »). L’imaginaire étant toujours ambivalent (dire le Paradis, c’est convoquer l’Enfer), cette équation évoque en creux son inverse (immobilité =… etc.).
La marque « En Marche » désigne la mobilité et l’action efficace de l’entreprise, et révèle en creux, son inverse, l’immobilité et l’inefficacité de l’État (du latin status), organisé avec et par des « statuts ».
Le postulat de départ est l’idée de « société bloquée », terme introduit par Stanley Hoffman, professeur à Harvard, dans son ouvrage À la recherche de la France (1963) et vulgarisé dans les années 1970 par Michel Crozier qui, analysant mai 68, critiquait les élites. Cette antienne, voire ce mythe conservateur de la « société bloquée », mais renversé au profit des élites, est fondateur du récit macronien : « notre société affirme Emmanuel Macron, est l’une des plus immobiles. L’absence de mobilité sociale nourrit la défiance », donc « le cœur de la politique doit être l’accès. L’accès à la mobilité, notamment ». La cause du blocage n’est plus dans les élites devenues hypermobiles avec la mondialisation, mais, affirme-t-il, « les principaux blocages de notre société viennent des corporatismes, des corps intermédiaires et du système politique ». La crise et la défiance politique trouvent leur cause dans cette immobilité due au « système » et à ses acteurs : partis, syndicats, statuts, corporatismes, etc. Ce raisonnement est basé sur un axiome, voire un truisme : tout est mouvement, toute société bouge, donc il faut tout bouger pour que tout reste pareil, selon la célèbre formule de Tomasi di Lampedusa. Toute révolution-restauration doit s’opérer dans et par le « bougisme ».
Érigée en valeur caractéristique d’une surmodernité, « liquide », comme dit le sociologue Zygmunt Bauman, la mobilité serait devenue un nouveau paradigme de nos sociétés. À l’aide de cette métaphore, Emmanuel Macron a fait adopter plusieurs lois sur les mobilités et a construit un récit binaire opposant la « société bloquée » à celle de « la mobilité » et « du risque » (Ulrich Beck) : « Un de nos défis, dit-il, est de passer d’une société de statuts à une société de la mobilité » ; « Il faut adapter la France pour qu’elle soit plus forte dans un monde qui bouge » ; « il faut admettre que nous sommes dans une société du risque ». Afin de « doper l’esprit d’entreprendre », il convient de transformer l’État : « Dans la vie économique, l’État norme trop. Je crois qu’il est légitime, dans certains secteurs, de réfléchir à moins d’État, car il est plus efficace et juste de laisser la société respirer ».
La marque « En Marche » désigne la mobilité et l’action efficace de l’entreprise, et révèle en creux, son inverse, l’immobilité et l’inefficacité de l’État (du latin status), organisé avec et par des « statuts ». Le mot « efficacité » est un talisman corrosif de toute politique soumise au critère de son utilité et de performance. « Il faut savoir ce qui marche », répète le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner qui ajoute « Il faut, se poser une seule question : est-ce que c’est efficace ? » … La réponse au « comment faire » dépolitise la politique, délestée de la question du « pourquoi » et du sens qu’elle est censée apporter pour faire tenir une société, au profit de la seule finalité pragmatique, à savoir « est-ce que ça marche » ou pas.
Emmanuel Macron, à l’instar d’autres « Présidents-entrepreneurs » incarne ainsi une des figures pionnières de l’État-Entreprise. En cela il accompagne l’hyper-industrialisation et l’extension de la révolution néo-managériale à toute la société, par un transfert d’hégémonie culturelle de la très grande Entreprise, institution puissante de la religion industrielle, vers l’État, institution affaiblie de la religion politique.
NDLR : Pierre Musso vient de publier Le temps de l’Etat-Entreprise. Berlusconi, Trump, Macron aux éditions Fayard.
