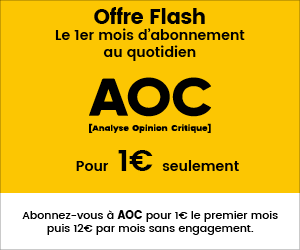Le malaise ordinaire des professeurs des écoles
Le suicide de Christine Renon, survenu à la rentrée scolaire de 2019, a permis de mettre au jour les conditions de travail devenues ahurissantes des professeurs des écoles. Il est toujours facile d’imputer de tels drames aux « problèmes personnels » des individus. Pourtant, ces drames ne sont que les révélateurs de situations de détresse et d’épuisement beaucoup plus ordinaires, que plusieurs enquêtes récentes documentent.
Les démissions des professeurs des écoles qui augmentent, ainsi que la faible attractivité de la profession, qui oblige certaines académies à recruter à un niveau très bas, sont des indicateurs de l’insatisfaction généralisée à l’égard des conditions de travail qui se dégradent toujours plus.
Certes, pour la plupart d’entre eux, les professeurs des écoles disent aimer leur métier, en tous cas ce qu’ils considèrent comme le cœur de ce métier. Mais ils en sont de plus en plus détournés par toutes sortes d’obligations, de contraintes et de missions qui en s’accumulant, font basculer, parfois dangereusement, les équilibres entre souffrance et bonheur au travail, vie professionnelle et vie personnelle.
Le sentiment d’un manque de reconnaissance de l’Institution apparaît à travers toutes les enquêtes. Les enseignants eux-mêmes rient (jaune) d’une institution qui ne cesse de prôner à l’égard des élèves la bienveillance qu’elle leur refuse, ne serait-ce que par le rythme effréné des réformes qui ne permettent jamais d’améliorer l’existant et déstabilisent sans cesse les pratiques.
Depuis la fin des années 1990, les réformes se succèdent au gré des changements de ministres, qui désorganisent toujours plus le travail sans apporter d’amélioration aux inégalités d’apprentissage liées à l’origine sociale.
Tout se passe comme s’il ne s’agissait de la part des différents ministres que de « donner à voir » des changements qui, certes, mobilisent une grande énergie, mais sans bénéfice ni pour les enseignants ni pour les élèves : loi d’orientation qui im