Universitaires, la fin de l’indépendance ?
Le projet de Loi de Programmation Pluriannuelle pour la Recherche (LPPR), annoncée pour le printemps 2020, suscite de très vives contestations dans le monde universitaire. Son inspiration clairement « néolibérale » est critiquée. Elle est perçue comme visant un renforcement du mode concurrentiel d’exercice de la recherche « sur projets », que ne supportent plus les chercheur·e·s à l’Université et dans les grands organismes de recherche (type CNRS), au bout d’environ vingt ans de mise en place croissante.
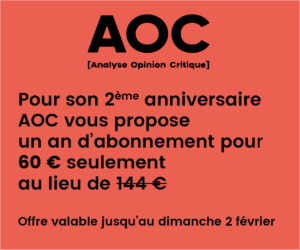
Elle appliquerait même cette mise en compétition aux universitaires dont les missions et rémunérations dépendraient de leurs « performances » à court terme. Elle prévoit également des embauches sous contrats privés en contournant le système de validation paritaire des universitaires par les universitaires. Elle renforce ainsi un « management » de la recherche et des chercheur·e·s, façon entreprise privée à but lucratif, appelé « pilotage stratégique », qui est en opposition avec le statut protégé d’indépendance académique et de service public des universitaires.
Les universitaires[1] sont en effet des fonctionnaires d’État à statut particulier. Cette indépendance est fondée sur la nécessité impérative d’indépendance et de liberté de production des connaissances scientifiques (par la recherche), de la diffusion de ces connaissances (par l’enseignement et les publications), des modalités de ces missions (auto-organisation), qui doivent être protégées des censures ou instrumentalisations politiques, économiques, religieuses, etc. Cette indépendance s’inscrit dans une longue tradition de « franchises universitaires » et de « libertés académiques », mises en place dès le Moyen-Âge (protection par le Pape de La Sorbonne contre le pouvoir temporel en 1229). Émile Durkheim le rappelait en 1918[2]. Ce statut particulier était déjà inscrit dans la loi Faure de novembre 1968 et il a été confirmé par le Conseil d’État dans une décision de 1975.
Ce statut est défini, aujourd
