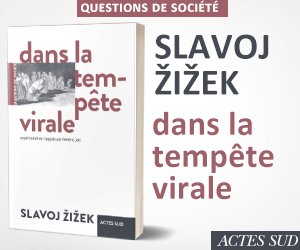Revenir au monde à l’heure de l’époché sanitaire
La pandémie et ses conséquences inédites en santé publique nous imposent de pratiquer une action symbolique, une véritable suspension du monde qui nous plonge activement dans cette attitude de doute radical que les philosophes grecs appelaient l’époché.
Sous ce nom le philosophe allemand Husserl faisait aussi référence à sa méthode, appelée « réduction phénoménologique ». Cette méthode consiste à suspendre tout ce que l’on croit savoir (théories, réalité, résultats d’expériences, protocoles, mais aussi par exemple ce que nous avons coutume d’appeler le moi ou la personnalité) sans préjuger de son existence dans le monde réel, et à observer ce qui reste intact après cette suspension.
Cette attitude, qui peut conduire jusqu’à la suspension de la réalité du monde, ne peut évidemment pas être tenue longtemps. Observer la réalité qui revient au galop, comme mue par une force de rappel, est d’autant plus enrichissant pour l’observateur qu’il prend ainsi la mesure de ce qui jusqu’ici l’attachait au monde ambiant, monde qu’il vient de tenter de déconstruire et que malgré lui il reconstruit aussitôt. Cette méthode est, dans les suites de Descartes, une forme radicale de doute. Elle vise à suspendre toutes les théories, clichés et habitudes en cours, pour revenir aux choses elles-mêmes et les décrire telles qu’elles apparaissent (c’est ce que veut dire le mot grec « phénomène »), pour ainsi dire à l’état naissant.
Il est très étonnant de voir qu’aujourd’hui en France après les annonces à la veille du printemps du président de la République et de son Premier ministre et sous l’effet de l’épidémie, réalité majeure et prioritaire, presque tous les Français ont pratiqué sans le savoir une forme d’époché. Avec l’épidémie la réalité, la nature, les choses matérielles, notre corps, notre condition de mortels sont revenus au galop et se sont imposés à nous par une force de rappel que nous percevons comme surhumaine.
Il n’y a qu’en temps de guerre que s’effectuent ainsi des épochés collectivement instituées.
Nos gouvernants en continuant pour le bien commun à diriger le pays dans cette épreuve sont contraints d’imposer à tous et d’instituer dans l’urgence une forme d’époché sanitaire, philosophie sous le régime de laquelle nous devons accepter enfermement et couvre-feu face à la mort qui rôde. Ce moment est d’un point de vue philosophique unique car à la fois imposé par le réel et politiquement institué sur le plan de la méthode. Nous en avons vu les effets dans les rues et dans les bars l’espace d’une nuit, à Paris sur les berges de Seine, à Marseille sur la plage, partout dans les jours qui ont suivi dans les supermarchés, à l’hôpital où les soignants et les malades confrontés ensemble aux corps souffrants et à l’humain perçoivent la démesure devenir pire encore de cette tragédie.
Le dimanche quinze mars deux-mille-vingt à zéro heure, les plus visibles et les plus résistantes de nos conduites sociales, celles du travail au dehors et celles du divertissement, celles des gestes amicaux, bises, poignées de main, rassemblements et coups à boire, ont été suspendues par notre président. La raison sanitaire et le sens commun sont entrés pendant les premiers jours en conflit permanent : s’il est évident pour tous qu’une épidémie se répand par le contact avec les autres et qu’il faut donc le restreindre, être proches des autres est la seule conduite que nous percevons individuellement et affectivement comme salutaire.
Cette suspension momentanée du sens commun par la raison, annoncée solennellement à la télévision, est en soi un acte symbolique, un interdit. Il n’y a qu’en temps de guerre que s’effectuent ainsi des épochés collectivement instituées. Cet acte symbolique, performatif en ce sens que dire la chose s’accompagne immédiatement d’une action, institue pour chacun la nécessité temporaire d’un désengagement partiel du monde. Ce désengagement, même s’il répond aussi dans le même temps à un besoin de protection et un état d’urgence, nous est imposé en dépit de notre propre spontanéité. Nous sommes appelés à freiner notre élan vital tandis que nos pensées, notre corps et les choses qu’il fait siennes ne cessent de nous reconduire vers le monde.
Cette modification de la structure du monde vécu est assez proche de celle que l’on observe dans la crise d’angoisse, dans la dépression, ou même dans le travail du deuil.
Dans notre monde intime nous ne sommes évidemment pas d’accord avec une telle suspension du contact, un interdit qui plus est que déjà d’autres transgressent et que d’autres parviennent à tempérer en fonction de leurs priorités, avec souci, angoisse, émotion, bienfaisance et souvent même avec humour. C’est au fond le monde, tel que nous l’avons vécu jusqu’ici, qui par la menace qui pèse sur lui se trouve modifié dans sa structure même. Cette modification de la structure même du monde vécu est assez proche de celle que l’on observe dans la crise d’angoisse ou dans la dépression, ou dans le travail même du deuil.
Elle connaît par exemple plusieurs étapes qui s’entremêlent, la première étant celle du déni : cette triste réalité nous ne la voulons pas, nous désapprouvons jusqu’à son existence même, nous ne voulons pas que pour nous puisse cesser la fête. Nous sortirons quand même, prendrons ensemble le soleil, danserons et boirons jusqu’au petit matin. L’explosion dionysiaque qui accompagne le désaveu de la réalité épidémique ne doit pas nous choquer, elle est une première expression, aussi narcissique qu’égoïste, de notre humanité, dans la grande diversité de nos moyens et de nos caractères.
Viendront assez vite pour les moins résistants, ceux qui sont déjà touchés dans leur chair ou simplement les plus disciplinés, la tristesse, le découragement, le vécu de vide et d’abandon, la culpabilité, la colère. Et dans le même temps s’enchaîneront déjà avec plus ou moins de bonheur et d’élan les aménagements nouveaux, issu de la déception et de la perte assumées ensemble, et s’enrichissant de la perspective des temps nouveaux. Les plus philosophes d’entre nous anticipent qu’il s’agit déjà là d’un nouveau monde, de nouveaux intérêts, de nouvelles menaces, de nouvelles protections, bref : d’une autre vie, plus proche de soi, du présent vivant, des autres et du monde.
Sous l’effet de l’époché sanitaire nous nous plongeons dans le présent, vivons tout à la fois faute de mieux et en excès.
La vie confrontée dans l’instant même au vide de la mort reprend ses droits, elle bâtit sur l’abîme ouvert par l’anxiété originaire des ponts, des liens de proximité et de distance, des appels, des îlots, des villages, des villes que nous savons construites sur pilotis et des cités virtuelles, immensément plus larges et plus profondes qu’on ne l’avait pensé. Cette épidémie, comme un doute philosophique s’imposant dans la vie de tous les jours est à la fois une suspension du temps collectif et une suspension momentanée du temps intime, une suspension brutale des rythmes vitaux, un débrayage, une désynchronisation collective qui laisse apparaître pendant ce temps bref où nous ne sommes plus qu’en roues libres l’angoisse originaire de la mort. Vit tapie au fond de notre être la conscience intime de notre vulnérabilité. C’est par-dessus cette angoisse que nous ne cessons de construire et de jeter des ponts, que nous déployons autour de et devant nous la spatialité du monde, qui peut nous faire dans ces jours étranges de solitude l’effet d’une scène, où se joue continûment l’immédiateté du présent.
Sous l’effet de l’époché sanitaire nous nous plongeons d’ailleurs dans le présent, vivons étrangement tout à la fois faute de mieux et en excès, appelons nos amis sur nos mobiles, faisons des selfies, depuis là où nous nous trouvons enfermés tournons et distribuons dans un espace virtuel et sans point de repère géographique au-delà de nous-même de courtes saynètes, des vidéos pour faire rire, des souvenirs, des films. Enfermés nous nous jetons avec délice sur le ménage, le rangement, nos livres, nos produits ménagers, nos provisions de route. Le travail à la maison et la fermeture des écoles et des crèches nous permettent de retrouver, quand nous n’avons pas été séparés par la force des choses, nos parents et nos enfants.
Nous nous soucions plus et mieux des nôtres. Tout au moins le croyons-nous, car ici aussi le doute s’insinue rapidement. Mieux n’est pas vraiment le bon mot car nous nous apercevons dans le même mouvement que là où sont nos proches nous n’avons peut-être jamais, ou si peu de temps, vraiment été. Les questions sur la nature intersubjective même de ce présent que nous avons, infini, à nouveau devant nous affluent. Ceux qui comprennent brutalement qu’ils ont ainsi la chance de vivre, chance qu’ils mesurent et apprécient autrement, finissent tôt ou tard par chercher, réfléchir, penser, inventer, créer des métaphores et des modes nouveaux de synchronisation, un moyen renouvelé de vivre ensemble.
Si la volonté de divertissement résiste, faut-il vraiment s’en étonner ?
L’annonce des conséquences possiblement dramatiques de l’épidémie et des mesures immédiates pour y faire face, son expansion mondiale et directement visible, ont certes donné un coup d’arrêt à l’économie et à la vie de divertissement mais vont du même coup et pour longtemps, nous pouvons l’espérer, relancer l’élan vital. Il faut voir dans les réjouissances ultimes et égocentrées des uns et les gestes altruistes des autres le même élan vital originaire, celui de la résilience et du rétablissement, qui nous poussent continuellement à vivre le présent, au présent, en présence, à être là, ensemble, présents au monde et redécouvrant nos forces et nos ressources propres. Ceux qui le font probablement le mieux ont compris qu’il était vital de rester chez eux et font face à leur propre solitude en la réaménageant, écrivant, peignant, créant, filmant, jouant de la musique, communiquant et travaillant à distance, apportant à d’autres qu’eux-mêmes ce qu’ils ont su retrouver en eux-mêmes pour faire naître de la joie.
Nous redécouvrons à notre échelle et comme par miracle que les vécus s’enchaînent les uns aux autres en suivant l’ordre des choses, l’humeur, le rythme du monde et les priorités des gens. Si la volonté de divertissement résiste, faut-il vraiment s’en étonner ? Qu’est-ce qu’un roi sans divertissement, se demandait Pascal ? Que deviendrait le monde vécu s’il n’était plus que le royaume d’un moi qui ne connaît plus la fête ? Régneraient le désœuvrement, l’ennui, la solitude. Une infinité de formes de vie meurent en nous avec la perte du sens que nous permet la fantaisie. Qui se montre capable d’accepter l’ennui sans réticence ? Qui se montre capable d’accueillir philosophiquement l’angoisse et la mort sans se tromper un moment même bref par de l’agitation ? Que voyons-nous d’ores et déjà dans les rues ? Un curieux mélange de silence, ce temps suspendu qu’évoque à propos d’économie un journal au moment où j’écris, mais aussi un moment de ralentissement, de paix, de veille, de conscience du monde comme étant notre seule source.
Nous tenons notre aliénation à distance. Certains objets, comme les téléphones mobiles, prennent encore plus d’importance et nous voyons bien que le monde par eux s’accélère encore mais ils finissent par bugger. Apparaissent alors non pas le Monde seul, ni le Soi seul, mais dans une vérité pleine de silence la relation du soi au monde, dans la présence et la profondeur d’une résonance possible. Qu’est-ce donc que la fête si ce n’est pour nous tous à chaque moment le présent vivant, là où nous sommes.
Le présent, nous mesurons peu à peu ce qu’il est en ce qui résiste en lui comme étant essentiel à notre humanité.
L’être nous préoccupe autrement. Par cette forme étrange d’époché nous sommes contraints à réduire, à démonter et reconstruire à nouveau ce qui nous semblait aller de soi : se promener, sortir, travailler ou faire la fête, le tout dans une proportion qui après la désynchronisation de tous accorde à nouveau quand nous le pouvons notre propre rythme à celui du monde et des autres, plus ou moins proches ou lointains. En un sens, cette époché est une forme de réduction collective et salvatrice au monde des besoins, au corps propre et à ce qui l’entoure, son monde, sa maison, sa famille, une forme de réduction de la vie quotidienne à l’indispensable et au strictement nécessaire : nourriture, santé, maison, protection, sens, dignité, reconnaissance. Le présent, nous mesurons peu à peu ce qu’il est en ce qui résiste en lui comme étant essentiel à notre humanité.
Dans ce contexte il risque d’y avoir, il y a déjà, des laissés pour compte et nous n’avons pas fini de les compter. Les personnes sans domicile ni chez-soi ont faim, sont malades, rien ne change pour eux si ce n’est qu’ils meurent plus et ne rencontrent plus les personnes relais ou ressources qui parmi les derniers se souciaient encore d’eux. Les vieux dans les EHPAD que ne peuvent plus, quand elles le faisaient, visiter leurs familles et qui déjà eux aussi mouraient plus que les autres et souffrent de maltraitance. Les prisonniers, les migrants, les personnes affectées par un trouble mental, tous seuls et autour de qui la solidarité ne tardera pas à lâcher s’ils ne s’organisent pas eux-mêmes avec nous pour résister et continuer à lutter pour leur dignité. La question de la lutte pour la reconnaissance continue à se poser pour chacun sans répit.
Comment pouvons-nous, nous citoyens, sous l’effet d’un fléau changer tout en restant les mêmes – et devons-nous le faire ? Nous comprenons que la seule réponse positive est du domaine de l’éthique et de l’écologie. Nous sommes rattrapés par le monde qui dès que nous retrouvons nos forces propres nous reconduit à un monde plus proche, au sein duquel les mouvements de notre humeur, nos émotions, nous aident auprès des autres à bâtir une niche. Nous reconstruisons aussitôt et quand nous le pouvons un monde proche, depuis un îlot de résonance, quand nous parvenons à le trouver. Ce monde est alors plus profond car éclairé de cette rencontre conjointe, de ce croisement, du vivre et du mourir qui fait le rythme naturel de la vie et l’ordre mêlé du renouvellement et la permanence des choses.
Beaucoup d’entre nous ont eu un moment de manie ce dernier samedi, aucun n’était malade.
Le psychiatre que je suis a déjà depuis longtemps rencontré ces questions auprès des personnes qu’il soigne. Celles-ci ont déjà connu ces situations d’étrangement du monde que l’époché sanitaire nous impose à tous aujourd’hui. Nous pouvons apprendre beaucoup des personnes qui souffrent car elles ont aussi appris comment on se rétablit, lorsqu’on le peut, lorsqu’on le souhaite. Ces situations-limites, souvent intenables, et toujours critiques sont faites d’enfermement dans l’espace et dans le temps, de murs et d’échéances, comme le rappelle aujourd’hui le philosophe Hartmut Rosa, en se référant à la phénoménologie et à une conception écologique du cerveau, elles sont dans notre postmodernité tardive source de désynchronisations et de pathologies nouvelles.
Cette désynchronisation, à de multiples échelles du vivant, des mondes intimes et du monde social, du temps et de l’autre, de l’autre au dehors et de l’autre en nous-même, est génératrice de diverses formes de mélancolie, d’états-limites et de décompensations prenant la forme de pathologies connues comme le délire ou la schizophrénie. Le psychiatre japonais Kimura Bin comprend ces formes cliniques en questionnant la façon dont nous vivons le présent et sa conscience intime. Si le présent immédiat peut être pensé comme une fête, certains d’entre nous, dont nous disons parfois qu’ils sont touchés par la schizophrénie (le mot lui-même est très mal choisi et nous sommes nombreux à penser qu’il faudrait débaptiser cette pathologie) ne parviennent jamais tout à fait à y entrer, car y entrer suppose de pouvoir compter sur le sens commun et les évidences qui font la vie de tous les jours.
Ces personnes vivent comme beaucoup d’entre nous juste après l’époché sanitaire : plus rien n’est évident, il faut apprendre à reconstruire et pour cela entrer dans le présent autrement. Tous n’y réussissent pas. En se situant avant la fête, il est bien difficile d’adhérer à un ordre des choses que l’on trouve plein d’incertitudes et qui manque de naturel. Pendant la fête, au présent, vivent le mieux ceux qui savent vivre en s’exaltant. Certaines pathologies comme la manie (les psychiatres appellent ainsi depuis le dix-neuvième certaines formes aiguës des troubles bipolaires) sont vécues dans l’exaltation anticipée du présent immédiat, le saut par-dessus les obstacles, le tourbillon de la fête, la danse du monde. Beaucoup d’entre nous ont eu un moment de manie ce dernier samedi, aucun n’était malade.
Après la fête viennent toutes les formes cliniques de la dépression et du burnout. Nous ne pouvons plus vivre au présent, le malheur nous semble déjà là, nous ne l’anticipons plus comme nous l’avons fait jusqu’ici dans l’anxiété et le souci, le fléau de l’épidémie nous enferme dans la répétition du passé et nous pensons à la peste. Entre ces trois phases du présent vivant nous devons tenter de naviguer. L’horizon du soi et la chair du monde au-devant de nous-mêmes. Tous ces mots ne sont pas à prendre à la lettre mais illustrent comment ces trois périodes peuvent déterminer ce que nous vivons au présent sous le régime de l’époché sanitaire : le présent n’est ni avant, ni pendant, ni après la fête, mais dans la traversée que nous faisons de l’espace du monde en essayant de vivre ensemble, de nous synchroniser.
Nous sommes tous hésitants, malades ou bien portants, entre ces trois régimes sous l’effet de l’annonce. Et nous nous en tirons par l’humour, l’entraide, l’action auprès des proches et des malades, le soin, nous-mêmes et les autres entremêlés, nous soignant de la même manière, ces soignants que avons applaudi chaque soir à 20 heures pour nous synchroniser, engagés à nouveau dans la construction d’un monde commun dont nous savons déjà qu’il peut être meilleur si nous en prenons soin.