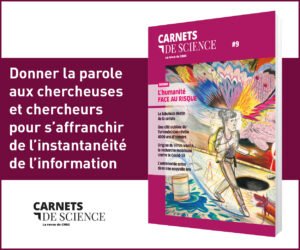Le Brésil est une hétérotopie
Le Brésil est isolé. Il se débat contre le feu, les morts, les assassinats, la faim, la misère croissante dans les rues et les violences policières. Déchiré entre des haines multiples et différentes : celles qui ne veulent que tuer, et les autres, écartelées entre douleur, désespoir et revendications politiques. Le Brésil est isolé. Retranché dans une zone à part du monde, le Brésil est une hétérotopie. Je relis ce texte, Les Hétérotopies (2009), de Michel Foucault, alors que je me trouve en plein dans ce cratère politique, trou béant et approfondi par un phénomène mondial, la pandémie. Je réalise alors que la seule façon de penser l’isolement du Brésil actuel c’est en le comprenant dans ses strates relationnelles.
En mettant en relation les différentes lignes spatio-temporelles qui dessinent l’amplitude et la profondeur hétérotopique de ce pays : depuis les corps violés des femmes esclaves aux corps noirs vivant de nos jours dans les favelas, depuis le sentiment d’infériorité qui marque l’emprise coloniale jusqu’à l’agressivité régnante des sociétés contemporaines, de l’esclavage au racisme, de la disparition de corps et des archives de la dictature civile et militaire jusqu’aux hommages rendus par le président Bolsonaro au pire des tortionnaires du pays, le Général Ustra, de la prétendue allégresse joviale du Brésil aux haines qui mettent le feu aux tropiques d’aujourd’hui.
Mais la difficulté à penser la singularité en relation indique la gravité de l’impact colonial sur une société. Dans le cas du Brésil il s’agit de comprendre pourquoi il est si difficile de dénoncer la manière dont le Brésil et dont nous, les Brésiliens, sommes historiquement déconsidérés hors du pays et dans notre propre pays.
Son grand territoire et le fait que ce soit le seul pays d’Amérique latine à parler le portugais ont également contribué à cet isolement. Parfois, l’immensité est un facteur de désorientation. Mais elle peut aussi être un facteur d’absorption. Pensons à des expériences au milieu de l’océan ou dans le désert. Rien n’est plus structurel et structurant que cette expérience et cette sensation d’isolement. Ce dernier s’apparente aujourd’hui à une longue agonie en raison de l’effondrement des institutions brésiliennes, produit aussi bien par le gouvernement actuel que par la pandémie en tant que telle. Dans un tel contexte, isoler c’est minimiser et diminuer tout ce qui appartient au Brésil et aux Brésiliens.
Par contre, penser le lieu en relation au monde obligerait le Brésil à être toujours plus ouvert sur le large et, en même temps, toujours plus précis sur ses conflits. En fait, le monde n’existe qu’en relation. Et, plus que jamais, nous sommes confrontés au fait que le Brésil ne participe plus au monde, et cela risque de durer.
Cette expérience de l’isolement (et les autres qui en découlent tels que la méconnaissance de soi-même et celle des autres au sujet du Brésil, l’imprécision qui en découle, ainsi que la plus grande estime et survalorisation de l’étranger) remonte à la structure coloniale du pays, là où isoler voulait dire conquérir, où délimiter signifiait faire la guerre et subjuguer, où le pouvoir équivalait à la force avec laquelle les territoires étaient isolés, et où isolés voulait dire conquis. L’imbrication entre pouvoir et conquête et la conquête en tant que domination constituent l’un des plus grands dommages de l’héritage viril (masculin et blanc) de l’Occident. Ce geste – ample et souvent sans restriction – est perpétré, dans une plus ou moins large mesure, par tous ceux qui, jusqu’à aujourd’hui, commandent ou décrivent ce pays. Je discuterai ce mouvement ici, en relisant et en décolonisant Foucault et, si nécessaire, en pensant avec lui, et contre lui.
Mais quelles sont les blessures béantes du Brésil ? L’esclavage, jamais guéri, fonde une société raciste dans toute sa structure.
Les Hétérotopies, texte de Michel Foucault, porte sur les espaces et les lieux. L’auteur s’intéresse par ailleurs à la formation de ce qu’il appelle des « contre-espaces ». Le contre-espace est déterminé par le pouvoir de construction de l’espace lui-même. Dans le cas des colonies, je dirais que l’hétérotopie – ou le contre-espace – est surdéterminée par la construction des espaces coloniaux. Raison pour laquelle ce texte de Foucault, comme beaucoup d’autres œuvres de ces auteurs blancs et européens qui nous ont formés, mériterait aujourd’hui qu’on le relise et qu’on le retravaille en s’efforçant de décoloniser sa pensée.
Le fait que nous ayons encore peur d’effectuer ce mouvement de lecture, malgré les changements dans le domaine de la connaissance, révèle notre propre condition de subordination, qui, à son tour, est la fille directe de l’isolement. Isolement spatial et mental qui dénote aussi une certaine puérilité – puisque le Brésil continue à vivre dans ou sous la marque d’une éternelle condition de jovialité, comme si un père, situé à l’extérieur, au-dehors, pouvait toujours venir le sauver.
Le fait qu’on attribue au Brésil la qualité (et le défaut) d’être un « pays jeune » est, par ailleurs, l’indice de la domination coloniale de notre pensée et de notre imaginaire. Celle-ci ne repose-t-elle pas sur le présupposé selon lequel l’histoire et la culture de ce pays n’ont commencé que lorsque les Portugais ont débarqué ici ? De cette jovialité dérive aussi la façon dont il est lui-même traité : sa joie, oh sa joie ! Il y a toujours quelque chose de permissif dans la jovialité et de jouissif dans l’irresponsabilité juvénile. Il suffit, à cet égard, de voir la truculence irresponsable qui marque le langage du président élu en 2018, divisant plus que jamais la société brésilienne, déjà si fragmentée par son cruel apartheid raciste.
Mais décoloniser la pensée est, dans tous les cas et pour tout un chacun, un geste risqué. Surtout en période d’extrême pénurie, d’impuissance et d’abandon. Alors que d’innombrables tragédies s’abattent sur ce pays, l’impression générale est que la prise de conscience des injustices historiques s’est accrue.
Décoloniser la pensée est un exercice de révision de l’édifice de la civilisation. De nos jours, il implique de critiquer la civilisation alors que celle-ci est à nouveau secouée. C’est pour cela que j’ajouterais que tout dans le jeu de la reconstruction d’un édifice ne doit cependant pas être dynamité, même si tout doit être révisé, déplacé et actualisé. En réalité, rien aujourd’hui ne devrait être dynamité, car on risque d’aboutir rapidement à un corps social qui n’en a pas la moindre trace.
Puisque la destruction semble encore une alternative très blanche, on devrait re-signifier les pouvoirs de l’oubli. De nombreux penseurs ainsi qu’un large éventail de concepts qui ne servent déjà plus mériteraient sans doute l’oubli. Oublier, dans ce cas, peut être quelque chose de digne, comme créer un endroit hétérotopique où l’on laisse vivre les collections de l’humanité – car oublier complètement, cela n’existe pas, et les blessures les plus profondes devraient montrer au monde – exigence cruciale – qu’il faut aujourd’hui les sortir de l’oubli lui-même.
Mais quelles sont les blessures béantes du Brésil ? Il est si simple de répondre à cette question, même si c’est de la mauvaise foi que de chercher à éviter de le faire aujourd’hui : en fait, l’esclavage, jamais guéri, fonde une société raciste dans toute sa structure, sur laquelle règne un apartheid silencieux et masqué, faisant en sorte que les relations entre Blancs et Noirs deviennent, dans le cadre collectif, une marque constante d’injustice sociale et une cible fragile et certaine des politiques de la mort – jamais réellement surmontées – et, au niveau intersubjectif, une véritable névrose ou une menace constante. L’extermination historique, le manque de respect névrotique pour les peuples amérindiens et leurs cultures, à l’heure actuelle, assument les traits d’un véritable racisme environnemental.
C’est un type de racisme nourri par le soutien des plus grandes puissances mondiales et orchestrée par le gouvernement brésilien et ses financiers. Ensuite, les vingt-et-une années d’une dictature civile-militaire, méconnue de beaucoup d’entre nous et de presque tous les étrangers, même parmi l’élite intellectuelle, comptent aussi. Dictature qui a entraîné morts, emprisonnements, tortures, censures, qui a jeté des gens dans des caves et dans des prisons ou dans des asiles d’aliénés, avec tous les rebuts de la société, renforçant et étendant un ensemble d’actions répressives jadis cantonnées aux populations noires et indigènes, et qui sont caractéristiques de tout l’idéal et de tout le désir de propreté sous-jacent à la construction politico-identitaire du pays.
L’alliance entre le désir historique de nettoyage racial provenant de la colonisation et le désir de nettoyage politique, dont la base s’est édifiée tout au long des années de dictature civile et militaire (1964-1985), revient grossièrement aujourd’hui à travers l’idée selon laquelle le désir de justice sociale, et donc une présence plus importante de l’État social, serait le fruit de mentalités et de subjectivités assassines. C’est de lui que surgit toute une démoralisation de l’individu qui se profile d’une manière avilissante dans les discours du président et de ses partisans. Tous ces gestes et ces traits indiquent que l’on est face à une démocratie fragile, ou plutôt face à l’absence d’un véritable État démocratique, capable de faire taire et d’effacer ses propres traces ultra-autoritaires.
L’absence d’archives dans une institution publique naturalise l’extermination des corps exercée par les politiques publiques de « sécurité ». Ou encore : au Brésil, les gestes d’effacement (de démontage et de destitution) d’archives équivalent aux politiques d’extermination des corps. Le problème n’a jamais été l’absence de mémoire de ce si jeune pays, mais la manipulation et l’annihilation de traces. Ainsi, dans le cas du Brésil, c’est le pays tout entier qui a fini par devenir une hétérotopie, et non pas uniquement quelques espaces spécifiques ou juste des contre-espaces à l’intérieur de ce pays ou de cette société, tel que Foucault l’avait prédit en formulant le concept.
Les favelas sont, dans l’imaginaire national et international, des lieu où s’agglutinent les hétérotopies.
L’hétérotopie est cet espace qui s’oppose, qui neutralise, efface ou purifie les lieux délimités de nos vies. Les hétérotopies doivent porter en elles quelque chose d’absolument différent des endroits où nous vivons. Elles sont de vrais contre-espaces, constitués chacun de sociétés qui, ainsi, peuvent être classées selon les hétérotopies de notre préférence. Une société où il existe de nombreux lieux autres que « chez soi » et destinés au sexe – les bordels, les motels, entre autres – peut être lue, comprise et même classée comme hétérotopie. Car si dans le passé les hétérotopies étaient destinées à marquer les lieux des crises subjectives et collectives, telles que la mort, la naissance, la puberté, actuellement elles marquent les déviations de la société moderne. Par déviation, il faut comprendre quelque chose qui se situe entre l’interdit et le transgressif, entre le caché et l’attendu, entre ce que la société elle-même produit et ce dont elle a besoin de feindre qu’elle ne produit pas, et qu’elle qualifie comme déchet ou comme gâchis.
Les sociétés formées par d’autres sociétés, les sociétés coloniales, héritent les déviations de la colonie, mais en viennent aussi à dépendre (pour avoir un lieu) du lieu où elles se situent en tant que sociétés ou proto-sociétés, dans cette relation avec la colonie et avec le colonisateur. Cette relation déterminera les nouvelles déviations, les nouvelles hétérotopies que les sociétés coloniales vont nécessairement mettre en marche, et leur propre constitution en tant que lieu (topos) social dans le monde.
À cet égard, nous devrions nous demander si les favelas, telles qu’elles se sont développées dans les sociétés coloniales latino-américaines et plus spécifiquement au Brésil, n’agissent pas comme des hétérotopies. Des espaces où le banditisme est parfois héroïsé, où le fantasme du sexe facile est vendu aux « touristes de l’asphalte » (visiteurs éventuels et extérieurs à la favela, venant des quartiers asphaltés), où le trafic de drogue est « légal », et où, à cette fin, ce même trafic crée lui-même à l’intérieur de la favela un contre-espace vis-à-vis de sa propre loi. Contre-espaces qui, comme on le sait, ne se créent qu’en relation et en dépendance vis-à-vis des espaces institués, dans ce cas : l’État, qui n’a jamais cherché à incorporer ces lieux, le plus souvent sans eau courante ni égouts, précaires, chantiers de mort et d’extermination, qui ne s’est jamais inquiété du fait que l’immense majorité des gens qui y vit compose la masse ouvrière des grands centres urbains du pays, en majorité des pauvres et des Noirs.
La vie artistique et culturelle et l’organisation de grand nombre de ces communautés fournissent des exemples éthiques et esthétiques de lutte et d’innovation. Mais la force de cette organisation ne vient pas de l’État. De plus : l’exploitation sexuelle des jeunes filles et même l’imaginaire sexuel créé autour des communautés pauvres et des femmes brésiliennes noires attestent et signent encore aujourd’hui la présence coloniale – comme si rien n’avait changé.
Or les contre-espaces s’étendent aujourd’hui bien au-delà des maisons closes ou des maisons de prostitution, comme le pensait encore Foucault. Atteignant des zones géographiquement étendues et, surtout, d’innombrables couches politico-subjectives, confondant ainsi le logement avec l’hétérotopie. À cet égard, les favelas sont, dans l’imaginaire national et international, des lieu où s’agglutinent les hétérotopies. Le carnaval lui-même, qui fonctionne en soi comme une hétérotopie cyclique, trouve sa source dans l’espace-monde des communautés périphériques. Tout cela est applaudi pendant la période des fêtes pour être ensuite oublié, tout au long de l’année, et éjecté de la « normalité » des vies. Normalité qui continue d’être, comme elle l’a toujours été, celle de la violence policière, du racisme et de la ségrégation.
Foucault identifiait dans son texte une série d’hétérotopies de crise biologique, telles que la puberté, la vieillesse et la mort – hétérotopies dans lesquelles il lisait et inscrivait des sociétés, comme les sociétés amérindiennes, où le corps acquiert une représentation collective – lors des rituels de puberté ou des premières règles, par exemple. Mais dans ces sociétés il ne s’agit pas seulement de représentations collectives du corps, mais de la possibilité de créer des inscriptions dignes du corps dans l’espace commun. Alors que le monde a « évolué » vers des lieux où les inscriptions sociales des corps ne sont faites que pour ce qu’il désire exclure : meurtres, viols, violences, entre autres. Autrement dit : le mépris et le contrôle des corps sont la marque politique caractéristique des sociétés occidentales.
Ce sont elles qui créent la liste des écarts et les modes de transgression. Les rebuts et les jetables. En ce moment, le monde traverse une crise qui montre à quel point, pour toute la société occidentale, la plupart des corps humains sont des corps jetables. La question environnementale ne se résume pas à la question de la vie sur la planète, elle nous oblige à penser la notion de corps humain que nous souhaitons accueillir et embrasser. Et donc à penser la notion même d’être humain. Et dans cette optique, les politiques du vivant nous exigent de réfléchir à une réorientation du régime des affects – où les humains, jusqu’à présent, ont assumé le rôle du contrôle et de la définition. Dans ce régime, les affections joueront un rôle très significatif.
La solidarité entre les peuples et la conscience de leur inexorable interdépendance ne seront pas suffisantes, il faudra encore refonder la notion même de corps en Occident, en considérant que les corps vivants de la nature et leurs affections, constituent, eux aussi, la nature de l’humain. Qu’il s’agit d’une relation d’inter-pénétrabilité et de mutation constante de et entre tous les corps, humains, vivants et même non vivants. Avoir conscience des processus de mutation constants des corps est nécessaire à un devenir-commun du monde. La « philosophie » amérindienne et afro-diasporique connaît déjà tout cela, et il sera crucial d’activer ces sources de connaissance si l’on désire réorganiser le monde.
Un lieu de libération des instincts et de réalisation des désirs les plus enfouis ou les plus déviants.
En ce sens, il n’y aurait pas d’espaces hétérotopiques de déviation sans structure coloniale. Et c’est pourquoi je comprends que ces contre-espaces – puisque je ne regarde pas depuis le centre, à savoir l’Europe ou l’Amérique blanche – ont subi une véritable transfiguration venant se loger en première perspective, dans de grandes poches urbaines, en couches qui ne nous permettent déjà plus de les voir comme indicateurs ou canalisateurs des déviations de la société. Ils deviennent de véritables excrétions, et bientôt, cessant d’être des contre-espaces, ils se mettent à former un ensemble complexe de vies qui, ne pouvant être géré, déréglemente l’État.
Mais la question est encore plus complexe. Et si quelque chose augmente quand j’essaie de penser à ce texte à partir de maintenant et depuis le Brésil, c’est le fait que les contre-espaces ont aujourd’hui du mal à être délimités en interne comme l’horizon de fonctionnement d’une société. La déréglementation du capital, sa fluidité et en même temps son impérativité rendent les limites partielles, même si les inégalités augmentent au galop. La fluidité s’applique à la configuration des déviations et des hétérotopies, mais elle ne s’applique pas à la pauvreté et à la misère. Les frontières restent rigides lorsqu’il s’agit de délimiter les rebuts. Pour certains, il est difficile de comprendre que même si le monde semble plus perméable, le véritable changement de condition économique et sociale est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile à réaliser.
Et en fait, ce sont ceux-là qui prétendent maintenant être surpris par le nombre de morts causés par la pandémie de Covid-19 dans cet immense Brésil, phénomène aggravé, évidemment, par l’intérêt qu’a ce gouvernement à l’extermination d’une bonne partie de la population. Ce n’est pas par hasard que les décès ont lieu non seulement à Rio de Janeiro et São Paulo, villes surpeuplées, mais curieusement aussi à Manaus et Fortaleza. La première, un lieu de perméabilité totale et d’impénétrabilité à la fois – jungle et zone franche. La seconde, malheureusement connue, comme tout le Brésil, pour sa beauté naturelle et ses plages paradisiaques, mais aussi pour le tourisme sexuel international, aigu et historique.
Cette fluidité du désir et de l’investissement désirant du capital (et le Brésil fonctionne comme source internationale de ce désir, comme lieu où les désirs des autres vibrent, s’épanouissent et se libèrent) m’amène à affirmer que, dans le cas spécifique du Brésil, la thèse des contre-espaces n’est valable que si l’on comprend qu’ici, avant tout, c’est le pays tout entier qui s’est constitué pour l’usufruit des autres – et même lorsque l’étranger est intériorisé – comme une hétérotopie.
En fait, l’intériorisation de l’étranger est un chapitre qui reste encore à écrire. La maxime anthropophage servirait à réfléchir comment ici l’étranger est littéralement le plus familier. En faisant que la thèse de Freud sur l’étrange-familier comme mode de fonctionnement de l’inconscient, et donc des pulsions, se répande à nouveau dans l’horizon brésilien pour l’élite qui a construit les idées de ce pays. Le pays usine de l’inconscient est le frère du pays source des désirs des autres – un lieu de libération des instincts et de réalisation des désirs les plus enfouis ou les plus déviants.
Le Brésil est une hétérotopie qui, il y a de nombreux siècles, a permis aux étrangers de première classe venus ici, de jouir sans limites de tous leurs droits de citoyenneté. Des étrangers qui caractérisaient une manière particulière d’être brésilien de « première classe » – Blancs ici et là marqués par les rencontres entre différents pays qui, dans un flux migratoire, sont venus blanchir le pays, « mélangés » aux autochtones et aux esclaves noirs par le viol, mode de peuplement de ce territoire continental. Faisant de ce pays, non pas une riche société métissée, mais une honteuse société raciste et inconsciente des flux et de l’ordre de ses « mélanges ».
Le Brésil est une hétérotopie lorsqu’il évite de parler de son héritage colonial. « Immense » Brésil qui revient sur le Portugal, « si petit et exigu », pensant que la puissance de sa musique ou de ses feuilletons télévisés suffit à guérir ses blessures coloniales.
Mais, de fait, les blessures coloniales ne sont pas seulement passées, elles sont bien présentes lorsqu’elles s’éternisent dans un mode de relation, dans une manière de regarder l’autre et de se regarder dans l’autre. Si De Gaulle a dit que le Brésil n’est pas un pays sérieux, que les Brésiliens ne sont toujours pas pris au sérieux, et souvent n’arrivent pas eux-mêmes à se prendre au sérieux, cela signifie que cette blessure coloniale est toujours ouverte. Par rapport au Portugal, tout est plus complexe, car le Brésil a été à la fois colonie et métropole. Abritant les rois de sa métropole, pour hériter ensuite, après leur départ, une honteuse indépendance, proclamée par ces mêmes rejetons royaux. Le Brésil est encore et toujours ce pays, fils bâtard du roi, rêvant d’un règne à venir.
Le Brésil est une hétérotopie quand il perpétue l’ignorance de ses blessures – chaque blessure étant produite en relation – : prétendant être cordial, il évite de faire face aux conflits qui, cependant, définiraient une issue digne pour nous tous.
Le Brésil est une hétérotopie où la joie est la seule chose que l’on attend du peuple, quand le peuple répond exactement à ce qu’on attend de lui.
Le Brésil est une hétérotopie lorsqu’ici ou là n’ont pas été pris, ou ne sont pas pris, au sérieux les risques réels d’un gouvernement extrémiste et autoritaire comme l’est le gouvernement actuel.
Le Brésil est une hétérotopie lorsque l’on affirme, sans hésiter, que ce pays n’a pas de solution. Il s’agit là d’un processus d’irréalisation de l’appartenance du Brésilien à son pays. Au Brésil, cela participe de toutes les attaques autoritaires qui viennent délimiter les contours hétérotopiques : de sa situation coloniale passée et actuelle à sa structure profondément raciste niée, cyniquement ou inconsciemment, par une grande partie de la société et le mépris pour un président qui a fini par rallumer ce que nous voulions oublier, à savoir la façon dont la plupart de sources nationalistes sont restées livrées aux pensées totalitaires et autoritaires brésiliennes.
Le Brésil est une hétérotopie lorsqu’il permet de construire le plus grand des territoires, fondé sur un pacte étrange où l’amour-propre équivaut, jusqu’ici, à s’identifier à son agresseur.