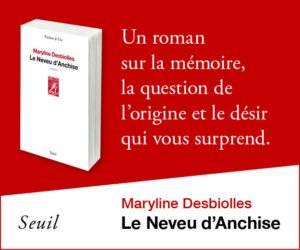De l’usage des fictions devant les effondrements
Dans ces mêmes colonnes, Jean-Pierre Dupuy a récemment publié un article pour « réaffirmer le catastrophisme éclairé », dans lequel il cite la nouvelle de Philip K. Dick « Minority Report », rendue fameuse par l’adaptation qu’en a faite Steven Spielberg avec Tom Cruise. Sa démonstration renvoie dos à dos les collapsologues, qu’il accuse de discréditer la cause qu’ils entendent servir, et les anti-catastrophistes, « optimistes béats » qui, par haine de l’écologie, nient l’évidence du changement climatique.
Les deux adversaires se répondraient dans un jeu de miroir, leur opposition s’appuyant sur trois accords à la fois fondamentaux et tacites. D’abord, ils s’entendent pour ne considérer qu’une seule forme de catastrophisme, la collapsologie, écartant ainsi du débat toute forme de « catastrophisme rationnel », le « catastrophisme éclairé » de Dupuy par exemple. Ensuite, ils méconnaissent la condition tragique du prophète de malheur et s’ils citent Hans Jonas et Günther Anders, c’est sans comprendre ou « respecter » leur pensée. Enfin, « tant les catastrophistes mortifères que les aveugles satisfaits d’eux-mêmes accélèrent la marche vers l’abîme », les premiers en excluant qu’on puisse l’arrêter, les seconds en tournant la tête ailleurs.
Pour sortir de cet affrontement stérile, Jean-Pierre Dupuy propose de se pencher sur la parole du prophète : la prophétie de malheur, telle qu’elle s’exerce dans l’Ancien Testament, peut être dite « auto-invalidante », comme d’autres sont autoréalisatrices. Le prophète n’annonce la catastrophe que pour la prévenir : sa prédiction ne doit pas se réaliser, elle doit au contraire inciter ses destinataires à agir pour qu’elle ne se réalise pas. Autrement dit, la prophétie n’est pas un discours de vérité valant par un contenu de savoir, mais une parole qui se tient tout entière dans sa dimension pragmatique[1]. Mais pour convaincre ses auditeurs, elle doit se présenter comme certaine.
Le paradoxe, et le tragique de la condition prophétique, se tiendrait ici : la prophétie auto-invalidante revêt l’apparence d’une prophétie autoréalisatrice. D’où un « défi », écrit Dupuy, pour le prophète de malheur d’aujourd’hui : « rabattre la prophétie auto-invalidante sur la prophétie autoréalisatrice », c’est-à-dire intégrer la première dans la seconde ou annoncer en même temps une catastrophe nécessaire et l’avenir qui l’évitera en induisant des comportements qui empêcheront cette catastrophe d’advenir.
Comment relever ce qui est en effet un défi ? C’est ici qu’intervient la nouvelle de Philip K. Dick. Dans « Minority Report », la police arrête les criminels avant qu’ils ne commettent leur forfait, grâce aux prophéties d’un trio de devineresses. Or ce nombre trois est intéressant parce qu’il inclut la possibilité d’un désaccord : si deux devineresses annoncent un crime que la troisième ne prévoit pas, l’avis de celle-ci est inclus au rapport. Un « avis minoritaire » prévoyant un avenir heureux (sans crime) est donc intégré à la prophétie majoritaire prévoyant le malheur (le crime). « Voilà à quoi devrait ressembler la prophétie face à une catastrophe anticipée mais dont la date est inconnue : le malheur ne devrait y figurer qu’en filigrane d’une annonce de bonheur, ce bonheur consistant en l’évitement du malheur », conclut Dupuy.
La catastrophe ne se situe pas seulement dans l’avenir, mais aussi bien dans le présent et dans le passé.
En effet, le procédé résout rationnellement le problème. Mais peut-on s’arrêter là ? Faisons-nous face à une catastrophe future dont la date est inconnue ? Paradoxalement, en résumant ainsi le défi du prophète de malheur contemporain, Dupuy accorde aux collapsologues l’essentiel : l’avenir tient tout entier dans une catastrophe unique, et tout l’enjeu du débat serait d’en convaincre les incrédules.
Il y a au moins deux raisons de penser autrement. Primo, la catastrophe ne se situe pas seulement dans l’avenir, mais aussi bien dans le présent et dans le passé et il n’y a donc pas de « date » à prévoir, mais une relecture de l’histoire à effectuer pour faire apparaître une catastrophe déjà effective, mais déniée. Secundo, penser « la » catastrophe, c’est encore se situer dans un mythe millénariste selon lequel tout s’effondrera d’un coup, dans un événement révélant abruptement à ceux qui ne voulaient pas voir la Vérité annoncée par le prophète. Ces deux arguments peuvent être soutenus par la lecture de fictions, si on ne s’arrête pas à leur titre, mais qu’on accepte de se livrer à une herméneutique littéraire plus patiente.
La catastrophe est donc à prévoir parce qu’elle est passée et présente. Elle n’est pas le terme de notre histoire, elle en est la condition. L’exemple simple du réchauffement climatique le montre : les dynamiques conduisant à l’augmentation des températures sont à l’œuvre depuis plus de deux siècles et vont s’accélérant, produisant des catastrophes en chaîne parfaitement visibles aujourd’hui. Pour ne retenir que la liste dressée par l’Atlas de l’anthropocène dans son chapitre consacré au climat : fonte des glaces, élévation du niveau des mers, acidification des océans, dégradation des écosystèmes, défis sanitaires, migrations[2].
Mais un roman le dit mieux. Prenons La Route de l’Américain Cormac MacCarthy. L’histoire se situe dix ans après une catastrophe qui semble avoir détruit toute vie sur terre, hormis quelques hommes et femmes errant perpétuellement à la recherche de nourriture, d’abris contre le froid et de refuges contre leurs semblables devenus cannibales. Un père et son fils né au moment de la catastrophe marchent vers le sud, sur une « route » qui rappelle celle du Pèlerin de John Bunyan, chemin allégorique vers le Salut.
Mais dans ce monde, il n’y a pas de salut, la marche n’a pas de fin et n’est soutenue par aucun espoir. Le père le dit fermement au garçon : « quand tu rêveras d’un monde qui n’a jamais existé ou d’un monde qui n’existera jamais et qu’après tu te sentiras de nouveau heureux, alors c’est que tu auras renoncé[3] ». Entretenir la nostalgie du monde d’avant (qui n’a jamais existé pour l’enfant) ou l’espoir d’un monde d’après (qui n’existera jamais), c’est se tenir dans une fiction consolatrice, et cela revient à renoncer à survivre. Il n’y a que le présent d’une catastrophe permanente, le seul monde que l’enfant ait connu, le seul qu’il connaîtra jamais : celui dans lequel il doit vivre et agir, c’est-à-dire inventer les conditions de son existence.
Or dans tout le roman prévaut le point de vue du père : le lecteur partage les savoirs et les émotions de l’adulte qui a connu le monde d’avant. Avec lui, il est placé dans ce monde fictif terrifiant et avec lui, il peut le comparer au passé. Il fait alors l’épreuve de ce qui pourrait arriver (ce qui est arrivé dans la fiction). Ainsi placé fictivement après la catastrophe, le lecteur n’est pas confronté à une prophétie, mais à un récit qui fait de son présent un passé, qui donc l’historicise en l’ouvrant sur un avenir possible. Faire de la catastrophe notre passé et notre présent, plutôt que notre avenir, c’est ici sortir du registre de la prédiction, faire éprouver le pire et préserver la puissance d’agir : avec le père qui incite son enfant à ne pas désirer de consolation, le lecteur est amené à éprouver les affects d’un effondrement sans fin, et à y chercher les conditions auxquelles la génération suivante pourra vivre.
Nous avons besoin de fabulateurs qui feignent d’annoncer l’absence de futur, pour rendre précieux les germes de vie que nous devons préserver.
Mais penser « la » catastrophe comme un événement unique, c’est encore céder au mythe d’une Révélation à venir. C’est ainsi que les collapsologues parlent de « l’effondrement » au singulier sans voir que la dégradation des écosystèmes et de nos sociétés est un processus lent, dont ni le début ni le terme ne sont faciles à déterminer. Il serait plus juste de parler d’effritements ou de délitements, au pluriel, pour décrire ce qui nous arrive, comme le proposent Yves Citton et Jacopo Rasmi, qui se demandent : « Combien de banlieues, combien de villages, combien d’écoles, de campus universitaires, d’hôpitaux, vivent déjà dans cet effritement, qui est un effondrement au ralenti[4] ? »
Ici encore la fiction est un recours utile. Se placer après la catastrophe, comme le font les films et les romans dits post-apocalyptiques et que je préfère appeler fictions de la fin du monde, c’est faire l’expérience des effritements au présent. Ainsi des personnages de L’Aveuglement, du Portugais José Saramago, victimes d’une épidémie de cécité qui les conduit à vivre dans un monde uniquement peuplé d’aveugles.
À mesure que l’épidémie se répand, la société se décompose. Les aveugles sont rassemblés dans un asile pour éviter qu’ils ne contaminent la population, mais ce confinement, comme on le désignerait aujourd’hui, échoue à contenir l’épidémie et les portes de l’asile s’ouvrent quand ses gardiens sont devenus aveugles à leur tour, libérant les personnages qui découvrent une ville transformée pendant leur internement : une ville d’aveugles cherchant les moyens de vivre. En une allégorie transparente qui dit notre aveuglement ordinaire (par exemple celui des climato-sceptiques, mais aussi celui de tous nos renoncements et de toutes nos lâchetés quotidiennes), le roman demande à son lecteur ce qu’il ferait dans une telle situation.
Un seul personnage échappe à l’épidémie : une femme, seule « voyante » au milieu des aveugles, qui devient leur guide et leur sauveur. Ainsi, dans la mesure où le lecteur en partage le point de vue, il est conduit à se demander : « Que ferais-je si moi seul voyais la condition de mes contemporains, si moi seul voyais ce qu’ils ne peuvent pas voir ? » Or jamais ce personnage ne prophétise, jamais il ne s’interroge sur le futur. Ses doutes comme ses efforts portent sur le présent. Cette femme vit au milieu des aveugles et comme eux, en partageant toutes leurs souffrances.
Par ce sacrifice de sa personne, elle acquiert une dimension christique, mais si elle sauve les aveugles, ce n’est pas au nom d’un Salut à venir, mais au nom de leur humanité, amoindrie, fragilisée, remise en cause et d’autant plus précieuse. Comme l’indique le dialogue suivant entre deux aveugles : « Je ne sais pas s’il y a un futur, mais maintenant il faut essayer de savoir comment nous allons pouvoir vivre dans ce présent-ci, Sans futur, le présent ne sert à rien, c’est comme s’il n’existait pas, Il se peut qu’un jour l’humanité réussisse à vivre sans yeux, mais elle cessera alors d’être l’humanité, le résultat on le connaît, qui parmi nous se considère encore aussi humain qu’il croyait l’être avant[5]. »
Comme les personnages de Saramago, nous avons peut-être moins besoin de prophètes, même rationnels, que de romanciers et d’artistes qui ne prétendent pas annoncer l’avenir, mais qui, sous couvert de l’imaginer, rendent le présent visible. Nous avons besoin de fabulateurs qui feignent d’annoncer l’absence de futur, pour rendre précieux les germes de vie que nous devons préserver si nous ne voulons succomber ni au nihilisme larvé des collapsologues, ni à l’aveuglement des optimistes béats. La Covid peut nous apprendre quelque chose : le monde d’avant 2020 ne reviendra jamais, mais le « monde d’après » fabulé pendant le confinement de mars-avril 2020 n’a une chance d’advenir que si nous persistons à le rêver.