Signification et limites de la décroissance
Si la décroissance ne consistait qu’à produire et à travailler moins, elle serait une impasse à l’heure où la conversion de notre système productif, la transition des systèmes de transports, de l’agriculture, des modes de chauffage, de l’habitat et de l’urbanisme, les travaux de « fermeture » des industries extractives et de restauration des sites dévastés, demandent des investissements et des efforts accrus. Plus que la décroissance, n’est-ce pas la transformation du système productif qu’il convient de mettre en œuvre ?
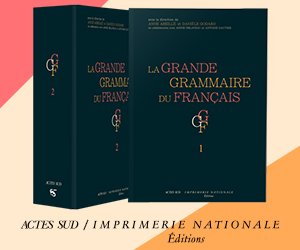
Il s’agit d’organiser non la décrue quantitative, mais la réorientation qualitative du système productif. La notion de décroissance a néanmoins le mérite d’interroger en creux ce qu’est la croissance. L’économie et le système productif qu’elle anime constituent non seulement une machine, mais transforment la société en machine en vue de la mobilisation totale des êtres humains et des biens, ainsi que du « développement de marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie », selon les termes mêmes du Traité de Lisbonne. On en appelle, pour assurer la conversion énergétique, à la sobriété et à la conversion morale de l’homo œconomicus, mais la plupart de nos dépenses sont commandées par les besoins de la machine et de son fonctionnement.
Ce n’est pas l’individu mais la mégamachine économique et productive, qui a des besoins, que les êtres humains se contentent d’éprouver au nom précisément du bon fonctionnement de la machine, de sorte que l’individu n’est plus maître de déterminer lui-même ni le niveau de ses besoins ni l’effort qu’il est prêt à fournir pour les satisfaire. C’est sans doute pour avoir sous-estimé la dépendance des êtres humains à la machine économique et productive, pour avoir cherché à contraindre nos mœurs sans la moindre volonté de réformer la machine qui les commande, que le précédent gouvernement a déclenché le mouvement des Gilets Jaunes.
La croissance est donc essentiellement l’expression du bon fonctionnement de la machine, de la dynamique de sa mobilisation, du fait qu’au contraire de la seconde loi de la thermodynamique la machine n’est pas affectée par l’entropie. Il n’est pas inutile de rappeler que la notion de croissance, pour ne pas parler de son idéologie, est récente, propre au XXe siècle, formalisée en particulier par Joseph Schumpeter qui en a posé les principes fondamentaux dont restent tributaires les théories les plus récentes qui la concernent. L’économie du XIXe et du début du XXe siècle, aussi vigoureuse fût-elle, n’en a pas eu besoin pour expliquer son développement, se contentant de poursuivre l’allocation optimale des facteurs de production et leur équilibre stationnaire, comme en témoigne la théorie économique de Say à Keynes en passant par Stuart Mill puis par l’école néo-classique.
La théorie de la croissance est en réalité contemporaine du devenir machinique des sociétés qui caractérise le XXe siècle, d’abord sous sa forme militaire et tragique de la première guerre mondiale, puis mécanique, technocratique et planificatrice de l’entre-deux-guerres, et enfin sous sa forme économique et cybernétique de l’après-guerre. La société au XXe siècle est devenue machine. Est-ce parce qu’elle s’est mise à utiliser des machines à la place des outils ? Ou bien une société est-elle en mesure de faire usage des machines sans pour autant devenir elle-même machine ? La machinisation de la société découle moins de l’usage des machines, que du fait que la société se mobilise et se mécanise elle-même au moyen de cet usage. Quoi qu’il en soit, de la réponse à ces questions dépend la légitimité ou au contraire l’illégitimité de la notion de croissance.
Décroître pour décroître serait aussi absurde que croître pour croître.
La plus-value néguentropique dont bénéficierait la mégamachine économique et sociale, et dont la croissance n’est que le synonyme, ne peut apparaître aujourd’hui qu’illusoire, à l’épreuve des contraintes écologiques de notre temps. Décroître consiste donc non pas à abaisser l’intensité de la machine (au risque de son effondrement), ni moins encore à changer les pièces de la machines pour que celle-ci tourne de façon plus fluide et sans cahot, mais à débrayer et à désarmer sa mobilisation totale, pour mieux échapper à son entropie, sans que cela signifie pour autant travailler moins, produire moins ou s’appauvrir.
La croissance est un système relativiste : on ne compte que ce que l’on juge digne d’être compté. On compte aujourd’hui plus aisément les flux que les stocks, les activités commerciales que celles qui sont hors commerce, la production que la maintenance, en oubliant évidemment les services rendus par les écosystèmes. N’a de valeur que ce à quoi on donne de la valeur. Le serpent se mord la queue. La croissance est une tautologie comme le note Tim Jackson, l’ancien conseiller économique de Gordon Brown (le premier Ministre anglais de 2007 à 2010), pour qui « la croissance est essentielle à la prospérité seulement dans une économie fondée sur la croissance ». C’est pourquoi la mise en cause des modes actuels de la comptabilité nationale et la recherche de nouveaux critères pour calculer le PIB m’apparaissent comme un élément décisif de la transformation du système productif. La décroissance n’est ni la récession ni la croissance négative. Le terme décroissance ne doit donc pas être pris au pied de la lettre : décroître pour décroître serait aussi absurde que croître pour croître. La décroissance est d’abord, comme l’affirment Tim Jackson ou Serge Latouche, un mot d’ordre avant d’être un programme, mais aussi malheureusement un mot d’ordre le plus souvent dénué de programme.
En réalité le terme de décroissance correspond à un état de fait. Elle est de l’ordre du constat autant que du projet, du subi autant que du voulu. La décroissance n’est pas seulement la lubie de militants puritains, mais aussi et d’abord la réalité économique de notre temps. Qui oserait dire cependant que le roi est nu ! Depuis la fin des Trente glorieuses, la croissance est en berne, en Europe du moins. Elle est une fiction, un artifice statistique. Elle relève aujourd’hui essentiellement d’un jeu d’écriture comptable qui repose sur la marchandisation générale de la société et sur ce qu’on appelle la théorie monétaire moderne, et plus trivialement le quantitative easing.
Le PIB croît parce qu’on intègre dans la sphère commerciale des choses et des services qui autrefois étaient hors commerce et hors comptabilité, comme le recommande la loi organique relative aux lois de finances promulguée en 2001, sans que cette intégration au demeurant apporte en soi le moindre enrichissement ni la moindre utilité supplémentaires à la société et à son économie. De même, la réponse donnée à la crise des subprimes de 2008 puis à la crise sanitaire de la Covid-19 par la planche à billets et l’accroissement du déficit budgétaire sans inflation a créé nécessairement une croissance nominale considérable au prix d’un accroissement des inégalités et donc de la pauvreté non moins considérable. Mais qu’en sera-t-il quand l’inflation sera de retour, et quand la lutte contre les déficits budgétaires redeviendra une priorité, comme on l’appréhende aujourd’hui ? Ne restera plus que l’évidence de la décroissance.
Paradoxalement la puissance publique est plus « décroissantiste » que l’écologisme.
Nous vivons donc dans une société de croissance sans croissance, de croissance nominale ou comptable sans croissance réelle, où la hausse du PIB ne correspond absolument pas à une hausse du bien-être, mais s’accompagne de contraintes accrues, écologiques, institutionnelles et sociales, de plus en plus coûteuses à supporter. J’en veux pour preuve le récent projet de réforme des retraites en France qui en réalité signifie clairement pour la puissance publique la fin de la croissance et de son illusion. Jusqu’à maintenant le système des retraites reposait sur l’idée que les générations futures seraient plus riches grâce à la croissance et donc en mesure de payer les retraites des générations précédentes sans le travail desquelles cet enrichissement n’aurait pas eu lieu. C’étaient les générations futures qui rendaient justice aux générations présentes, et non l’inverse comme l’exige notre responsabilité à l’égard des générations futures née des contraintes écologiques. Aujourd’hui, on parie sur le fait qu’il n’y aura plus de croissance et qu’il appartient donc à chaque génération de financer sa retraite sans pouvoir compter sur l’improbable enrichissement des générations futures.
Paradoxalement la puissance publique est plus « décroissantiste » que l’écologisme, parce que l’écologisme a un projet de conversion du système productif que n’a plus la puissance publique qui se contente de gérer la décroissance annoncée sans projet de substitution. Il est symptomatique que cette réforme soit portée par les tenants de l’idéologie de l’innovation, de la disruption et de la destruction créatrice. Les marchands d’illusions en sont aussi les liquidateurs et les désenchanteurs. En réalité, la plupart des réformes néo- puis post-libérales se sont donné pour tâche de gérer la décroissance depuis les crises pétrolières des années 1970, tandis que la social-démocratie a géré la croissance d’après-guerre. Ce partage des rôles est contre-intuitif. Le libéralisme ne promettait-il pas la prospérité, tandis que le social-démocratie, héritière de Marx, cherchait de son côté à surmonter la loi d’airain des rendements décroissants censée conduire le capitalisme à sa fin ? On eût pu donc s’attendre à l’inverse.
Quoi qu’il en soit, la plupart de ces réformes se sont aussi efforcées de dissimuler sous leur idéologie la réalité des faits. La réforme des retraites est la première réforme à assumer expressément la décroissance, « bas les masques », nous est-il annoncé : on appréciera le double sens de la formule. La « croissance » contemporaine est comme « la souveraineté » des débuts de l’âge moderne dont la théorie émerge au milieu des guerres de religion et des guerres civiles pour conjurer l’impuissance qui gagne les royaumes et les principautés. Une fois l’état des choses stabilisé, on passe à autre chose. La raison d’État ne possède pas la même signification sous Richelieu ou Mazarin où elle revêt sa dimension sombre et arbitraire que, sous Colbert, où elle exprime simplement les savoirs et les techniques nécessaires à la bonne gestion de l’État. Il en va de même de la croissance dont la surenchère théorique, qu’expriment aujourd’hui la théorie de la croissance endogène ou le thème de la disruption, s’efforce vainement de compenser les difficultés pratiques qu’elle rencontre.
L’économie contemporaine ressemble aux efforts du fameux céramiste de la Renaissance, Bernard Palissy, qui brûlait meubles et charpente pour découvrir le secret des émaux. La production est de plus en plus coûteuse, produisant de plus en plus de déchets et d’externalités négatives. Là où au début de l’industrie pétrolière, l’énergie dépensée pour exploiter 100 barils ne dépassait pas l’équivalent de 1 ou 2 barils, elle représente aujourd’hui 50 barils et plus. Plus encore, le fonctionnement de la machine se paie par une baisse de la protection sociale, un affaiblissement des statuts, un accroissement des inégalités. Un développement durable, vraiment durable, doit raisonner à l’inverse. Il s’agit moins de produire des richesses économiques, financières, et monétaires au prix de l’épuisement de la Terre et de la précarité sociale, que de transformer ces richesses au court-terme, volatiles et instables, en biens institutionnels, intellectuels et symboliques, bref en biens pérennes et durables, qui relèvent plus de la reproduction de la vie que de la production économique.
Les économies d’Ancien Régime ont réussi dans une situation de rareté monétaire, de cloisonnement des marchés, de fragilités structurelles et de fortes incertitudes, à inventer, équiper, édifier et éduquer. Se fait jour un puissant effet de levier qui avec peu réussit à constituer un patrimoine commun à l’usage des générations futures aussi bien que présentes. Or la mise en œuvre de cet effet de levier implique nécessairement que l’on sorte de la spirale de la croissance, de la logique de l’investissement capitalistique n’ayant d’autre objectif que la croissance du capital. Encore faut-il à cette fin pouvoir repenser la différence entre le court-terme et le long-terme, le matériel et l’institutionnel, l’économique et le politique, tant il est vrai que transformer les richesses matérielles en institutions et en biens communs est par essence la tâche du politique. Mais réintroduire de la différence dans les champs d’immanence que constituent les sociétés contemporaines entièrement soumises aux lois de l’économie, c’est aller à contre-courant de ce mode de gouvernementalité, dominant depuis les années 1980, que l’on appelle la gouvernance.
