L’agitation de la chimère « wokisme » ou l’empêchement du débat
Alors que je commence à écrire ce texte, je suis presque surpris de voir mon correcteur automatique – qui est pourtant aux avant-postes des évolutions de notre langue – souligner en rouge le terme même sur lequel porte mon propos : wokisme. Ce refus d’obstacle informatique met immédiatement le doigt sur un trait essentiel des controverses liées à cette pseudo-notion : il s’agit d’un néologisme récent et à peine français visant à court-circuiter les termes classiques du débat public sur les questions liées à l’immigration et aux discriminations que subissent les différentes minorités.
Nous avons assisté à un véritable blitzkrieg sémantique : on a échafaudé de toutes pièces un mot pour le diffuser massivement dans le débat public, avant même d’avoir laissé quiconque s’interroger sur sa pertinence ou tenter de l’expliquer. D’où la situation que nous constatons aujourd’hui : la gauche, visée par ce terme quant à ses revendications dites « sociétales », est prise de vitesse, à tel point que certains de ses représentants politiques finissent même par reprendre le mot à leur compte, ajoutant un ferment de discorde supplémentaire à une constellation partisane déjà sinistrée.
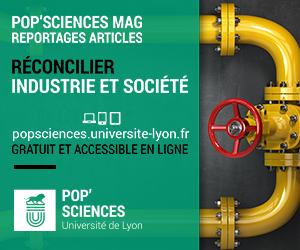
Tout se passe alors comme si la droite conservatrice et l’extrême droite avaient gagné une bataille de plus dans la guerre des idées. Il resterait alors simplement à prouver que le « wokisme » correspond véritablement à une « idée » politique. Or il n’en est rien : c’est un artifice purement rhétorique auquel il est bien difficile de trouver un contenu déterminé, et dont l’omniprésence médiatique, mais plus généralement publique (au double sens du terme, puisque le terme est maintenant repris par de nombreux hauts responsables), condamne une part croissante des débats à l’inanité. Il conviendrait donc, pour le bien de ceux qu’il vise comme pour celui de ceux qui l’utilisent, de le ranger définitivement dans le tiroir des inventions lexicales sans lendemain.
Le paralogisme élémentaire sur lequel repose le malentendu du « wokisme » consiste en la création même de ce néologisme, et plus précisément sur le passage d’un adjectif anglo-saxon (woke) à un nom commun français (wokisme). Dans le débat anglo-saxon sur ces questions, on ne parle en effet jamais de wokism[1], ce qui est tout à fait significatif : l’ironie du sort veut que ceux qui dénoncent une « américanisation » caricaturale du débat public importent eux-mêmes des termes des États-Unis en les déformant. Ils introduisent ces derniers dans la langue française sans aucun effort d’acclimatation contextuelle (s’il était besoin de le rappeler, les campus états-uniens ne sont en effet pas superposables à la société française), et redoublent cette première faute de raisonnement de l’effet d’exagération que produit cette substantivation indue du mot woke.
Sans revenir sur la généalogie du vocable, patiemment rappelée dans de nombreux organes de presse, on rappellera qu’en anglais, il y a effectivement des personnes qui se disent woke, c’est-à-dire littéralement « éveillées » aux différentes formes de discrimination et d’oppression – ce qui explique qu’au Royaume-Uni, 16 % des individus puissent se décrire comme tels, dans une enquête souvent citée par les pourfendeurs du « wokisme ».
Mais le tour de passe-passe fallacieux qu’opèrent alors ces derniers consiste à transformer en nom ce qui n’est qu’un adjectif, c’est-à-dire, en termes techniques, à convertir en substance consistante ce qui n’est que l’attribut de groupes et de personnes au demeurant très différentes. Par sa seule existence, ce simple néologisme produit l’impression qu’il existe un mouvement constitué autour d’une « idéologie woke », elle-même fantasmée dans sa cohérence.
« Wokisme » est un mot qui ne se caractérise pas par son contenu, mais par sa fonction : stigmatiser des courants politiques souvent incommensurables tout en évitant de se demander ce qu’ils ont à dire.
C’est un processus rhétorique comparable à celui qui consiste à unifier « la théorie du genre » pour mieux la disqualifier comme une prétendue idéologie, alors qu’il s’agit en réalité d’un champ extrêmement diversifié et polémique : celui des études sur le genre. « Wokisme » est un mot qui ne se caractérise pas par son contenu, mais par sa fonction : stigmatiser des courants politiques souvent incommensurables tout en évitant de se demander ce qu’ils ont à dire.
Il faudrait pourtant distinguer deux choses : s’il existe naturellement (au moins autant que dans tous les autres courants politiques) des tendances idéologiques à l’œuvre dans certaines formes de militantisme à gauche, et ce notamment sur les questions dites « sociétales », cela ne permet aucunement d’affirmer pour autant que la somme de ces mouvements constitue une idéologie. En vérité, il n’y a d’idéologique dans le « wokisme » que l’opiniâtreté avec laquelle les adorateurs de ce mot l’utilisent pour caractériser des phénomènes disparates.
C’est précisément parce qu’il n’y a pas de « wokisme » hors des chaînes d’information en continu et des réseaux sociaux, mais seulement des personnes très variées qui s’affirment sensibles aux différentes discriminations traversant nos sociétés, qu’il n’y a jamais personne pour incarner ce pseudo-courant et répondre en son nom aux attaques de la droite. C’est tout l’intérêt, du point de vue rhétorique, de construire ce que l’on appelle un « homme de paille » : une version totalement caricaturée de l’adversaire qui permet de le rendre si méconnaissable qu’il ne se sent même plus visé, et qu’il ne se sent donc même pas appelé à répondre.
Cela explique que – pour aller vite – les débats droite/gauche qu’abritent les plateaux de télévision autour du « wokisme » opposent la plupart du temps un interlocuteur conservateur ou réactionnaire comparant les méfaits de cette idéologie aux « totalitarismes » du XXe siècle, à un interlocuteur progressiste tentant d’expliquer en quoi ce concept ne correspond à aucune réalité observable (aucun corpus idéologique, aucun mouvement constitué, aucune personnalité politique représentative…)[2].
D’où une situation paradoxale qui rend toute véritable discussion impossible, et qui se caractérise par un évident décalage : face aux multiples attaques « anti-woke », aucune véritable réponse « pro-woke » n’est possible. Lorsqu’elle s’attaque au « wokisme », la droite ne parle en fait qu’à elle-même et à ses propres obsessions, et le débat public franchit une nouvelle étape dans l’effroyable situation où il se trouve aujourd’hui : nous n’avons souvent plus affaire qu’à des discours paranoïaques refermés sur eux-mêmes, visant non plus à convaincre mais à annihiler un adversaire dont on ne prend même plus la peine de se demander ce qu’il dit vraiment[3]. La substantivation de l’adjectif woke (qui peut aussi prendre les formes « idéologie woke » ou « culture woke »), corrélat langagier de la substantialisation du « wokisme », est le péché originel qui mène à ces dialogues de sourds.
D’aucuns répondront peut-être que certes, les expressions comme « wokisme » (il faudrait inclure à cette même famille au moins la « cancel culture », l’« indigénisme », le « racialisme ») n’ont aucune portée descriptive, mais qu’elles peuvent à la rigueur être utilisées comme des catégories polémiques fédératrices – un peu comme à gauche, on traite souvent l’autre de « facho » : c’est de bonne guerre, dira-t-on encore.
Mais le problème, c’est que la caricature finit ici par contaminer les éléments du langage politique, et peut-être bientôt même l’action publique : c’est ce qu’incarne Jean-Michel Blanquer, et son étrange « Laboratoire de la République », présenté notamment comme une arme « universaliste » contre le « wokisme » (pour mettre les choses en perspective, on peut se souvenir que Gérald Darmanin, en dissolvant Génération identitaire, ne s’est pas aventuré à qualifier ces militants de « fachos » ou même de « fascistes ») .
Le « wokisme » n’est au fond qu’un énième avatar de ce que la droite appelle depuis la fin du XXe siècle la « bien-pensance ».
Si une bonne partie du personnel politique de droite, de celle qui se dit centriste à celle qui revendique sa prétendue « radicalité », s’accapare ce terme, c’est notamment parce qu’il lui permet du même coup de discréditer d’un simple geste les luttes de gauche contre les discriminations (pourtant les plus enracinées dans l’histoire de ces mêmes combats), pour affirmer du même coup : « nous sommes les vrais féministes et les vrais antiracistes, car nous sommes fidèles à la promesse républicaine et universaliste ».
On ne peut que constater une relative fluctuation des expressions utilisées par celles et ceux que gêne la lutte contre les discriminations quand elle est jugée trop « moralisatrice » : l’endurant « politiquement correct »[4] a été brièvement remplacé par un « islamo-gauchisme » si ridicule et xénophobe dans sa formulation même qu’il s’est vite reconfiné dans les nébuleuses dont il provenait.
Le « wokisme » n’est au fond qu’un énième avatar de ce que la droite appelle depuis la fin du XXe siècle la « bien-pensance ». Comme ce dernier terme, il a subi une étonnante inversion puisque les « bien-pensants » étaient encore, dans les années 1970 ou 1980, les milieux chrétiens conservateurs. Ces phénomènes de distorsion semblent devenir la règle, puisque l’expression politically correct, elle aussi, fut d’abord utilisée positivement aux États-Unis par des militants de gauche avant d’être réinvestie péjorativement à droite. En France, c’est quand ces termes avaient déjà perdu leur sens d’origine qu’ils ont été injectés dans le débat public pour caractériser une réalité souvent bien différente.
Mais quoi que l’on pense de sa pertinence, la « bien-pensance » – au sens où l’entendent les conservateurs – ou le « politiquement correct » avaient au moins pour mérite d’assumer leur caractère purement polémique et de ne pas se faire passer pour de véritables notions, ou pour un courant à la fois incarné et si dangereux qu’il nécessiterait la création d’un pompeux « Laboratoire de la République ».
En dissimulant, et en oubliant même son origine rhétorique, les personnalités politiques qui laissent s’infuser toujours plus cette pseudo-idée dans le débat public continuent d’enterrer ce dernier sous un monceau de controverses sans objet, alors qu’il est toujours plus urgent d’en faire à nouveau l’espace digne d’un échange d’arguments entre personnes éclairées. Or s’il est vrai qu’en démocratie plus que partout ailleurs, nos ennemis idéologiques nous font grandir, alors même les pourfendeurs du « wokisme », à droite comme parfois à gauche, auront tout à gagner d’apprendre enfin à considérer leurs opposants pour ce qu’ils sont vraiment. Ils ne pourront le faire qu’à condition d’abandonner ce terme auxquels ils se raccrochent bien souvent comme à une amulette.
