Plantationocène et extractivisme : convergence de logiques prédatrices
Plutôt que d’en rester à la description d’un objet portant sur les phénomènes désignés par les notions « d’extractivisme » et de « plantationocène », le propos qui suit envisage deux orientations. Il s’appuie d’abord sur ce qui a été au fondement de mes recherches depuis plus de 30 ans, à savoir le système de plantation esclavagiste et les interstices où se déploient des résistanpréces inédites. Un système de plantation que l’on a fini par désigner « système plantationnaire », terme qui annonce la venue récente du mot « plantationocène » dans sa visée engagée à désigner enfin clairement l’exploitation intense des corps humains.
Mais la saisie de cette composante « objectivée » souhaite aussi prendre en compte ce qui a été l’autre pendant indissociable de mes recherches, à savoir le milieu même de fabrication de la recherche, c’est-à-dire cet univers qui est régi par des codes, des façons de faire, des régulations, des principes d’acceptabilité des discours et qui amènent à positionner les termes ou les concepts dans des réseaux de relation de pouvoir.
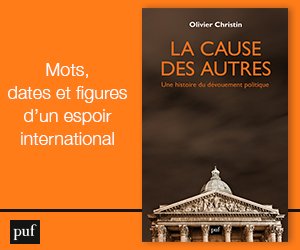
Un tel constat n’est certes pas nouveau, mais il est toujours utile et même impératif de prendre en compte ce champ de pratiques, puisqu’il limite la portée de nos pensées critiques à partir du moment où nos façons de fabriquer la science reproduisent ces milieux de socialité conceptuelle. C’est ce qui est constitutif de « la vie sociale des concepts » dépendante d’un contexte, celui de la science, et que l’on ne peut pas ignorer pour tenter d’évaluer la pertinence de nos analyses ou même d’imaginer d’autres milieux de déploiement de la pensée critique qui seraient plus à même de se défaire de pratiques épistémiques hégémoniques.
Pour alimenter cette perspective sur le plantationocène, sur l’extractivisme, sur la prédation, sur la pulsion d’accumulation, je voudrais, de manière un peu provocatrice, mais salvatrice je l’espère, poser la question de savoir si le principe moteur de l’extractivisme ne se retrouve pas d’une certaine façon, présent dans cet univers de fabrication de la science.
Notre cheminement se fera ainsi en deux temps : d’abord, il nous faudra revenir à la plantation ; ensuite, rejoindre le milieu qui pense la plantation, pour nous arrêter sur le paradoxe de la pensée critique en « système extractiviste », de la participation à la fois consentante et résistante à partir de la leçon offerte par les porteurs de cette expérience de la violence esclavagiste et post-esclavagiste.
L’esclavage est au fondement même de la modernité occidentale.
S’agissant de la plantation, l’idée qui nous guide ici est donc d’affirmer que le système plantationnaire serait le milieu matriciel de l’anthropocène, anthropocène dont l’espace limité de l’écriture me permet seulement de dire la charge critique qu’il appelle et que l’on identifie très bien au travers des néologismes formés à partir de lui tels, entre autres, « anglocène », « capitalocène » et « plantationocène »[1] : la dégradation de la planète n’est pas l’aboutissement d’un impact humain indifférencié mais de la mainmise des économies capitalistes sur la manière de gérer l’accès aux ressources.
Le système de plantation finit par nous dire à lui seul l’évidence de l’imposition – par une minorité humaine – d’un ordre d’exigences dévastatrices et inégalitaires. Dit autrement, la plantation esclavagiste est le foyer par excellence d’un commencement, ou plus exactement d’un basculement, et d’une maturation qui perdure, se cristallise et sature.
Commencement de quoi ? Le commencement d’une manière nouvelle de concevoir l’accès aux ressources et leur exploitation : la monoculture s’impose d’une telle manière qu’elle transforme les paysages en vaste champs de culture au détriment de la biodiversité. On parle « d’îles à sucre » pour les Antilles, qui sont l’exemple le plus poussé de cette exploitation totale de l’environnement, soumis dans sa quasi-totalité à cette logique de l’extraction.
Aucun système ne s’élabore sans les ruines de ceux qui les précèdent, et l’on pourrait tracer bien-évidemment une généalogie de ce capitalisme marchand d’exploitation qui se consacre entièrement à la production de denrées pour les marchés européens et au-delà. Mais il se joue « un événement » dans cette évolution, au sens d’une rupture d’avec les régimes précédents.
Le sociologue jamaïcain Orlando Patterson affirmait que le mot « société » ne pouvait pas s’appliquer à ces systèmes tellement leur finalité s’avérait exclusivement celle de la production[2]. L’exploitation des corps est consubstantielle de celle des ressources, ce que Malcom Ferdinand appelle « la double fracture de la modernité[3] ».
L’esclavage est effectivement au fondement même de la modernité occidentale, laquelle se met en marche véritablement aux Amériques, une matrice qui commence à peine à se dire pour ce qu’elle est, une exploitation sans précédent qui installe durablement la racialisation des rapports sociaux.
L’article de Thomas Piketty dans Le Monde après les événements du Capitole à Washington confirme cette venue à un dicible plus large et assuré dans la sphère occidentale : « Le système esclavagiste, dit-il, a joué un rôle central dans le développement des États-Unis, comme d’ailleurs du capitalisme industriel occidental dans son ensemble[4] ». Une lecture assez banale pour les spécialistes, mais qui jusqu’ici restait plutôt considérée comme radicale, parce que le savoir occidental continue de peiner à affronter la question de son soubassement.
Achille Mbembe a parfaitement établi le principe de consubstantialité à la base de l’extractivisme de la plantation, c’est-à-dire le binôme « corps humains-marchandises ». Le terme de fongibilité est venu récemment désigner ce binôme aux termes enchâssés pour mieux faire accéder à cette déshumanisation profonde qui accompagne la pulsion territoriale. Mbembe parle ainsi de « production de Nègres » en tant que « corps d’extraction », « c’est-à-dire de corps entièrement exposé à la volonté d’un maître et duquel l’on s’efforcera d’obtenir le maximum de rentabilité » [5].
La plantation, nous dit Edouard Glissant, est « un des ventres du monde », l’anomalie gigantesque comme exigence structurante de la modernité, dont autant la crise écocidaire que les rapports racialisés sont le prolongement direct dans nos actualités[6]. Le lien entre l’exploitation esclavagiste et notre monde contemporain, via l’industrialisation, a été postulée depuis longtemps dans des thèses d’économie historique comme celle, centrale, de l’historien trinidadien Éric Williams, toujours discutée plus de 75 ans après sa publication et qui affirme que l’esclavage a été la condition même de la révolution industrielle[7].
J’ai à cœur de mentionner ici les remarques de l’historien américain Greg Grandin, qui en 2015 déplorait qu’en dépit des nombreuses études sur l’esclavage, chaque génération semblait condamnée à prouver constamment l’évidence d’un énoncé jamais acquis, à savoir que « l’esclavage a créé le monde moderne, les divisions du monde moderne sont le produit de l’esclavage ». Il en déduisait ainsi que l’esclavage est à la fois la chose qui ne peut être transcendée mais aussi celle qui ne peut jamais faire l’objet d’une mémoire[8].
C’est en quelque sorte à partir de cette même appréhension d’une histoire et d’une mémoire condamnées à être tenues pour marginales, révolues, résiduelles, non essentielles que j’ai pour ma part accueilli la notion de « plantationocène » comme « révolutionnaire ». Je disais que « plantationnaire » avait préparé sa venue, dans la mesure où ce mot affirmait déjà la violence intrinsèque du système – le mot « déporté » pour les captifs africains apparaissait aussi à la même période, je dirais approximativement, au moins en France, au début des années 2000.
On reste cependant assez loin encore de la force du terme « plantationocène » créé par Ana Tsing et Donna Haraway en 2014 lors d’une discussion publiée plus tard[9]. Issu de la critique du terme anthropocène, il est capable de rétablir les connexions et se présente comme un formidable outil qui porte selon moi, à un niveau de conscientisation jamais atteint de ce qu’« esclavage » veut dire pour la modernité occidentale et de ses conséquences actuelles dramatiques, éminemment toxiques, dans les manières de conformer la terre, l’environnement, le vivant, la matière, à des projets imposés par une minorité historiquement blanche, « une petite coterie d’hommes blancs » comme dit Andréas Malm[10], avec cette urgence menaçante qui gouverne désormais l’ensemble de nos vies.
La plantation est véritablement matricielle d’un imaginaire dystopique incarné dans des principes d’exploitation maximale pour une accumulation voulue maximale. Un imaginaire à la longévité étonnante… Il faut insister sur la capacité de ce terme, « plantationocène », à faire bouger les lignes dans des milieux intellectuels et académiques plutôt français, enclins à trouver la pensée radicale et à la stigmatiser comme telle dès qu’elle aborde le débat sur l’esclavage, le colonialisme comme liés à la suprématie blanche occidentale.
La critique de l’anthropocène suscite ce « grand » retour sur la plantation, sans nécessairement faire usage du terme « plantationocène » mais en relisant, grâce à lui, l’histoire de ce que Kathryn Yusoff appelle une « géologie blanche », c’est-à-dire un récit anthropocénique qui « socialise la géologie et géologise le social », ceci pour ne pas perdre de vue que l’anthropocène ne peut pas désigner en définitive autre chose que la matrice d’où la modernité émerge à partir de l’inhumanité de l’esclavage et des millions de vie soumises à la violence de son système[11].
Les recherches que j’ai conduites à partir du milieu des années 1980 sur les paysanneries antillaises ont pris appui sur des travaux qui montraient déjà la coprésence des manières d’habiter la terre. Les ethnobotanistes présents dans les Antilles françaises, comme Jacques Barrau, Alice Peeters, Elisabeth Etifier-Chalono et d’autres encore, permettaient de contrer les interprétations dominantes, le plus souvent formulées par des géographes, sur la faiblesse des méthodes de cultures paysannes, leur peu de rentabilité, leur archaïsme présumé, tout ceci par comparaison avec la plantation souveraine tenue pour le modèle par excellence du progrès[12].
Le paysannat était pourtant l’une des expressions les plus achevées d’une culture complètement dévolue à s’extirper de l’univers de la plantation et ceci jusque dans sa manière de reproduire, par les usages agraires forgés dans un rapport intime à la terre, l’environnement forestier tenu pour être le lieu de la création du divin, un environnement aux équilibres sacrés.
Le paysannat prolongeait les aspirations des esclaves développées dans les marges si étroites du système esclavagiste. Les « jardins nègres » étaient ces espaces paradoxaux, contrôlés par le maître, qui les autorisait pour que l’esclave assure lui-même la reproduction de sa force de travail, mais qui contenaient un ferment émancipateur qui échappait au maître dans cette possibilité de nouer un lien vital à l’environnement[13].
Si j’avais à réécrire ces recherches aujourd’hui, nul doute que les termes qui ont jailli avec l’avènement anthropocénique serviraient à donner plus de force encore à la résistance obstinée qui a caractérisé la paysannerie antillaise. J’y verrai et j’y vois une culture du « contre-plantationocène », de la même manière qu’avec plusieurs auteurs nous avons pu parler avant cette arrivée du terme « plantationocène », de cultures du « contre » forgée au sein du système le plus coercitif de la modernité, « culture de la contre-plantation », « culture contre-hégémonique », « culture de la contre-modernité », « culture du contre-ordre », « culture du contre-habitus » [14].
Ce qu’apporte cette perspective sur le plantationocène, c’est l’installation d’une trame d’intelligibilité où les rapports de domination reconfigurent le projet de la modernité occidentale. On peut penser que ces rapports de domination désertent d’une certaine manière les études qui sont aujourd’hui associées aux « nouveaux matérialismes » basées sur le couple humain/non-humain. J’en viens donc rapidement au deuxième aspect de ce « témoignage » sur cette vie sociale des idées produite dans les milieux académiques.
Une suprématie académique blanche continue de considérer les peuples indigènes depuis les chaires universitaires occidentales.
Je me suis intéressée au cours de ces dernières années au nouveau paradigme de « l’humain/non-humain » parce qu’il me paraissait justement ignorer ces rapports de domination. Sous la figure tutélaire de Bruno Latour, ce paradigme déconstruit « la convention moderne », c’est-à-dire cette division du monde entre nature et culture qui légitime la prétention à contrôler les ressources[15]. Cette division est désormais vue comme illusoire, le vivant, le non-vivant, l’humain, le non-humain étant dans un réseau constant d’échanges de propriétés que les modernes s’évertueraient à camoufler.
Cette conception se satisfait selon moi d’une binarité certes déconstruite, mais qui ne prend pas en compte un troisième terme qui est celui de l’inhumain. Et l’inhumain, c’est précisément ce que produit la plantation. Ne pouvant détailler plus longuement cet argument dont je condense ici brièvement le sens, je me permets de renvoyer à d’autres écrits[16].
Je me limite seulement à suggérer que l’introduction dans le domaine des pratiques inhumaines amène à revoir de manière plus critique cette approche nouvelle de la modernité pour y déceler autre chose que la séparation nature/culture, cette ontologie que Descola a qualifié de « naturaliste » et que l’anthropologue ne veut pas traiter autrement que sur un plan d’équivalence avec les autres ontologies, autant dire en biffant les rapports de pouvoir[17].
Or, l’introduction de l’inhumain brouille en quelque sorte cette assise où il n’y aurait plus qu’à se tourner vers d’autres ontologies vues comme presque pures et purifiées – celles des peuples indigènes ou des communautés marronnes[18] et afro-descendantes en l’occurrence – et laisser ainsi vacant le champ des relations des pouvoirs.
Cette ontologie de la fabrication de l’inhumain, de l’animalisation de l’humain est absente de ces conceptions nouvelles, où seul le clivage nature/culture apparait opérationnel. Or, dans la plantation, c’est le principe de l’animalisation de l’humain et de sa brutalisation qui est à l’œuvre. Comment l’ignorer ? Dans ce cas, de quelle ontologie parlons-nous quand la modernité participe de la « dénaturation » de l’humain ? Où se situe ce fameux grand partage des modernes s’il absorbe l’humain pour le faire devenir animal, pour le dépouiller de son humanité ? Quel nom porte cette ontologie si particulière où ce qui est conçu comme « hors de l’humain », appartient pourtant à l’intériorité de l’humanité ?
L’animalisation de l’humain dans la plantation signe le retour des régimes d’autorité sous d’autres modalités que celles des politiques de la nature. Cette inhumanité dévoile une modernité qui fait évoluer le curseur de l’humain déshumanisé au gré de variations toujours dépendantes de rapports de domination.
Je m’associe à Judith Butler, qui continue de poser la question de savoir ce que c’est qu’être un être humain : « Qu’est-ce qui sera reconnu comme humain, comme sujet humain, discours humain, désir humain ? À quel prix, pour qui ?[19] ». Sur ce plan, ce sont les poètes et penseurs antillais, je pense ici à Césaire et Glissant, qui nous interpellent puissamment au travers de ce qui pourrait être nommé une poétique du « cri », une éthique du « cri » : une clameur qui s’élève pour dire « l’humain ». « Car, nous dit Glissant, la contrainte trois fois séculaire a tant pesé que lorsque cette parole a germé, elle a poussé en plein champ de la modernité, c’est-à-dire qu’elle s’est élevée pour tous. Il n’y a d’universalité que de cette sorte : quand de l’enclos particulier, la voix profonde crie[20] ».
C’est en cela que le plantationocène, ce concept un peu obscur, contient la possibilité d’entendre ce cri de l’humain et de porter un regard renouvelé sur des conceptions qui s’engouffrent sans retenue dans des chemins où ce cri d’humanité est à nouveau rendu silencieux.
Je pense ici à cet engouement pour des cosmovisions qui ne seraient utiles qu’à la démonstration de l’existence d’un grand « organisme vivant », exempt des divisions des modernes. Dans un article récent, au ton plutôt désenchanté, j’ai tenté de montrer comment se construisait ce nouveau paradigme associé aux « nouveaux matérialismes » qui veulent se défaire du clivage nature/culture pour investir sans modération les plurivers, les ontologies des autres[21].
Les principes de construction restent les mêmes que pour les paradigmes vainqueurs des années précédentes : poststructuralisme, cultural studies, postcolonialisme etc. Un vocabulaire, des références et le rejet de ce qui prévalait avant. C’est pour cette raison que l’on ne dit plus « nature » mais « extériorité », que l’on ne dit plus « culture » mais « ontologie », que l’on ne dit plus « construction sociale de la matérialité » mais « emmêlement de la matière et du vivant », le tout à partir d’un niveau de langage inaccessible hors des cercles initiés où le philosophe Gilles Deleuze est décidément indétrônable.
Quand l’anthropologue Viveiros de Castro propose d’adopter le point de vue des chamanes amazoniens, il le fait en définissant le projet anthropologique comme une enquête « sur les conditions d’autodétermination ontologique des collectifs étudiés[22] ». En quoi ce projet, qui s’associe à une contre-anthropologie, nous renvoie-t-il réellement à la subversion de l’institution occidentale de la science dans laquelle se développent ces démarches ? Quel rapport nouveau instaure l’anthropologie si elle continue d’être rendue conforme aux normes d’acceptabilité des milieux d’où sont absents ceux dont on parle et leurs univers de pensée ?
C’est sur ce plan qu’il me semble ne pas pouvoir/devoir être dupe de la présence de la pulsion extractiviste tapie dans nos institutions du savoir, s’accommodant de nos théories, aussi bien intentionnées soient-elles, aussi révolutionnaires soient-elles, réclamant même la nouveauté critique et subversive tandis qu’elle est la condition même de la reproduction de son hégémonie.
L’anthropologue Zoé Todd, d’origine inuit, après avoir écouté une conférence de Bruno Latour, a écrit un texte sans concession dont le titre résume le contenu : « l’ontologie est juste un autre mot pour “colonialisme” ». La face cachée du tournant ontologique, c’est pour elle celle d’une suprématie académique plutôt blanche qui continue de considérer, tout en les rendant le plus souvent absents, les peuples indigènes depuis les chaires universitaires occidentales et leurs ramifications dans les Suds[23].
Comment alors « faire politique avec et au-delà du texte » ? C’est la question que je souhaite poser à la vue de ces textes sur l’extractivisme, sur les prédations subies par les peuples indigènes ou afro-descendants, sur l’éloge des mondes plurivers où humains et non-humains se trouvent réconciliés, et bientôt sans doute sur le « plantationocène », textes qui s’empilent démesurément dans les revues internationales, qui se diffusent dans les colloques prestigieux, qui fournissent la matière à la starisation hiérarchisée des élites académiques, à la marchandisation amplifiée des savoirs, à la capitalisation de renommée et en conséquence, à la logique d’accumulation propre à la fabrication de l’édifice occidental du savoir. Dans cet édifice, les épistémologies alternatives, y compris décoloniales – qui réclament la « désacadémisation » comme le fait Felwine Sarr – prennent le risque continu d’être vampirisées et neutralisées[24].
Un espoir est contenu dans le formidable texte de Yala Kisukidi que je ne me lasse pas de citer et dont l’approche s’inscrit dans les philosophies africana. La philosophe s’y inquiète de la même manière de la capacité anthropophagique de la science. Elle parle pourtant de la part d’un savoir qui resterait indécolonisable, parce que lié à un « désir de philosophie » qui peut demeurer « intact » une fois débusqué le « corps du dominant ».
Ce désir-là pourrait être en mesure de distinguer deux bibliothèques constitutives de la philosophie occidentale, celle « qui n’est pas honteuse » et « qui prend en charge contre le pouvoir et les théologies, l’émancipation intellectuelle et politique du genre humain » et de l’autre, celle de l’abject et des « pages arrachées » par celui qui se trouve exclu de cette philosophie orgueilleuse ou « pris pour cible », « à la fois nègre, femme et enfant et beaucoup plus encore ». C’est cette possibilité de « désir de philosophie demeuré intact » que je retiens au final pour questionner notre possibilité d’agir par nos discours et nos savoirs sur cette pulsion extractiviste nichée au sein même des milieux où nous pensons la dénoncer.
Un entretien avec Christine Chivallon, conduit par Bérénice Gagne, a été publié dans le récent ouvrage coordonné par Michel Lussault et Valérie Disdier (éds), Néolithique Anthropocène. Dialogue autour des 12000 dernières années, Lyon, Édition deux-cent-cinq et École Urbaine de Lyon, 2021 (chapitre « Plantationocène. La culture de plantation, matrice de l’anthropocène », Christine Chivallon et Bérénice Gagne, pp. 73-83).
