La chanson du mal élu
« Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir »
Guillaume Apollinaire, 1913
45,3 % (1965), 37,5 % (1969), 43,8 % (1974), 43,2 % (1981), 43,8 % (1988), 39,4 % (1995), 62 % (2002), 42,7 % (2007), 39,1 % (2012), 43,6 % (2017).
Cette énumération austère retrace le pourcentage des voix, au regard des électeurs inscrits, que chaque président, élu sous la Ve République, a obtenu. C’est en effet l’indicateur le plus robuste, qui approche le plus le sens d’une élection : quelle proportion du corps électoral total celui qui prétend incarner l’institution présidentielle recueille-t-il au second tour ? Certes, si l’on pouvait inclure dans le calcul les non-inscrits, le total serait encore plus faible, mais, s’appuyer sur les inscrits (ce qui est rarement fait dans les commentaires politologiques) permet déjà d’y voir plus clair.
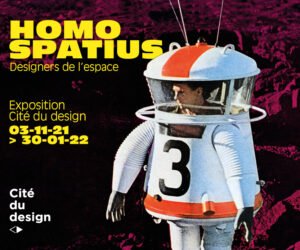
De Gaulle (1965) est au-dessus du lot ; quant aux autres, ils émargent entre 37,5 % (Pompidou 1969 : le PCF, alors à plus de 20 %, avait appelé à l’abstention) et plus de 43 % (Mitterrand 1988 et Macron 2017) ; mais 1988 et 2017 n’ont pas la même signification, tout comme les 62 % de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, qui n’ont rien d’un plébiscite (contrairement aux 65,9 % du referendum constitutionnel de 1958).
Derrière la rassurante similitude des chiffres – un président bien élu, ou assez bien élu – se cachent pourtant des réalités assez différentes, et les deux autres indicateurs, également fondés sur les rapports aux inscrits, donnent une coloration plus nuancée.
D’abord, le nombre de voix recueillies au premier tour par le futur élu dénote un affaissement de la confiance faite en première intention, à un homme.
De Gaulle est encore une nouvelle fois largement devant : 37,4 % des électeurs inscrits votent pour lui au premier tour. Quant aux autres, ils sont loin derrière, parfois très loin : Pompidou (34,6 %), VGE (27,2 %), Mitterrand 1981 (20,6 %), Mitterrand 1988 (27,2 %), Chirac 1995 (15,6 %), Chirac 2002 (13,7 %), Sarkozy (25,7 %), Hollande (22,3 %) et Macron (18,2 %).
Le troisième et dernier indicateur, celui qui renseigne les résultats des deux premiers arrivés en tête, donc des deux qualifiés pour le second tour, va dans le même sens : de 64 % (1965, De Gaulle-Mitterrand) et 63,3 % (1974, Giscard d’Estaing-Mitterrand) des inscrits, il est tombé à 25,4 % en 2002 (Chirac-Jean-Marie Le Pen) et à 34,3 % en 2017 (Macron-Marine Le Pen). Tout porte à croire que les deux premiers compétiteurs recueilleront moins de 30 % des suffrages des électeurs inscrits en 2022.
Ces indicateurs sont significatifs du rétrécissement de la base électorale de celui qui se doit ou se voit dépositaire d’une autorité, aussi vaste qu’indéterminée, et potentiellement impuissante. Un hyper-président ou un président jupitérien qui repose sur moins du quart du corps électoral en son nom propre (encore faudrait-il en déduire les « malgré nous » du vote utile) est inéluctablement coincé par ses oppositions multiples, bien qu’il soit tenté d’user et d’abuser des potentialités que lui offre une constitution d’abord conçue contre le fameux « régime des partis » de la IVe République et progressivement appropriée par le résident de l’Élysée qui peut se persuader qu’il peut plier la réalité à sa manière.
La majorité de l’Assemblée nationale, encore plus mal élue que lui (15,5 % des inscrits au premier tour pour les candidats LREM et Modem en 2017), doit suivre ses exigences, hors cohabitation, puisque c’est lui qui peut prétendre à la légitimité démocratique et c’est lui, et lui seul qui, en l’absence de partis fonctionnant collégialement sinon démocratiquement, peut distribuer un capital politique qu’il prétend monopoliser.
Mais, même dans cette configuration dite de « monarchie républicaine », il y a des contrepoids, voire des contre-feux, heureusement, qui contredisent cette volonté hégémonique : dans l’État, car la bureaucratie n’est jamais un automate, parmi les divers intermédiaires de la démocratie en actes (élus ou groupements volontaires), et dans les multiples stratégies adaptatives que nous inventons continûment et quotidiennement pour « nous en sortir ».
La campagne qui s’ouvre promet d’approfondir le hiatus grandissant existant entre la revendication d’un périmètre toujours plus large de la présidence et l’impuissance croissante, l’incapacité à pouvoir tenir des promesses indexées sur un assentiment de plus en plus limité. Et les ombres rampantes du Covid-19 risquent de perturber un peu plus les mobilisations électorales.
2022 confirmera cette chanson du mal élu qui est désormais consubstantielle à l’institution présidentielle hégémonique, reposant sur une prétendue remise de soi à un individu.
La démocratie est toujours peu ou prou censitaire.
De nombreuses ingénieries constitutionnelles se sont confrontées depuis la fondation de la Ve République et ses interprétations continuées, par les politiques eux-mêmes, les commentateurs et essayistes de la chose politique et les constitutionnalistes : démocratiser l’élection présidentielle en instaurant des parrainages citoyens (500 000 électeurs par exemple) ; passer au régime purement présidentiel ; réformer la profession politique ; retirer aux hommes politiques le pouvoir de s’auto-réguler ; s’attaquer au cumul des mandats ; rééquilibrer les pouvoirs du Parlement et transformer son fonctionnement ; inventer de nouvelles manières de voter, et de décompter les votes ; construire un statut et une réglementation des partis politiques ; instaurer des dispositifs multiples de démocratie citoyenne, ponctuels (conférence de citoyens, referendum d’initiative populaire) ou continus (chambre tirée au sort).
Il y a pourtant une mesure qui crève les yeux. Elle a été popularisée par certains prétendants qui voulaient instaurer une VIe République qui naîtrait d’une belle constituante : il s’agirait de supprimer l’élection du président de la République au suffrage universel direct. De temps à autre, elle revient dans le débat public, pour être souvent taxée d’historiquement régressive, de politiquement dangereuse, et de constitutionnellement impossible.
Oui, je sais, en démocratie les absents et les abstentionnistes ont toujours mathématiquement et politiquement tort. On ne considère, au bout du compte, que les suffrages exprimés et la grève, l’indifférence, l’effacement ou l’ignorance de nombreux inscrits, ou non-inscrits, n’intéressent que ceux qui multiplient les déplorations sur la crise, le désinvestissement, le désenchantement, la démobilisation ou la désillusion démocratique. La démocratie est toujours peu ou prou censitaire. L’assentiment y tient souvent lieu de consentement.
Oui, je sais ! Une partie non négligeable de la population française privilégie la clarté de la personnification voire la remise de soi, et de la France, entre les mains d’un vrai chef qui, contre les nains de la politique professionnelle, saurait montrer le chemin, et incarner le Peuple et la Nation.
Oui, Je sais ! Les objections sont dirimantes : élire son président directement est désormais un droit inaliénable des citoyens, c’est la formule la plus simple, la plus efficace, la plus légitimante et la plus démocratique, c’est l’élection préférée des Français. On départage des personnes sur lesquelles on peut se faire concrètement et corporellement, une opinion ou une impression, au travers d’une multiplicité de sources, des plus vérifiables aux plus erratiques. Le moment de la campagne présidentielle est la rencontre « d’un homme » (il conviendrait de dire désormais « d’une personne ») avec son pays, son peuple, et son destin.
Oui, je sais ! Un dirigeant unique, celui qui peut dire « je tranche », est plus à même d’être tenu pour personnellement responsable de décisions politiques ; et de devoir en assumer les conséquences, à portée d’engueulades (voyages et courriers présidentiels, réseaux sociaux), dans les cotes de popularité et les sondages, au cœur des mouvements sociaux les plus divers, et dans les échéances de (non-)réélection.
Oui, je sais ! Reporter sur d’autres élections, pluri-personnelles, la légitimation par les urnes des dirigeants politiques, risquerait d’être encore pire puisque, la fuite hors les isoloirs, est, jusqu’à ce jour, bien plus affirmée encore, dans toutes les élections, hormis l’élection présidentielle.
Pourtant, la vue de la campagne réduite à un hippodrome de sondages douteux, et la réalité de la pratique présidentielle impérieuse, en dépit d’un socle électoral de plus en plus restreint, friable et contestable, devrait nous inciter à ouvrir grand les portes des réformes. L’intelligence collective que l’on peut mobiliser dans de nombreux problèmes quotidiens, petits ou écrasants, pourrait bien être activée pour repenser l’équilibre général de la manière de pratiquer la politique en France.
2027 c’est très loin et très près. Est-ce trop tard pour éviter cette nouvelle cacophonie de la chanson du mal élu ?
