Critique d’une fantasy architecturale
L’hôtel actuellement en construction résulte de l’initiative de l’investisseur mosellan Yvon Gérard, qui invita il y a quelques années le designer Philippe Starck à concevoir un projet d’hôtel pour la ville. Il fut rejoint par d’autres investisseurs[1] réunis en un consortium finançant l’opération pour un budget de plus de 20 millions d’euros.
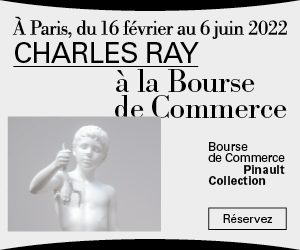
En 2015, sous les auspices de la municipalité et de la communauté d’agglomération, les premières images étaient présentées publiquement au Centre Pompidou-Metz, voisin du projet puisque l’hôtel se situe dans le « quartier de l’amphithéâtre », ancien quartier industriel puis terrain vague aménagé suite à l’implantation de l’antenne du musée parisien en 2010.
L’hôtel est une tour parallélépipédique, surmontée du pastiche d’une villa très cossue sise non loin de là, avenue Foch, et que le dossier de presse publié sur le site internet de Starck présente comme « une maison à l’architecture alsacienne typique du 18e siècle ». En réalité, la maison en question est une opulente demeure dessinée en 1903 par l’architecte Hermann-Eduard Heppe dans un style jouant de tous les « néo » en vogue à l’époque (néo-gothique, néo-alsacien, etc.) et située dans un quartier construit au tout début du XXe siècle, au moment où la ville appartenait à l’Empire allemand.
L’hôtel comprendra, outre les chambres, des restaurants, des bars, une salle de sport et un espace de « co-working » ; il sera exploité par le groupe Hilton, pour sa marque de luxe Curio Collection. Starck n’étant pas architecte, il s’est associé au cabinet mosellan d’Olivier Hein (Dynamo associés) pour le réaliser.
Entre-temps, la taille du bâtiment a été revue à la baisse – de quatorze à huit étages – et la façade entièrement vitrée qui devait caractériser la tour a été remplacée par un parallélépipède en béton ajouré de fenêtres avec, au sommet, le pastiche de la maison bourgeoise, lui aussi en béton. Avec ses deux toits pointus, perché au sommet de la tour de verre, ce dernier devait se transformer en une sorte de demeure féérique, comme on peut le voir dans la vidéo promotionnelle du projet, où l’ensemble de l’édifice, tout illuminé, trône au milieu des bois.
Sur le site internet dédié à la Maison Heler, Starck le définit comme une « architecture fantasmagorique hors-norme », « un jeu sur les racines déracinées, une construction symbolique de la Lorraine ». « Un hôtel est comme un film dont je serais le metteur en scène. », dit-il encore. « J’imagine le va et vient des gens, ce qu’ils vont vivre, ce qu’ils vont ressentir ». « Jeu », « fantasmagorie », les qualificatifs sont appropriés pour décrire le bâtiment en cours de construction et l’opération de communication publique qui l’accompagne, la municipalité voyant dans ce projet l’occasion d’allécher des touristes de l’autre bout du monde – « quand les Japonais sauront que Starck est à Metz ils viendront ici[2] », déclarait le président de la communauté d’agglomération – et de renforcer l’attractivité de la ville, moyennant sa transformation en une fiction.
Dans un texte écrit sur Central Parcs en 1996, l’anthropologue Marc Augé pointait déjà ce phénomène : « Il fut un temps où le réel se distinguait clairement de la fiction, où l’on pouvait se faire peur en se racontant des histoires mais en sachant qu’on les inventait, où l’on allait dans des lieux spécialisés et bien délimités (des parcs d’attractions, des foires, des théâtres, des cinémas) dans lesquels la fiction copiait le réel. De nos jours, insensiblement, c’est l’inverse qui est en train de se produire : le réel copie la fiction. Le moindre monument du plus petit village s’illumine pour ressembler à un décor[3]. »
Écrit en 1996, le texte est toujours d’actualité pour décrire la transformation des villes moyennes en décors, celles-ci usant et abusant de l’éclairage coloré[4] (c’est le cas à Metz), des mappings[5] toujours en vogue et des dispositifs vidéoludiques (signalétique urbaine, panneaux animés, etc.). Il faudrait y ajouter un phénomène plus récent : la mode de la fantasy, qui, ici et là, inspire aux municipalités – Avignon, Angers, Carcassonne et tant d’autres –, des projections lumineuses ou des décors inspirés de l’esthétique du film Le Seigneur des anneaux ou des univers pseudo-médiévaux de jeux comme World of Warcraft, et qui oblitèrent les édifices réels.
À Metz, l’hôtel de Starck ne dénotera probablement pas dans une ville qui essaie déjà de se donner un air ludique par des projections murales revisitant, sur le mode de la fantasy, un folklore plus ou moins réinventé : un mapping sur la cathédrale exploitait ainsi, en 2018, le « Graoully », ce dragon associé à saint Clément (le premier évêque de la ville) dans des chroniques locales depuis la fin du Moyen-Âge[6], devenu figure de proue du marketing municipal. C’est non seulement l’esthétique des parcs d’attraction, mais aussi celle des jeux vidéo que la ville réelle imite.
Dans les images de synthèse de la vidéo promotionnelle de Starck, sur un fond musical sirupeux, l’hôtel de luxe illuminé surplombe une grande forêt ; la réalité urbaine, celle qui entoure immédiatement l’édifice, a disparu. Elle peut disparaître en effet, puisqu’elle est subsumée dans le symbole de la maison au toit pointu. Prélevé au hasard, l’hôtel suffit à représenter la ville entière et à justifier un prétendu lien du nouveau bâtiment avec elle. À défaut d’un lien réel, matériel, formel – c’est-à-dire architectural – avec la ville, ce lien se trouve artificiellement recréé par un symbole censé la représenter[7].
La maison, qui fait vaguement « patrimoine local », peut devenir design à condition d’être rédimée par le luxe et d’être transformée en un symbole facilement reconnaissable – et consommable – dans une industrie culturelle globale : la maison féérique surélevée, que l’on trouve à la fois dans les parcs d’attractions, les dessins animés et les jeux vidéo, mais aussi la « maison sur le toit » qui renvoie dans le monde du luxe au penthouse réservé à quelques happy few et dont les déclinaisons sont multiples.
Que la villa cossue de l’avenue Foch, celle qui a « inspiré » Starck, soit tantôt qualifiée de « maison lorraine », « maison alsacienne », « maison bourgeoise du XVIIIe », « maison du XIXe » au gré des communications est significatif : la précision importe peu, puisque l’histoire doit faire image, symbole, design.
Le tissu urbain tangible est pourtant bien là, aux pieds de l’hôtel de Starck, et il n’est pas anodin que sa luxueuse « fantasmagorie » se trouve dans un lieu bien précis : à la jonction exacte entre un quartier populaire, regroupant barres d’immeubles et supermarché, et une nouvelle « zone d’aménagement concerté » (ZAC) qui a poussé sur l’ancien terrain vague – nettoyé de toute trace d’occupation industrielle antérieure – qui entourait encore le Centre Pompidou-Metz au moment de son inauguration en 2010[8]. Ce nouveau quartier comprend des logements neufs, un centre commercial chargé d’écrans et regroupant la plupart des grandes chaînes commerciales, un centre des congrès, des enseignes internationales.
Il semblerait que la Lorraine, dans un contexte de concurrence pour l’attractivité touristique, soit prête à se transformer en une fiction d’elle-même.
L’hôtel designé de Starck participera à cette transformation en cours, et peut-être, au petit « effet Bilbao » ardemment recherché par beaucoup de communes visant à panser les plaies du territoire par le marketing culturel. Il semblerait que la Lorraine, dans un contexte de concurrence pour l’attractivité touristique, soit prête à faire oublier son passé industriel et les quartiers populaires de ses villes, à se transformer en une fiction d’elle-même, en une fantasmagorie condensée ici dans la réplique d’une maison au toit pointu, extraite du sol, surélevée et illuminée au sommet de son monolithe, à mi-chemin entre Hansel et Gretel et les châteaux de Ludwig de Bavière.
La mise en lumières, en couleurs et en spectacle des lieux désaffectés de l’industrie était déjà en vogue dans la région : l’illumination colorée de deux anciennes usines, celle de Völklinger dans la Sarre et celle d’Uckange en Moselle – commande de l’État à Claude Lévêque – ont sans doute indiqué une voie.
Dans le cas de Metz, la petite fantasy de Starck est sans doute censée racheter la réputation austère de la ville – cité de garnison – et renforcer le déplacement de son centre de gravité vers le complexe musée-centre commercial-hôtel de luxe-centre des congrès. Le patrimoine militaire des quartiers historiques quant à lui, sauvé de justesse de la destruction, attend encore son réemploi.
Que l’on s’entende, pourtant : l’imaginaire est absolument nécessaire à la ville et à la vie sociale qui y est associée. Si la ville a toujours nourri l’invention artistique et littéraire, l’inverse est aussi vrai : on ne peut y concevoir d’intervention artistique, architecturale, urbanistique dans la ville sans imaginaire de la ville.
Habitante de Metz mais aussi professeur dans son école d’art, je ne peux qu’encourager les jeunes artistes, urbanistes, architectes et écrivains à faire travailler ce rapport.
Mais faire en sorte qu’une telle intervention ne provoque pas l’oblitération de la ville réelle suppose une claire conscience critique de ce qui distingue la fiction de l’imaginaire (associé à l’utopie). Dans un très beau livre, Lumières de l’utopie, l’historien de l’art polonais Bronislaw Baczko (1924-2016), spécialiste du XVIIIe siècle français, décrivait ce qui, dans la littérature de la seconde moitié de ce siècle, avait fait glisser la fantaisie et les voyages imaginaires vers l’utopie. Contrairement à la fiction, l’utopie est projection d’idées-images dans le présent et dans l’espace actuel, et notamment dans l’espace de la ville, qui devient le support d’une nouvelle imagination utopique.
Dans les voyages imaginaires fantaisistes, encore très nombreux dans la première moitié du XVIIIe siècle, la cité nouvelle est située dans le vide d’un ailleurs inventé. Le développement d’une imagination utopique dans la seconde moitié du siècle, dans la culture savante et dans la culture populaire, transforme au contraire les réalités sociale, historique et urbaine. L’imagination utopique ne relève plus de la rêverie fantastique, elle est transformation, dans le temps de l’histoire, des réalités actuelles.
Des projets tels que celui de l’hôtel de Metz sont symptomatiques d’une conception de l’urbain proche de celle que proposent les jeux informatiques pour adolescents.
On assiste aujourd’hui à un mouvement contraire, par lequel l’espace réel des villes se dissout dans une fiction, voire une fantasy. Pourtant, l’idée même de fantaisie est merveilleusement ambivalente. Nous héritons du romantisme allemand – de Novalis, de Jean Paul, des frères Schlegel, de Tieck – une théorie esthétique et une conception nouvelle de la Phantasie, qui ont fait passer la notion de production involontaire d’images par l’esprit à imagination productrice, poïétique[9].
Cette conception a fait naître en France, chez Victor Hugo, chez Gérard de Nerval, chez Charles Nodier, une nouvelle acception, esthétique, du mot « fantaisie ». Émancipée des images sensibles perçues, la Phantasie manifeste la souveraineté de la subjectivité[10], en conservant néanmoins un rapport privilégié avec le visuel : ses productions sont concrètes, et son pouvoir est celui de rendre plastique, comme en témoignent les relations qu’elle entretient avec la caricature, et avec le dessin en général comme projection d’une activité psychique.
Au XXe siècle, les dessins d’architecture de Lawrence Halprin, Lina Bo Bardi ou Giancarlo De Carlo, autant que leurs réalisations, témoignent exemplairement d’un véritable imaginaire de la ville et de la vie sociale qu’elle doit rendre possible. Des projets tels que celui de l’hôtel de Metz sont symptomatiques de l’appauvrissement de cet imaginaire, et d’une conception de l’urbain proche de celle que proposent les jeux informatiques pour adolescents, où ces derniers sont invités à construire ex nihilo, par juxtaposition d’éléments, des métropoles design ou des villas luxueuses parfaitement immatérielles.
Ce que de tels projets liquident est non seulement la mémoire urbaine, mais aussi la capacité de l’imagination à travailler la ville concrète et son histoire par une activité psychique subjective qui peut la transformer en des lieux précis, parfois avec une économie de moyens déconcertante.
Chez un designer comme Enzo Mari – non par hasard excellent dessinateur –, la fantaisie et le goût du jeu, associés à une très forte sensibilité aux volumes mais aussi aux matières, aux rythmes, aux couleurs, aux effets produits par la lumière dans un lieu concret, ont produit une remarquable aire de jeu pour enfants à Carrare en 1968.
Plus récemment, le collectif d’artistes, architectes et designers néerlandais Observatorium a livré plusieurs interventions témoignant d’une fantaisie de l’urbain articulée à une grande sensibilité plastique : Play Street (2003), aménagement des abords d’un centre de détention pour adolescents à Vught (Pays-Bas) préparé par une série d’ateliers de dessin et de construction impliquant détenus et jeunes apprentis de leur âge ; Zandwacht (2015), construction en béton beige sur l’extension artificielle du port de Rotterdam servant d’aire de jeu, de repos et de lecture et opérant une médiation visuelle entre les dunes de sable et la zone industrielle du port ; Warten auf den Fluss (2017), observatoire de bois habitable et déplaçable sur la bande de verdure qui sépare le canal Rhin-Herne du bassin industriel d’Essen.
Bien loin d’une fantasmagorie grandiloquente, ses interventions les plus réussies, notamment dans la Ruhr, réinvestissent les non-lieux désastreux de nos métropoles industrielles d’un imaginaire qui leur fait défaut et les rendent ainsi plus habitables, vivables, parcourables. La fantaisie, à défaut d’avoir la cohérence totalisante et constructive de l’utopie, permet au moins de l’entrevoir localement dans nos villes réelles.
Bénédicte Duvernay remercie Jean-François Chevrier, Anne-Sophie Duvernay, Giacomo Fuk, Adrien Malcor, Élia Pijollet, Stéphanie Sonnette et Océane Ragoucy pour leurs commentaires sur le texte.
