L’affaire Druet vs Cattelan : l’art est-il un travail ?
Depuis mai dernier, le procès opposant les artistes Daniel Druet et Maurizio Cattelan a été largement médiatisé. Si l’affaire se présente comme un cas exemplaire, c’est parce qu’elle oppose deux figures antithétiques, « l’artiste contemporain » à la renommée internationale, qui défend une posture dilettante, et « l’artiste-artisan » qui revendique un savoir-faire traditionnel. Le débat que l’affaire a suscité porte généralement sur la question de l’auteur de l’œuvre : est-ce la personne qui en a eu l’idée ou celle qui l’a réalisée ? Mais ce vieux débat s’inscrit dans un contexte particulier qui en rebat les cartes et devrait nous inciter à éviter tout choix binaire. Dans cet article, je voudrais replacer l’affaire dans un contexte où la frontière entre l’art et l’artisanat, et le travail en général, est interrogée par les artistes et les chercheur·ses, qui développent depuis quelques années des approches politiques et ethnographiques des pratiques artistiques contemporaines.
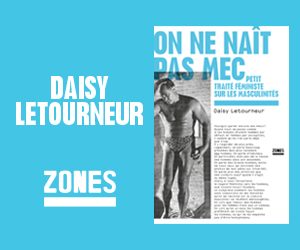
Résumé de l’affaire
Depuis un article de Pascale Nivelle dans M Le Magazine du Monde daté du 1er mai 2022, le monde de l’art contemporain français est secoué par une affaire qui oppose deux artistes. D’un côté, le célèbre artiste italien Maurizio Cattelan (né en 1960), représenté par la galerie Emmanuel Perrotin à Paris. De l’autre, un artiste français beaucoup moins connu, Daniel Druet. Né en 1941, ce dernier est un sculpteur formé à l’École des beaux-arts de Paris dans les années 1960, lauréat du prix de Rome en 1967 et en 1968, la plus haute récompense des institutions françaises dans les arts visuels, héritée du système de l’Académie, qui sera abolie par Malraux dans le sillage des événements de Mai 68.
Autant dire que Druet représente un artiste à l’ancienne, qui a reçu une formation académique et qui fabrique lui-même ses pièces dans son atelier de la banlieue parisienne. Il s’est spécialisé ensuite dans l’art sur commande, notamment des portraits en buste très réalistes. À partir de 1973, il devient le sculpteur officiel du Musée Grévin, musée populaire connu pour ses effigies de célébrités en cire. Druet réalise par exemple les sculptures de Charles de Gaulle, de Johnny Halliday, ou de Jean-Paul II.
C’est justement en voyant la statue de Jean-Paul II au Musée Grévin que Maurizio Cattelan décide de faire appel à Daniel Druet. Cattelan appartient à une tout autre catégorie d’artistes. Né en 1960, autodidacte, après plusieurs petits métiers il devient designer de meubles dans les années 1980 puis commence dans les années 1990 une carrière artistique marquée par une approche basée sur la provocation et une esthétique pop. Il devient mondialement célèbre en 1999 avec La Nona Ora, une statue du pape Jean-Paul II écrasé par une météorite, qui fait scandale. Il confirme son statut de star subversive de l’art contemporain en 2001 quand il expose Him, une statue d’Adolf Hitler en position de prière, qui là aussi suscite de nombreuses réactions.
Ces deux sculptures ont été réalisées par Daniel Druet, qui s’est fait payer en honoraires entre 17 000 et 33 000 euros pour chaque pièce, ainsi que d’autres réalisées pour Cattelan par la suite. Or, depuis, la cote de Cattelan s’est envolée, et ses œuvres, collectionnées notamment par François Pinault, se vendent aux enchères à des prix exorbitants. En 2016, Him a été adjugé à 17 millions d’euros. Mais le nom de Daniel Druet n’apparaît nulle part dans les expositions, les collections ou les ventes. En 2018, Druet intente un procès au galeriste de Cattelan, Emmanuel Perrotin, parce que, lors d’une exposition de Cattelan à La Monnaie de Paris en 2016 (musée également assigné en justice), non seulement le nom de Druet n’apparaissait pas dans les cartels des sculptures, mais le galeriste avait fait exécuter une copie de la statue d’Hitler par un autre sculpteur. Druet demande donc des dommages et intérêts pour contrefaçon et surtout il demande à être reconnu comme auteur exclusif des œuvres qu’il a réalisées. Le procès s’est ouvert le 13 mai dernier et la décision du tribunal a été rendue le 8 juillet.
L’argument de Druet pour s’attribuer la paternité des œuvres repose essentiellement sur l’idée que c’est lui, et lui seul, qui les a fabriquées. Sans lui, ces pièces n’existeraient tout simplement pas ; même, sans son talent, elles n’auraient pas connu un tel succès. Selon le sculpteur, c’est son étude de la psychologie des personnages, qu’il réussit à manifester dans leur visage, qui confère aux sculptures une puissance, une vitalité, sans lesquelles elles n’auraient aucun impact sur les spectateurs.
Du côté de Cattelan et de son galeriste, on affirme que l’idée est plus importante que l’exécution dans l’art contemporain. Druet n’est qu’un façonnier, un outil au service de Cattelan. Or un simple outil ne peut pas être considéré comme l’auteur de l’œuvre qu’il a contribué à fabriquer. La preuve, c’est que l’on peut très bien faire exécuter la sculpture par un autre : le résultat sera le même. Druet ne chercherait en fait qu’un peu de gloire et d’argent en profitant de Cattelan.
Dans une tribune parue dans Le Monde le 14 mai, un groupe de galeristes, d’artistes, de commissaires d’exposition et de critiques d’art réunis derrière Perrotin, qui se présentent comme des « défenseurs de la création contemporaine », vont même plus loin dans la défense de Cattelan. Si Druet gagnait, cela marquerait un retour en arrière de l’art qui serait confondu avec l’artisanat et même la fin de l’art contemporain, car la plupart des artistes actuel·les les plus connu·es, représentant·es du courant dit de « l’art conceptuel », pratiquent la délégation de la production : « Les œuvres d’art conceptuelles, en dissociant le corps (les mains qui façonnent) et l’esprit (l’idée de l’artiste, le concept véhiculé), ouvrent la voie à des expériences nouvelles et à des concepts inédits qui font le sel de la création contemporaine. » En définitive, les arguments de Druet seraient non seulement injustes mais réactionnaires : ils renverraient à une conception académique de l’art.
En somme, il ne s’agirait pas seulement de défendre la juste paternité de Cattelan sur son œuvre, mais l’art contemporain en général, face aux attaques dont celui-ci fait régulièrement l’objet par ignorance ou esprit réactionnaire.
Le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au galeriste Perrotin et à la Monnaie de Paris, décision prévisible. Les magistrats ont insisté sur « les directives de mise en scène des effigies de cire dans une configuration spécifique » (à savoir celle de l’exposition), qui relèvent des choix seuls de Cattelan et qui contribuent fortement « au contenu du message » des pièces exposées.
L’affaire a suscité énormément de réactions, aussi bien dans les quotidiens, la presse spécialisée, que sur les réseaux sociaux. Comme le souligne Ingrid Luquet-Gad dans son article paru le 13 mai dans Les Inrockuptibles, le reproche que Druet adresse à Cattelan, à savoir de ne pas reconnaître son travail, comporte une bonne dose d’ironie, puisque ce dernier a depuis ses débuts adopté une posture post-situationniste basée sur le refus du travail. Non seulement il revendique de ne rien savoir faire de ses dix doigts, mais certaines de ses pièces jouent sur l’imaginaire du vol, voire carrément de l’arnaque (comme son exposition « Another Fucking Readymade » de 1996, où il avait cambriolé le contenu d’une galerie en le faisant passer pour son œuvre, ou quand en 1999 il demande à son ami le commissaire d’exposition Massimiliano Gioni d’usurper son identité pendant un entretien avec un journaliste du New York Times qui n’y voit que du feu).
À cette époque, Cattelan passait pour un sympathique trublion, un « outsider paresseux contre les détenteur·rices du capital économique, social et culturel », David contre Goliath, comme l’écrit Luquet-Gad. Aujourd’hui, c’est plutôt Druet qui passerait pour le gentil David et Cattelan pour un méchant Goliath, tant la supériorité de sa renommée mondiale et de ses soutiens socio-professionnels est écrasante. Et il serait assez facile de dénoncer « l’imposture de l’art contemporain » dont l’artiste italien serait le représentant exemplaire, qui justement ravit les actuel·les « détenteur·rices du capital économique, social et culturel », dont le succès ne reposerait au fond que sur le caractère spectaculaire de sa production (au sens de Debord), sur la spéculation financière dont elle fait l’objet et sur un rapport douteux à l’éthique.
Si nous continuions dans cette direction, nous en viendrions immanquablement à accorder notre préférence au petit artiste français, dont l’humble posture artisanale appelle les valeurs de l’effort, du travail bien fait, du savoir de la main, dans lesquelles les lecteur·rices de William Morris ou de Matthew Crawford pourraient se reconnaître[1]. Mais aller dans ce sens pourrait justifier l’accusation inverse selon laquelle la position de Druet est rétrograde eu égard à la direction prise par l’histoire de l’art depuis au moins Marcel Duchamp. Comment faire pour sortir de cette alternative pénible ?
Parce que l’affaire Druet vs Cattelan se présente apparemment comme un choix binaire entre des postures, des manières de faire de l’art, des carrières, des valeurs que tout semble opposer, elle se prête aux prises de position tranchées dont, malheureusement, le débat médiatique sur l’art contemporain en France est trop coutumier. La question à laquelle le tribunal a répondu – qui est l’auteur de l’œuvre ? celui qui en a eu l’idée ou celui qui l’a exécutée ? – est sans doute fondamentale pour les artistes mêmes, mais, plus intéressant selon moi, elle se pose à un moment où bon nombre d’artistes et de chercheur·ses en sciences humaines et sociales se questionnent sur les modalités pratiques du travail artistique avec une finesse d’analyse et des propositions plastiques ou théoriques très riches. Autrement dit, mieux connaître ces recherches artistiques et scientifiques actuelles sur les relations entre l’art et le travail permettra de sortir de l’opposition simpliste entre l’art (conceptuel-contemporain) et l’artisanat (manuel-traditionnel) et de repenser de manière plus nuancée l’affaire Druet vs Cattelan.
Ethnologie des pratiques artistiques
Depuis une quinzaine d’années se sont développées des approches ethnographiques des pratiques artistiques contemporaines qui en renouvellent considérablement la compréhension. Dans le sillage de l’« anthropologie symétrique » promue par Bruno Latour, ces anthropologues appliquent les méthodes ethnographiques aux productions artistiques occidentales[2].
L’ethnométhodologie d’Harold Garfinkel peut ainsi servir à Yaël Kreplak pour observer de l’intérieur le travail des régisseurs dans les musées d’art contemporain et considérer qu’une œuvre d’art contemporain n’est ni simplement faite par l’artiste, ni même par le regard du public, mais aussi par les actrices et les acteurs du musée qui la stockent, la présentent, la restaurent et lui confèrent différents modes d’existence, du plus matériel (des objets à manipuler) au plus immatériel (des documents administratifs ou de médiation)[3]. Bref, d’une approche essentialiste de l’œuvre d’art qui se pose les questions de sa définition, de sa signification pour l’artiste ou pour le public, on passe ici à une approche pragmatiste qui tend à mettre en lumière les éléments matériels et les pratiques et les personnes souvent invisibilisées qui lui confèrent une existence « distribuée » en de multiples agents.
Inspiré par l’anthropologie des techniques d’André Leroi-Gourhan ou de Pierre Lemonnier, Arnaud Dubois étudie pour sa part comment on fabrique la couleur dans l’art contemporain, en suivant l’élaboration de projets artistiques depuis leur phase de conception jusqu’à leur présentation publique[4]. Ainsi, Dubois a pu reconstituer la « chaîne opératoire » de l’installation Excentrique(s) de Daniel Buren (2012) afin de montrer que derrière l’apparente simplicité de l’œuvre finale – des disques de couleur translucide montés sur des supports de métal – se cachent toute une série d’opérations, d’acteurs et d’entreprises au milieu desquels l’artiste a plus le rôle d’un réalisateur de cinéma que d’un démiurge isolé dans son atelier. L’effet chromatique de l’installation résulte moins des simples intentions esthétiques de Buren que des discussions et négociations qu’il a menées avec ses assistants, l’architecte, l’entreprise qui a fabriqué les disques colorés.
C’est également l’expérience de terrain au long cours dans l’atelier du peintre allemand Jonathan Meese qui a permis à Maxime Le Calvé de montrer qu’au-delà de la posture d’idiot provocateur que Meese adopte volontiers en public et que son travail semble exprimer, son atelier est organisé d’une main de fer par la mère de l’artiste de façon à rendre possible et performant le désordre créatif de l’artiste[5].
Une telle démarche appliquée au cas Cattelan montrerait probablement comment celui-ci, quoiqu’il en dise, travaille.
Ce genre d’approches ont été appliquées aux arts de la musique, du design, de l’architecture et au cinéma[6]. Elles nourrissent également l’histoire de l’art qui, parallèlement, s’intéresse de plus en plus aux processus de fabrication des œuvres. Le livre collectif Les Mots de la pratique dirigé par Christophe Viart réunit des textes de chercheuses et chercheurs qui analysent les relations entre les œuvres des artistes et leur discours sur leur propre pratique[7] ; Faire, faire faire, ne pas faire, dirigé par Ileanu Parvu, Jean-Marie Bolay, Bénédicte le Pimpec et Valérie Mavridorakis, est un recueil d’entretiens d’artistes dont la lecture est particulièrement stimulante pour contextualiser le cas Druet vs Cattelan, car on y voit que les pratiques de délégation de la production sont à la fois courantes et très différentes les unes des autres[8].
Le livre de Glenn Adamson et Julia Bryan-Wilson, Art in the Making, propose un panorama exceptionnellement riche des pratiques artistiques contemporaines, depuis la fabrication manuelle et individuelle jusqu’au crowdsourcing (fabrication déléguée au public), en passant par l’invention d’outils par les artistes ou les approches féministes des techniques[9]. La sélection d’artistes opérée par Adamson et Bryan-Wilson se démarque surtout par leur insistance sur les implications politiques, critiques et émancipatrices que les procédures adoptées par les artistes révèlent. Enfin, le recueil d’essais et d’entretiens Co-création, réunis par Céline Poulin et Marie Preston, avec la participation de Stéphanie Airaud, examine les pratiques collaboratives dans lesquelles l’artiste sort résolument de son rôle de démiurge solitaire ou délégant la réalisation à d’autres, et constituent les alternatives les plus radicales au mode de production mis en place par Cattelan[10].
La craftification de l’art contemporain
Le deuxième phénomène qui éclaire l’affaire Druet vs Cattelan concerne justement l’évolution récente des pratiques artistiques elles-mêmes. On assiste au développement de pratiques considérées jusqu’au début des années 2000 comme marginales, secondaires, voire ringardes, comme celles qui touchent aux arts textiles et à la céramique, dont la récente exposition au Musée d’art moderne de Paris, « Les Flammes » (commissariat d’Anne Dressen), a montré la prolifique extension. Ce que j’ai appelé ailleurs la « craftification » de l’art contemporain désigne la tendance actuelle chez beaucoup d’artistes à interroger, à franchir la frontière autrefois hermétique entre l’art et l’artisanat. Selon Glenn Adamson, le craft, qu’on ne peut pas traduire seulement par « artisanat », est une « attitude » et un « horizon », pas simplement un ensemble de pratiques manuelles expertes[11] ; c’est pourquoi il peut s’exporter au-delà des domaines qui lui sont traditionnellement attachés, comme les arts du feu, la bijouterie, la menuiserie, etc.
On ne compte plus les expositions qui mettent en valeur le travail manuel des artistes, en France ou ailleurs. À New York, actuellement, le Whitney Museum présente une version de sa collection permanente intitulée « Making Knowing : Craft in Art, 1950-2019 ». On redécouvre des artistes oublié·es (souvent des femmes), parce que jugé·es pendant longtemps trop éloigné·es du canon moderniste et du schéma chronologique conventionnel qui mène de Marcel Duchamp à Maurizio Cattelan, à l’instar de la sculptrice Valentine Schlegel, célèbre de son vivant pour ses céramiques géométrisantes et ses aménagements d’appartement faits à la main, puis oubliée pendant plusieurs décennies, avant d’être redécouverte par la jeune artiste Hélène Bertin qui organisa en 2017 plusieurs expositions remarquées sur son travail[12].
Autre pratique manuelle qui est revenue en force dans l’art contemporain, le bricolage, cet « art des pauvres » selon Michel de Certeau, connaît un essor d’autant plus frappant qu’il entre en écho avec le succès sociétal du do-it-yourself, qu’il s’agisse de tutoriels sur YouTube ou des makerspaces ouverts à tout public, sans parler des lieux militants et autonomes comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où le bricolage est quasiment un art de vivre et une nécessité, comme l’a montré par exemple Geneviève Pruvost. Les sociétés de bricoleur·ses sont des sociétés de pénurie, de débrouillardise où la grande majorité des individus cherchent à développer leur autonomie. C’est une société qui fait de la décroissance son mot d’ordre économique et de l’occasion son concept directeur, dans le double sens d’opportunité et de seconde main.
Au rebours des injonctions au progrès technologique qui passerait forcément par le développement du numérique, y compris dans les arts, les artistes-bricoleurs pratiquent le recyclage, le détournement, le « suédage » (pratique consistant originellement à tourner avec les moyens du bord le remake d’un film à gros budget) pour transformer la pénurie en poésie, comme le font les artistes de Kinshasa mis en lumière par Renaud Barret dans son film Système K. Dans un autre genre, l’artiste allemande Hito Steyerl bricole ses vidéos pourtant très sophistiquées à partir d’images « pauvres », de basse résolution, d’une part parce qu’elles sont libres de droit, et d’autre part parce que leur esthétique convient au discours critique qu’elle porte sur la société numérique. Quant à l’artiste africain-américain Theaster Gates, c’est tout un quartier abandonné de Chicago qu’il a réhabilité à partir de matériaux récupérés dans ses Dorchester Projects, pour en faire un lieu de partage et de vie commune pour les habitant·es qui y souffrent de la pauvreté et du racisme.
Les commissaires d’exposition ont bien compris l’intérêt du public pour les procédures que les artistes emploient, parce qu’elles font parfois écho avec celles qui se répandent dans la société. Pour preuve, il est rare dorénavant de voir une exposition monographique d’une certaine importance sans qu’un film montrant l’artiste dans son atelier, au travail, ne soit diffusé. En 2013, par exemple, la Fondation Cartier donnait à voir les sculptures hyperréalistes de l’Australien Ron Mueck et un documentaire sur l’artiste au travail par Gautier Deblonde. Quelques années plus tôt, François Montagut consacrait un documentaire à Daniel Druet, L’Ausculpteur (2009), dont le travail n’est pas sans parenté avec celui de Ron Mueck, bien que la réception de leur œuvre n’ait pas connu le même destin.
L’art comme travail
Enfin, beaucoup d’artistes plasticien·nes, surtout dans les jeunes générations, portent un discours politique sur le statut social de l’artiste aujourd’hui et préfèrent se désigner comme « travailleur » ou « travailleuse » de l’art, suivant le modèle des « travailleuses du sexe », mais surtout en s’inspirant du précédant de l’Art Workers Coalition étatsunienne quarante ans plus tôt[13]. En France, le mouvement a été lancé pendant les manifestations contre la réforme des retraites en 2018 sous le mot d’ordre « Art en grève » et s’est développé grâce à des collectifs comme La Buse ou le groupe Facebook Économie solidaire de l’art.
S’il s’agissait de manifester au départ la solidarité des jeunes artistes envers les Gilets jaunes et leurs revendications sociales et économiques, très vite le mouvement des travailleuses et travailleurs de l’art a développé un argumentaire spécifique concernant la grande précarité dans laquelle la majorité des artistes sont obligé·es de vivre. Contrairement à ce qui se passe dans le spectacle vivant, les artistes plasticien·nes n’ont pas le statut d’intermittent·es ; ils et elles sont très peu, voire pas payé·es quand ils et elles font une exposition, et sans vente de leurs pièces par leur galerie (qui prend 50 % en général du prix de vente) ou par leurs propres moyens, ils et elles n’ont pas droit au chômage, quand bien même ils et elles cotisent (beaucoup) auprès de l’URSAAF Limousin, une délocalisation récente qui a créé des embouteillages de réclamations non prises en compte.
Obligé·es bien souvent d’avoir un métier alimentaire à côté de leur pratique artistique, voire réduit·es à vivre du RSA, luttant pour les quelques ateliers municipaux disponibles ou se débrouillant pour en partager un, répondant sans cesse à des appels à projets et à résidence parfois au détriment de la cohérence de leur recherche, postulant à des prix hyper sélectifs, les artistes se considèrent comme des victimes du néolibéralisme et de la précarisation que celui-ci valorise sous les termes de compétition, de flexibilité et d’indépendance.
Dans le monde de l’art contemporain en France, les relations de travail que les artistes entretiennent avec les galeristes, les lieux d’exposition, les institutions, ne sont pas le plus souvent régies par des contrats, mais par divers dispositifs qui vont des notes d’honoraires aux droits d’auteur, de la relation de confiance à la poignée de main. L’absence de contrat entre Druet et Cattelan n’est pas une exception, c’est la règle. Selon un rapport d’activité de la Maison des artistes, qui gérait avant l’URSAAF leurs cotisations, plus de la moitié des travailleuses et travailleurs dans les arts graphiques et plastiques déclaraient en 2017 des revenus annuels inférieurs à 8 700 euros, et c’était encore plus le cas pour les femmes.
C’est pourquoi les collectifs de travailleuses et travailleurs de l’art militent pour une remise à plat aussi bien des pratiques du monde de l’art que du statut des artistes ; Aurélien Catin, un des membres de La Buse et auteur de l’essai Notre condition. Essai sur le salaire au travail artistique, paru en 2020, explique par exemple que les artistes devraient obtenir un statut équivalent à celui des intermittent·es du spectacle afin d’avoir au moins droit au chômage et se voir garantir une véritable autonomie économique et sociale, condition nécessaire à la liberté de création.
Plus récemment, il milite avec d’autres pour le salaire à vie, dans l’idée que si le travail de l’art n’est pas n’importe quel travail, c’est tout de même un travail, et que le combat politique que les artistes mènent pour un meilleur statut économique et social ne doit pas être distingué de celui qu’il faut mener pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs : le statut professionnel actuel des artistes, c’est l’avenir de celui de tous et toutes si les politiques néolibérales parviennent à leurs fins ; l’idéal artistique d’une activité librement choisie et indépendante des lois du marché, c’est celui que tout le monde peut embrasser.
Qui est le plus contemporain ?
Dans cette perspective, comment relire l’affaire Druet vs Cattelan ? La première conclusion, c’est que les pratiques de Druet et de Cattelan ne sont pas exceptionnelles. Il est aussi faux d’affirmer que l’artiste est toujours quelqu’un qui fabrique lui-même ses objets, que d’affirmer que ce n’est jamais le cas. En ce sens, les défenseur·ses de Cattelan ont tort de dire qu’attaquer ce dernier, c’est attaquer l’art contemporain dans son ensemble ; mais on ne peut pas dire non plus que seul Druet serait un artiste légitime parce qu’il fait lui-même ses statues.
Ce qui est en jeu dans cette affaire n’est donc peut-être pas de savoir qui est véritablement un artiste, puisque Druet et Cattelan le sont à leur manière, ni qui est l’auteur des œuvres en question, leur concepteur ou leur fabricant, puisque dans la chaîne opératoire mise en place par Cattelan, le rôle de Druet est seulement instrumental – ce que le tribunal a confirmé.
Or, précisément, l’analyse de cette chaîne opératoire au regard des recherches en anthropologie des techniques artistiques et des revendications actuelles portées par les jeunes artistes montre que c’est peut-être le mode de production de Cattelan qui paraît aujourd’hui daté. Loin de représenter « l’art contemporain » en général ou même l’art conceptuel, le travail de Cattelan est plutôt typique d’une génération d’artistes, de galeristes et de collectionneurs qui ont profité de la bulle spéculative autour de l’art dans les années 1990-2000 et de la starification d’une poignée d’artistes « subversifs ». Cattelan reproduit dans ses relations de travail avec Druet celles qu’on peut observer dans la production commerciale d’objets de luxe, comme dans le monde de la mode, c’est-à-dire une forme de production où des ouvriers aux savoir-faire experts sont invisibilisés par les concepteurs des produits, les « créateurs », dont le nom est fortement valorisé et qui jouent pleinement sur l’image de marque, comme l’a montré par exemple un numéro de Cash Investigation.
Bien que Daniel Druet appartienne à une plus ancienne génération encore, ses revendications s’inscrivent dans ce contexte où bon nombre de jeunes artistes se pensent comme des travailleur·euses de l’art et trouvent un écho favorable auprès d’elles et eux. Il ne s’agit pas néanmoins pour cette jeune génération d’en appeler systématiquement au retour de formes anciennes, mais de s’opposer aux effets délétères du néo-libéralisme dans le monde de l’art. Un exemple éloquent le montre : en 2016, la jeune artiste Aurore Le Duc avait réalisé une performance dans l’exposition Cattelan à La Monnaie, dans laquelle elle mimait les attitudes des supporters de foot, en portant une écharpe aux couleurs de l’artiste. Elle découvre un an plus tard que Cattelan commercialise lui-même des écharpes du même genre à travers le site Made in Catteland et les boutiques de différents musées. « Évidemment, il est assez grisant de se faire plagier par un artiste aussi connu que Maurizio Cattelan. C’est assez gratifiant pour mon ego d’artiste. Ceci dit, cela illustre aussi parfaitement le propos que j’essayais de démontrer en travaillant sur les rapports entre foot et marché de l’art. Avec les Supporters de Galeries, il s’agissait surtout de souligner les rapports de domination et la violence économique et symbolique inhérente au milieu artistique. On est en plein dedans là ! Il est en effet assez facile de copier une jeune artiste peu connue et précaire lorsque l’on est un poids lourd du marché et reconnu par les institutions depuis une trentaine d’années ! », explique-t-elle dans une interview.
Ce n’est pas tant la démarche de Cattelan qu’Aurore Le Duc critique ici avec humour et recul (puisqu’elle dit ailleurs travailler sur le fake et la copie), mais plutôt le fait que le monde de l’art est devenu un Far West où règne la loi du plus fort. Peut-être que les débats que l’affaire Druet vs Cattelan suscite inciteront les producteur·rices de l’art français à encourager des pratiques plus justes et à rendre plus transparentes les conditions matérielles de production des œuvres et toutes les personnes qui y contribuent : c’est le cas au cinéma, en musique ou dans le spectacle vivant ; pourquoi pas dans l’art contemporain ?
