Sortir des contradictions du collège
Depuis sa création en 1975, le collège unique cristallise les contradictions et les tensions du système scolaire français. René Haby affirmait que, tous les élèves y entrant désormais, le collège devait prolonger la vocation de l’école élémentaire commune jusqu’à l’âge de 16 ans, mais, au nom de « l’excellence pour tous », ce collège devrait aussi être le premier cycle du lycée « bourgeois » longtemps réservé aux seuls bons élèves. Le collège français est donc « génétiquement » contradictoire et la querelle opposant les tenants du « collège pour tous » à ceux du « collège pour chacun » ne s’est jamais éteinte.
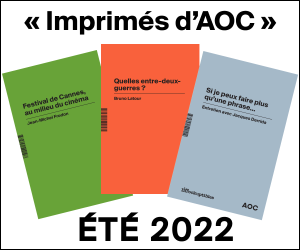
D’autres pays ont fait d’autres choix : les pays du Nord de l’Europe ont choisi l’école commune jusqu’à 16 ans, l’Allemagne a maintenu la sélection à l’entrée au gymnasium tout en développant un enseignement technique et professionnel de qualité. Selon les enquêtes de l’OCDE, pour les élèves âgés de 15 ans, la plupart des pays comparables obtiennent des résultats meilleurs et, surtout, moins inégalitaires qu’en France.
L’injonction paradoxale dominant le collège français a mis les enseignants dans une situation difficile puisqu’ils doivent adhérer aux ambitions de l’ancien lycée destiné aux meilleurs, tout en accueillant tous les élèves. Aussi avons-nous multiplié les dispositifs visant à réduire cette contradiction, sans que toutes ces mesures accumulées aient jamais véritablement démontré leur efficacité. Quoi qu’il en veuille, le collège unique trie les élèves, le tri scolaire étant aussi un tri social. En fait il s’agit d’un tri subtil mais terriblement efficace grâce à un mécanisme d’accumulation de « petites inégalités » qui s’agrègent au fil des scolarités pour aboutir à de grandes inégalités au terme des parcours scolaires.
La composition sociale des établissements joue un rôle décisif à travers le climat scolaire, les ambitions des enseignants et des parents, et le temps-même consacré aux apprentissages. Les inégalités se déploient aussi à
