Comment écrire l’anthropocène ?
Comment écrire l’anthropocène ? La question se pose désormais aux écrivains. À l’heure de l’évidence de l’emballement climatique, de la sixième extinction de masse et des désordres écologiques globaux, ne devrait-on pas se demander ce que la littérature en dit ? Or, poser cette question conduit immédiatement à s’apercevoir qu’elle n’en parle pas, ou très peu, ou très mal. Où sont les œuvres qui racontent le réchauffement de la planète, qui problématisent le déclin des espèces sauvages, qui mettent en perspective la mise en coupe réglée du vivant et donnent sens à ces catastrophes qui façonnent notre siècle ? Quelles formes avons-nous inventées pour faire face au changement du monde ?
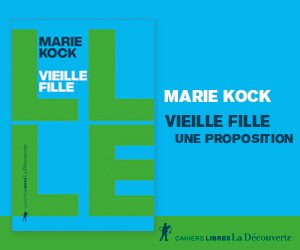
En posant ces questions, il ne s’agit pas de distribuer bons et mauvais points, ni aux écrivains, ni à leurs œuvres, mais d’interroger notre culture (occidentale, européenne et nord-américaine) et ses capacités à penser ce qui nous arrive. C’est pourquoi il importe de poser la question des formes dans lesquelles les bouleversements en cours peuvent se représenter. Les grandes formes littéraires que nous connaissons, le roman en particulier, sont-elles capables d’intégrer le monde qui vient ?
À cette question, l’écrivain indien Amitav Ghosh répond par une critique radicale : le roman moderne, dans son ensemble, repose sur l’expérience bourgeoise du monde et le type particulier de rationalité qu’elle a imposé à nos vies[1]. Marqué par un « réalisme » qui n’est autre que la traduction formelle de cette expérience, il ne sait exprimer que le quotidien, l’ordinaire, le probable, qui ne sont à leur tour que l’horizon d’attente d’une vie sans histoire. Toute mention du changement climatique suffit ainsi à exclure un roman de la « fiction sérieuse » et à le chasser dans les genres dévalués de l’« imaginaire » : hier gothique ou mélodrame, aujourd’hui horreur ou science-fiction.
C’est la conception même du réalisme inhérent à la « fiction sérieuse », c’est-à-dire aux genres légitimes, qui impose au roman un cadre spatio-temporel étriqué : un espace limité à celui qu’habite un petit nombre de personnages et une période qui excède rarement une vie humaine et s’étend au plus à quelques générations. Tout ce qui dépasse ces limites est irreprésentable dans les codes du roman. Or, pour penser les bouleversements de notre époque, n’a-t-on pas besoin d’autres échelles d’espace et de temps ?
C’est à peu de choses près le même constat que dresse, avec un autre vocabulaire théorique, le critique français Jean-Christophe Cavallin dans un livre inclassable[2], qui cherche à définir ce que peut être une « écologie du récit » en mêlant fragments d’autobiographie, théorie littéraire et réflexion anthropologique. Pour lui aussi, la littérature moderne se limite à raconter l’homme : l’individu, la société humaine dans laquelle il s’inscrit et éventuellement l’Homme en tant qu’espèce constituent les sujets et les horizons de nos fictions.
La raison symbolique du mythe est devenue le cauchemar de notre réalité.
Tout ce qui dépasse l’homme et que les cultures prémodernes symbolisaient à l’aide du mythe, des contes et des légendes, toutes formes qui apprivoisaient le monde, en est banni : le monde, devenu « environnement », s’est dépeuplé, et l’homme y règne seul. Où Ghosh réfléchit en termes de genres littéraires (le fantastique, la science-fiction, la fantasy comme alternatives au roman réaliste), Cavallin pense en termes anthropologiques (le mythe comme forme symbolique ancrée dans les pratiques sociales contre la fiction moderne coupée de la réalité).
Or, ce que l’anthropologie nous dit des mythes des « primitifs » peut être d’un grand intérêt précisément aujourd’hui. Dans le monde des animistes, peuplé de forces anthropomorphiques, les événements s’expliquent, non par une cause « naturelle », mais par l’intervention d’un esprit. Ironiquement, dans le monde moderne façonné par la raison, les causes naturelles disparaissent, c’est même le sens du mot « anthropocène » : nous avons appris que les catastrophes « naturelles » sont toutes causées par les hommes et nous accusons de nos maux les esprits nommés Mondialisation, Bureaucratie, Économie, Capitalisme, etc.
Nous n’attribuons plus aux tempêtes, cyclones, sécheresses, inondations et canicules des causes naturelles, mais nous les voyons comme des forces anthropiques qui se déchaînent, de sorte que le monde produit par la modernité ressemble à celui que voyaient les animistes : la raison symbolique du mythe est devenue le cauchemar de notre réalité. Puisque notre monde se met à ressembler à celui du mythe, peuplé de forces mystérieuses et immaîtrisables, la littérature ne devrait-elle pas retrouver les ressources de celui-ci pour apprivoiser les lieux où nous vivons ?
Cela expliquerait l’intérêt de notre époque pour la magie, le chamanisme, les puissances occultes et en général tout ce qui réinscrit des sujets dans ce que nous regardions hier encore comme la « nature ». L’œuvre d’Antoine Volodine, avec ses personnages qui voyagent dans leurs rêves, rencontrent des morts, se métamorphosent en animaux ou vivent quelques siècles, en est un exemple majeur en France.
Un autre exemple évident serait celui d’Alain Damasio : Les Furtifs repeuple la planète de créatures invisibles. Les personnages du roman apprennent à reconnaître dans les nuages, dans l’écume des vagues ou dans le sifflement du vent la présence des « furtifs », des animaux qui savent se rendre imperceptibles, mais qui interagissent sans cesse avec les humains, que ceux-ci s’en aperçoivent ou non. Avec cette invention science-fictionnelle, c’est un monde animiste que Damasio ressuscite.
Bien sûr, les lecteurs de Volodine et Damasio n’adhèrent pas au chamanisme et ne croient guère aux esprits. D’ailleurs, réinscrire des sujets dans l’indifférente « Nature » des modernes n’oblige à passer ni par la magie, ni par la science-fiction. Si une autre littérature est possible, une littérature en phase avec l’ordre, ou le désordre, du monde qui vient, elle peut emprunter d’autres codes et rendre au monde son agentivité sans le peupler de créatures imaginaires. Deux exemples récents, très différents l’un de l’autre, peuvent donner une idée de l’éventail des possibles : le roman d’Emmanuelle Salasc Hors gel et celui de Richard Powers L’Arbre-monde[3].
Avec le fatum, le roman retrouve l’art du suspense.
L’action du premier se passe dans les Alpes l’été 2056. Deux sœurs habitent une maison isolée dans la montagne, sous un glacier. Elles savent que le glacier, fragilisé par le réchauffement climatique, menace de s’effondrer et d’emporter leur maison dans sa chute, or elles ne peuvent pas quitter cette maison. L’action du roman concerne bien des êtres humains, elle se plie au code de lecture réaliste et, en apparence, nous sommes dans un roman ordinaire. Mais tout est surdéterminé par le suspens de cette menace. Le glacier fond : inévitablement, un jour, un morceau se détachera et déclenchera une catastrophe. Le désordre climatique est inscrit dans l’intrigue comme un fatum : l’élément tragique qui affirme que le réel dépasse l’horizon de toute expérience humaine. Il surdétermine les décisions des personnages comme un destin. Mais plus encore, il double toute l’action de sa temporalité propre.
Rien ne peut se faire sans y penser. Toute l’expérience en est comme détachée d’elle-même, mise à distance ou dédoublée : comme on doit garder prêt en toutes circonstances un kit de secours à emporter en cas d’évacuation, tous les gestes de la vie paraissent porter en doublure le temps du glacier. Celui-ci agit au moins au sens où il ne se laisse pas oublier : le temps de sa fonte, incommensurable avec celui de nos actes, s’y surimprime en permanence. L’action humaine s’en trouve curieusement altérée : elle paraît vaine ou arbitraire et surtout futile : ce que décident les personnages dont la vie est suspendue à l’imminence de la catastrophe semble de peu d’importance devant ce que fait la montagne. Mais du même coup, le roman lui-même est suspendu à un coup de théâtre qui se fait attendre : tout l’enjeu dramatique tient au retardement d’une alerte à la fois inéluctable et imprévisible. On sait qu’elle arrivera, mais on ne peut prévoir ni quand ni comment. Avec le fatum, le roman retrouve l’art du suspense.
Tout autre est l’art du feuilletage des temps de Richard Powers dans L’Arbre-monde, si ce n’est que lui aussi s’en tient au code réaliste. Rien n’emprunte au fantastique ni à la science-fiction, mais le livre entretisse aux vies humaines celles des arbres et des forêts en tâchant de rendre perceptible la différence d’échelle entre le temps des arbres et le temps des hommes. Tous ses personnages entretiennent avec les arbres une relation déterminante : la variété et la richesse de ces liens produisent à la fois l’idée d’une proximité fondamentale et d’une différence de vitesse telle qu’elle empêche le plus souvent de la percevoir. La grande force du roman est de réussir à entrelacer hommes et arbres dans la même histoire, l’overstory de son titre original, qui signifie canopée ou étage dominant d’une forêt, mais qui est aussi l’histoire qu’il raconte, une histoire qui se déploie et se ramifie dans le temps long et surplombe, accueille et abrite celle de chacun des personnages.
L’un d’eux a hérité d’un album de photographies particulier. Son arrière-arrière-arrière-grand-père, immigrant et pionnier, venu de la côte Est fonder une ferme dans l’Iowa, y a planté au début du XIXe siècle six châtaigniers, dont un a survécu et a été photographié du même point chaque mois depuis. La tradition familiale a permis que se constitue ainsi une collection de près de deux mille clichés qui, feuilletée comme un flip-book, donne à voir la croissance de l’arbre en accéléré ou, selon la formule du roman, « adapte sa vitesse au désir humain ». Cette collection résume l’ambition du livre : relier le temps court d’une vie humaine au temps long des arbres et des forêts. Le personnage qui en hérite devient artiste pour avoir été fasciné enfant par le « film magique » du développement du châtaignier, de l’arbrisseau photographié par son ancêtre au « géant » qu’il apprend à dessiner.
Mieux encore, le destin singulier de l’artiste et celui de l’arbre se font écho. Le châtaignier d’Amérique, jadis commun sur la côte Est des Etats-Unis, a en effet disparu dans la première moitié du XXe siècle, attaqué par un champignon d’origine chinoise débarqué à New York grâce au commerce mondialisé. L’arbre photographié a été sauvé de l’épidémie par les milliers de kilomètres mis entre ses congénères et lui par l’ancêtre qui l’avait planté. Le destin de l’arbre, présenté comme l’unique survivant de son espèce est donc aussi singulier que celui du descendant de paysans, orphelin devenu artiste : tous deux, fruits de déplacements improbables, sont solitaires, derniers de leur lignée, échappant au temps, l’un rescapé d’une maladie qui a éradiqué tous les siens, l’autre immortalisant les arbres en les dessinant. Le dernier châtaignier et le dernier fils, alliés l’un à l’autre, comme ils peuvent, chacun avec ses moyens propres. Une façon romanesque de récupérer le temps du mythe dans un récit d’aujourd’hui et de donner sens à notre présence sur la planète, de nous réinscrire dans un monde vivant, connaissant d’autres modes de perception et d’autres temporalités que les nôtres.
Les mythes, écrit Powers, rapportent des « souvenirs réexpédiés depuis les rivages de la grande migration humaine hors de tout le vivant ». Ce sont des « télégrammes d’adieu rédigés par les sceptiques de ce projet d’évasion, qui disent : Souvenez-vous de ça, dans des millénaires, quand vous ne verrez que vous-mêmes partout autour de vous[4]. » Son roman, ainsi que quelques autres, prouve qu’est possible une littérature qui retrouve la puissance de peuplement du mythe, nous aide à apprivoiser les lieux de notre solitude humaine en nous réinscrivant dans un espace vaste et un temps qui nous dépasse : une autre littérature, qui nous excède et nous fasse sortir de nous-mêmes.
