L’obsolescence du handicap : pour aller au-delà de l’injonction inclusive
Peut-on imposer l’inclusion sociale ou s’impose-t-elle socialement d’elle-même ? La publication récente de l’ouvrage, S’affranchir du concept de handicap : critique constructive d’une notion obsolète, interroge cette notion dans ses acceptions institutionnelles et médico-sociales. Car « si certains souffrent d’être malades et relèvent assurément de la médecine, d’autres sont malades de souffrir et leur orientation vers des lieux de soins classiques est plus discutable »[1]. L’inclusion pourrait remédier à cette souffrance, mais paradoxalement, sa racine latine (inclusio) renvoie à l’enfermement : « Que ce terme soit utilisé pour chanter les louanges d’une société ouverte et tolérante laisse songeur »[2].
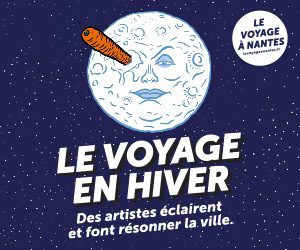
L’inclusion garantit à tous, sans distinction aucune, des conditions sociétales, sociales, d’accessibilité et d’usage équitables. Elle s’applique à l’ensemble des domaines de la société, et les pouvoirs publics en ont fait leur sacerdoce en réponse à l’exclusion sociale : celle des personnes marginalisées par leur situation (précarité) ou leur état de santé (handicap, vulnérabilité, dépendance) et ne correspondant pas au modèle dominant.
À l’instar des politiques publiques, les institutions de l’éducation, de la santé et de l’insertion sont particulièrement concernées par l’approche inclusive mais l’application de ses préceptes génère parfois des débats houleux. En septembre 2022, le Comité des droits des personnes handicapées du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU a publié les résultats d’une enquête incluant 500 personnes institutionnalisées. Les conditions d’institutionnalisation dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont jugées inacceptables pour l’accueil des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité : elles entravent le pouvoir d’agir et de choisir des résidents, leur imposent de partager leur lieu de vie avec d’autres personnes, des routines rigide indépendamment de la volontés et des préférences personnelles, des activités identiques et une surveillance des conditions de vie, font preuve de concentrationnisme par le nombre disproportionné de personnes handicapées dans un même lieu, et engendrent une forme de soumission des personnes à un système « paternaliste ».
Sur la base de cette enquête, le Comité s’est prononcé en faveur d’une désinstitutionalisation massive, notamment celle du secteur médico-social, considérant qu’il fallait mettre un « terme à toute forme d’institutionnalisation, d’isolement ou de ségrégation » et « reconnaître dans la loi que l’institutionnalisation fondée sur le handicap [ou la dépendance liée au vieillissement] représente une forme prohibée de discrimination ». Cela laisse supposer que l’origine de ce constat réside seulement dans l’institutionnalisation et l’organisation qui lui est inhérente, sans toutefois interroger les notions de handicap ou de dépendance auxquelles elle répond. S’il reste néanmoins vrai que le fonctionnement des ESMS tend à s’appuyer sur des schémas organisationnels protocolaires et stigmatisant partant des modes de financement de la dépendance[3], on ne peut leur attribuer tous les torts.
L’approche inclusive est porteuse d’une conception du handicap et de la dépendance qui s’inspire d’une vision d’autonomie, de participation sociale et de citoyenneté pour tous. Elle rompt fondamentalement avec le cadre de fonctionnement actuel des ESMS régie par une économie et une gestion découlant de « normes » d’autonomie arbitraires. Concrètement, il ne s’agit pas d’encourager la fermeture des ESMS dont on ne peut pas ignorer la nécessité pour certaines situations, mais d’amorcer une réflexion pratique sur l’accompagnement quotidien de ses usagers. C’est le regard sociétal et l’action sociale dans sa globalité qu’il convient de transformer pour permettre aux institutions sociales et médico-sociales d’aborder le handicap et la dépendance sous un jour différent que celui qui se fonde uniquement sur des déficiences auxquelles il faudrait remédier. L’inclusion suppose l’acceptation de la différence par une démarche d’accompagnement fondée sur la preuve et ancrée dans le prendre soin pour dépasser une injonction relevant de préceptes conceptuels dont la transcription administrative a pris un pli quelque peu technocratique.
Le prisme du grand-âge
L’accompagnement des personnes âgées dites « dépendantes » avec et sans troubles cognitifs, est particulièrement intéressant pour illustrer la problématique de l’inclusion et des situations de handicap car elles subissent une double peine : l’âgisme et le validisme (ou capacitisme). Le devenir de « nos vieux » est au cœur des débats politiques actuels : une mission a récemment été confiée à la Fabrique du Bien Vieillir. La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec le laboratoire des solutions de demain, travaillent activement pour améliorer le regard sociétal, l’habitat et les conditions d’accompagnement des personnes âgées.
Les travaux actuels sur l’habitat et l’accompagnement des personnes âgées dites « dépendantes » peinent toutefois à sortir d’une dichotomie opposant illusoirement « lieux de vie » et « lieu de soin ». Ils montrent la difficulté de se détacher d’une représentation pathologique du vieillissement se focalisant sur les moyens techniques et humains, sans toujours tenir compte des objectifs et de la raison sociale qu’ils servent : un accompagnement respectueux de chaque individu. Dans le cas d’une fleur qui n’éclot pas, on ne cherche pas à corriger la fleur mais son biotope afin qu’elle puisse s’épanouir. Il s’agit en fait de trouver le juste équilibre entre lieux de vie et de soins en ajustant les ressources humaines, l’organisation et l’architecture au plus près de chaque situation et de chaque territoire pour garantir les droits, la qualité de vie et le bien-être des résidents.
L’insti-clusion : mirage ou eldorado ?
Depuis le début des années 2000, l’« inclusion » est la norme au niveau européen et national pour lutter contre les inégalités sociales et promouvoir l’autonomie des personnes. L’injonction inclusive des pouvoirs publics provoque toutefois de nombreux débats sur les missions qui sont confiées aux ESMS dans ce cadre : « Inclure, ce n’est pas accepter l’autre dans sa pure différence sans autre forme de procès, c’est définir […] un terrain de coexistence. […] Ainsi tous ceux qui aujourd’hui […] se voient confier la responsabilité d’inclure davantage […] acquièrent dans le même temps un pouvoir, celui d’assigner, de délimiter un cadre. ». S’il est aujourd’hui indiscutable qu’il existe un besoin en soins important et spécialisé dans les ESMS et qu’il est nécessaire pour ses usagers, il ne faut pas perdre de vue le prisme des bénéficiaires dont le temps des soins médicaux quotidiens se limite à plusieurs dizaines de minutes en moyenne. Ainsi, la conjonction des moyens sociaux et médicaux, tous deux indispensables et indissociables, servent un objectif commun : le bien-être et la qualité de vie des personnes.
Quelle que soit le projet institutionnel d’un ESMS, sa désignation sur la seule base des caractéristiques des usagers auxquels il se destine engendre nécessairement un risque de stigmatisation, voire de ségrégation. Qu’il s’agisse de Foyer d’Accueil Médicalisés, d’EHPAD, ou d’Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique, on se fait tous une représentation des usagers fréquentant ces lieux qui est souvent partagée par les usagers eux-mêmes. Les soignants sont fréquemment les témoins de personnes primo-entrantes en EHPAD qui leur font observer que les autres personnes qui y résident sont « vieilles » et « grabataires ». Un préjudice qui se répercute sur l’identité, l’estime de soi, le statut, la citoyenneté et en conséquence, les représentations que l’on se fait de ces personnes, pour se répercuter, en miroir, sur la représentation que se font les personnes d’elles-mêmes. Ces constats invitent notamment à repenser la manière d’aborder la différence dans le cadre législatif de la dépendance3 et des actions conduites en faveur des personnes considérées comme dépendantes, que ce soit sur le plan social, biomédical ou psychologique. Ils invitent ainsi à réinterroger l’approche prescrite par les différents ESMS pour accompagner le quotidien les personnes en situation de handicap, quelles que soient la nature et la cause de celui-ci et l’âge des individus.
Les ESMS, par leur nature, entretiennent un équilibre fragile avec l’inclusion : on peut parler d’intégration, tout au plus, selon les conditions que l’on observe. Ce sont surtout leurs usagers qui s’adaptent au fonctionnement et aux normes de l’institution et de la société. Or, l’inclusion, pour qu’elle se manifeste en ESMS, doit se concevoir autrement que par un mouvement agoniste ou antagoniste de l’adaptation individu-institution. Elle aborde le cadre de vie dans sa globalité en vue d’habileter ses usagers, au sens d’inciter à exprimer ses habiletés, pour leur permettre d’exercer leurs aptitudes autant que possible en vue de gérer leur vie, de favoriser leur équilibre occupationnel, de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Elle engage surtout une interdépendance entre l’effecteur du prendre soin et plus largement du care (qu’il s’agisse de l’institution sociale et médico-sociale ou des professionnels qui y exercent) et son récepteur.
Le paradoxe du care
On ne peut envisager de dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement inclusifs sans relation de care. La « sollicitude », « l’attention », « le soin », « le souci de l’autre » : ces mots dont nous avons tous été et dont nous pouvons tous être les attributaires, font du care un concept qui nous rappelle combien nous sommes vulnérables et potentiellement « dépendants ». Son éthique porte une attention particulière sur ceux dont la responsabilité est de prendre soin de nous par « leur présence attentive, [les] efforts qu’ils déploient pour répondre à nos besoins»[4]. Car, l’intérêt du care réside aussi dans l’interrelation et l’adéquation qui existent entre l’effecteur du prendre soin et son récepteur. Il appartient aux protagonistes d’émettre ou de recevoir cette attention et de la rendre en échange, ils sont acteurs de la transaction qui s’opère entre eux. Cette transaction est invisible, non quantifiable, non organisée, mais c’est pourtant celle qu’il convient de valoriser. Dans le quotidien du care en institution, ce sont les auxiliaires de vie, les soignants, les travailleurs sociaux que l’on doit mettre à l’honneur : ils sont la clé de voûte des ESMS.
Le Mimikaki, cette pratique japonaise qui consiste à prendre du plaisir à se faire soigner les oreilles par une personne désireuse ou payée pour le faire, illustre merveilleusement bien la relation de care. En effet, dans son acception fondamentale, la philosophe Joan Tronto distingue deux types de relations de care se différenciant par des positions de pouvoir asymétriques. Le care nécessaire, celui que l’on ne peut se donner à soi-même et qui nécessite l’attention d’une autre personne : le « prendre soin » dont le bénéficiaire ne peut se passer attribuant de fait un « pouvoir » à l’effecteur. Et le care que l’on acquiert par un service contre rémunération mais dont on pourrait se passer qui, à l’inverse, attribue un pouvoir au récepteur par la prestation dont il bénéficiera de l’effecteur et la satisfaction qu’il en tirera.
Cependant, ces positions de pouvoir asymétriques amènent deux hypothèses enracinant le care en ESMS dans un paradoxe. Une première hypothèse part du principe que les ESMS fonctionnent de façon concomitante et antagoniste sur ces pouvoirs asymétriques. Il entraîne alors inévitablement une double asymétrie situant le care entre sollicitude et offre de service, et plaçant les professionnels dans une position quasi-contradictoire dans l’exercice de leur fonction. Celle-ci n’est pas sans rappeler le paradoxe qu’incarne Klara (l’amie artificielle – une humanoïde – achetée dans un magasin pour divertir et s’occuper de Josie, une enfant malade) du Prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro, faisant d’elle une figure humaine discréditée de toute relation empathique. La seconde hypothèse part du postulat que les usagers ne savent pas nécessairement d’où provient l’argent public qui sert à payer une partie des prestations dont ils bénéficient : Qui paie ? Comment l’argent transite-t-il vers les ESMS ? Cette méconnaissance retirerait ainsi toute possibilité de « relation client », toute attente envers l’institution et les professionnels y travaillant. Elle court-circuite, ainsi, la relation de care dans ses éléments les plus fondamentaux. En tout état de cause, ces paradoxes déléguant les pouvoirs de la personne « soignée » à l’institution et aux familles fragilisent la relation de care au sens du prendre soin et l’interdépendance.
Au-delà du travail technique bien fait, ce qui est véritablement valorisé dans le care est bien le prestige d’une relation humaine privilégiée. Or, pour en découdre avec ce paradoxe, il faudrait pouvoir envisager le care et l’assumer avec une certaine modularité, en fonction des personnes à qui il se destine et qui sont impliquées dans les interrelations qu’il engendre. Modularité qui permettrait aux professionnels du prendre soin d’infléchir l’exercice de leur profession par des principes démocratiques respectant les valeurs et les droits des bénéficiaires, en les faisant participer à leur care.
Un care démocratique : contour d’une approche habiletante
Le fait de dépendre d’autrui pour effectuer les actes de la vie quotidienne questionne forcément sur le respect des valeurs démocratiques des personnes en situation de handicap. « Être étiqueté comme dépendant [dont la catégorisation se réfère quasi-exclusivement aux personnes très âgées[5]] revient à être exclu au moins symboliquement de la participation à la vie sociale, faute de pouvoir prétendre à quelque utilité sociale que ce soit ». Ainsi, la citoyenneté peut se trouver entachée par les standards de la dépendance qui se fondent sur ceux d’une « normalité » fonctionnelle de laquelle sont soustraites les aptitudes défaillantes. Comme précisé plus avant, la différence issue de cette évaluation ouvrira des droits à une aide personnalisée à l’autonomie. Cette approche, sans en dévaluer ses apports pour la médicalisation des ESMS, s’inscrit dans une logique compensatoire ne se souciant qu’à la marge des aptitudes que possèdent et peuvent développer les personnes concernées pour faire-face d’elles-mêmes à leurs propres besoins. Elle ancre d’emblée la personne dans une position de dépendance vis-à-vis d’un système de soin.
Penser l’accompagnement des personnes « vulnérables » ou « dépendantes » sous l’angle des compétences plutôt que des dépendances en vue de leur permettre de s’épanouir, comme le propose l’approche habiletante, pourrait paraître comme allant de soi. Cette position, loin d’être unanime, est d’autant plus importante en ESMS que l’individu qui y est accueilli n’est ni objet, ni sujet de soin : il n’est soumis à aucune autorité. Il est en droit de refuser un soin ou un « prendre soin », il est ainsi acteur à la fois de son soin et de son accompagnement. Qu’il s’agisse d’une déficience innée ou acquise, liée à l’âge, une maladie ou un accident de vie, l’intérêt d’une telle approche est de permettre autant que faire se peut aux bénéficiaires du care de vivre leur vie comme ils l’entendent, selon les besoins qu’ils ont identifiés et les aspirations qui les animent.
Beaucoup de témoignages de personnes atteintes d’une maladie chronique ou en situation de handicap font part de la manière dont elles mobilisent leurs habiletés pour y faire-face avec les particularités qui les caractérisent. Elles apprennent à « vivre en relative bonne intelligence avec la maladie ». Mais, cela enjoint d’évaluer chaque situation au cas par cas, de prendre en considération les habiletés de chacun pour vivre le quotidien de façon aussi indépendante que possible et faire faire un pas de côté aux standards avilissants de la seule évaluation de la dépendance.
Prendre soin du cadre de vie
Les expérimentations portant les valeurs d’une approche habiletante, se fondant notamment sur les conditions normales de la vie quotidienne et culturelle, se sont considérablement développées ces 20 dernières années. Elles témoignent de la témérité des acteurs du champ médico-social. Ces expérimentations prônent généralement une approche se fondant sur une connaissance intime des personnes accompagnées, en explorant leurs compétences, leurs talents, leurs aptitudes. Elles prennent différentes formes allant de mode vie domiciliaire, de séjours extra-institutionnels, de visites culturelles, ou encore de résidences artistiques, pour n’en citer que quelques-unes.
Une directrice d’établissement témoignait, sur le ton de l’ironie, que le programme d’intervention dispensé pour l’unité de vie Alzheimer de son établissement lui posait des problèmes d’organisation : les résidents y restaient plus longtemps, augmentant ainsi les délais d’attente d’autres résidents souhaitant l’intégrer. Elle laissait surtout entendre que les nouvelles conditions d’accompagnement amélioraient la qualité de vie des résidents et, consécutivement, augmentaient leur espérance de vie au sein de l’unité. On s’étonne encore et toujours de l’impact structurant et positif des modes d’accompagnement innovants sur les personnes accompagnées. Pourtant, le cadre de vie, qu’il soit social, culturel ou physique, prend toute son importance dans le care et on ne peut qu’encourager la multiplication de ces initiatives.
Ces modes d’accompagnements innovants demandent un effort d’adaptation et de formation considérable des professionnels qui les mettent en œuvre pour s’ajuster au rythme et au cadre de référence des personnes accompagnées. Ils nécessitent parfois des moyens complémentaires, mais ils démontrent surtout que se fonder sur les préférences et les habiletés n’est pas une utopie. Ils font ainsi référence pour imaginer ce que pourrait être l’accompagnement de demain et montrent que l’institution est capable de fonctionner différemment et de dépasser le paradoxe du care en faisant de la personne aidée une actrice de son accompagnement et de son quotidien, en encourageant un prendre soin fondé sur l’interdépendance de ses protagonistes.
Proof of care
« Très tôt, j’ai compris que lorsque vous racontez aux gens ce que vous observez à marée basse, ils pensent que vous exagérez ou que vous mentez, alors qu’en fait vous essayez simplement d’expliquer des choses étranges et merveilleuses, aussi clairement que possible. » écrivait Jim Lynch dans Les grandes marées. Si les évaluations scientifiques de ces modes d’accompagnements expérimentaux et innovants ne répondent pas aux gold standards des sciences fondées sur la preuve, la multiplication et la récurrence de ces observations devraient interroger leur généralisation et leur possible qualification de proof of care, par analogie au proof of concept. Preuve de l’efficacité, de la pertinence, de la faisabilité, de la maturité de formes expérimentales du prendre soin par leur corrélation à une fonction clinique, thérapeutique, résiliente et phorique, elles « auront vocation ou non à être généralisées pour répondre aux enjeux du plus grand nombre, selon les règles des arbitrages démocratique en cours »[6].
Les observations découlant des accompagnements expérimentaux vont toujours dans le même sens : découverte des personnes, de leurs potentiels, de leur personnalité, de leurs occupations, d’une autre façon de travailler. Les professionnels, quant à eux, témoignent quasi-unanimement de la qualité de vie qu’ils ont gagné, de leur plaisir à travailler dans ces conditions, de la souffrance éthique dont ils s’allègent vis-à-vis des personnes qu’ils accompagnent par l’entièreté de leur démarche et l’adéquation avec leurs valeurs. C’est par des moyens collectifs et agiles que l’on peut démocratiser une approche, créer de véritables communautés d’acteurs. Or, il n’est plus à démontrer que lorsque l’on s’assigne un but commun à un groupe en vue de créer une interdépendance, la communauté devient plus soudée, compréhensive, altruiste et proactive.
Injonction inclusive ou inclusion injonctive ?
La véritable inclusion ne réside-t-elle pas dans les relations humaines et la confiance accordée à celles-ci ? Ne s’imposerait-elle pas naturellement et instinctivement sous une forme d’inclusion injonctive initiée par les relations entre les protagonistes du care dans leur expression la plus simple et la plus spontanée ? Les exemples et les expérimentations montrent en quoi la notion de handicap peut être stigmatisante tant dans la dépendance qu’elle engendre, que dans la présomption d’incompétence des individus qui la vivent. Ils montrent aussi que cette notion devient obsolète dès lors que l’on embrasse la différence, en vue de la faire vivre.
Il ne suffit pas de faire de l’inclusion une injonction, encore faut-il s’en donner les moyens et agir à la racine afin que cette inclusion s’exprime d’elle-même par le prendre soin : faire communauté en rassemblant les volontés de l’ensemble des protagonistes du care, qu’ils soient effecteurs ou récepteurs ; adopter une approche résiliente et respectueuse des besoins, des aptitudes, des occupations et des aspirations de chacun. En somme, il s’agit de changer de regard sur les situations de handicap et dépendance dans leur ensemble en se défaisant d’une approche fondée sur les capacités fonctionnelles. L’ambition affichée est d’aborder le care de façon holistique et la personne dans son intégralité pour guider les pratiques d’accompagnement en ESMS sur un terrain de coexistence entre les acteurs du prendre soin, en adéquation avec les valeurs qui les animent.
Tout ce qui sort de l’ordinaire pimente le quotidien. Il compose le sel de la vie et alimente le « Je », dont la curiosité, le regard empathique et critique permet à chacun de sans cesse reproduire « l’exploit et le goût de vivre ». L’anthropologue Françoise Héritier l’exprime ainsi : « Il faut se garder du temps pour constituer ce florilège intime de sensualité qui peut [pourtant] se partager, substrat fondamental de la “condition humaine” »[7].
NDLR : Kevin Charras a récemment dirigé S’affranchir du concept de handicap : critique constructive d’une notion obsolète, paru aux Editions In press
